|
Back
Mélancolie d’automne Paris
Cité de la musique
11/12/2011 -
Igor Stravinski : Requiem Canticles
John Cage : Seventy-Four (création française)
Pascal Dusapin : La Melancholia
Anu Komsi (soprano), Helena Rasker (contralto), Tim Mead (contre-ténor), Alexander Yudenkov (ténor), Rudolf Rosen (baryton)
SWR Vokalensemble Stuttgart, Nicholas Kok (chef de chœur), SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Jonathan Stockhammer (direction)
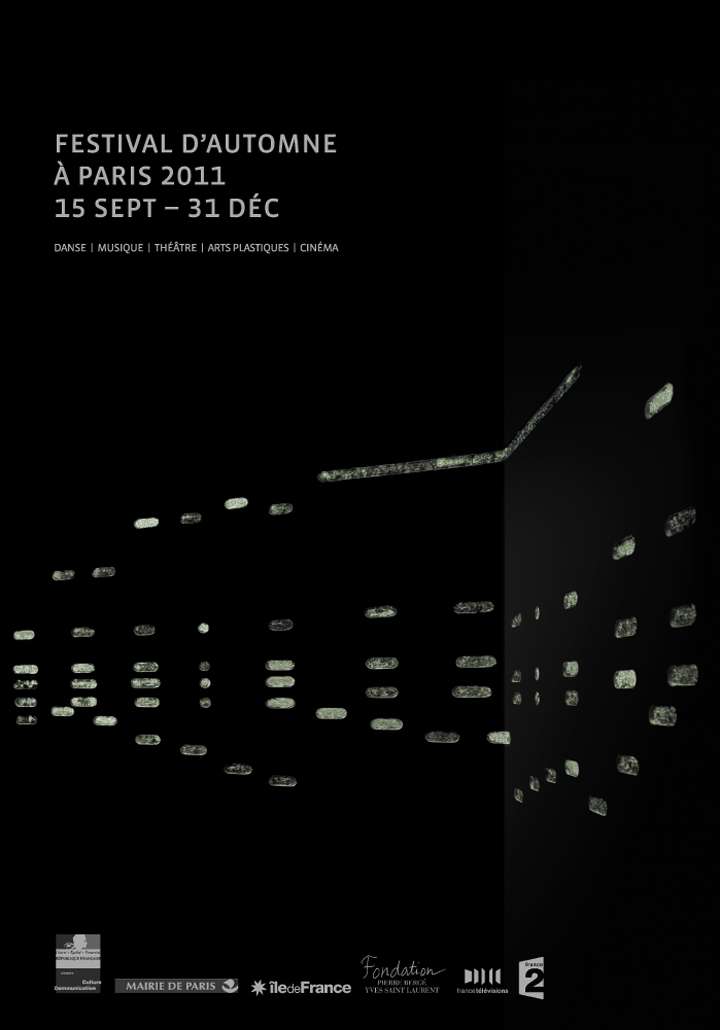
Affluence réjouissante pour ce bref mais splendide programme marquant la rencontre entre le Festival d’Automne, dont la quarantième édition s’intéresse notamment à John Cage (mais aussi à Olga Neuwirth et au Mexique), et le cycle que la Cité de la musique, du 9 au 13 novembre, consacre à la mélancolie: une soirée d’autant plus réussie qu’elle affiche l’Orchestre de la Radio de Baden-Baden et Fribourg, la formation symphonique «traditionnelle» sans doute la plus affûtée pour aborder le répertoire contemporain, avec une tradition remontant à Hans Rosbaud, puis poursuivie par Ernest Bour, Michael Gielen, Hans Zender, Sylvain Cambreling et, aujourd’hui, François-Xavier Roth.
C’est toutefois avec Ilan Volkov que l’orchestre devait se produire à Paris: souffrant, le chef israélien a laissé sa place à Jonathan Stockhammer, qui ouvre le concert sur une interprétation hiératique et sans concession des trop rares Requiem Canticles (1966), «requiem de poche», dixit Stravinski lui-même, avec une instrumentation recherchée (quatre flûtes mais pas de hautbois ni clarinettes) et un effectif important utilisé quasi exclusivement par petits groupes, à la manière de Webern.
Seventy-Four (1992), l’une des ultimes pages de John Cage, est aussi l’une des toutes dernières de sa série de quarante-sept (!) œuvres dont le titre indique le nombre d’exécutants – ici une phalange symphonique tout à fait ordinaire, mais employée, comme on s’en doute, de façon extraordinaire. Pas de partition d’orchestre ni de chef, en effet, mais deux ordinateurs portables posés sur son pupitre, faisant office de chronomètres, afin que les musiciens (qui jouent chacun leur propre partie, consistant en quelques notes et «parenthèses temporelles»), sachent simplement quand sont atteintes les douze minutes que doit durer la pièce. L’aléatoire tient donc une part déterminante dans ce qu’il est finalement donné à entendre au public. Pour cette création française, il est tout à fait loisible de se contenter d’aborder et de décrire cliniquement une succession de notes longuement tenues, à l’unisson ou bien plus ou moins conjointes, pour un résultat moins statique que Feldman, moins rugueux que Xenakis et moins hédoniste que Ligeti. Mais il est certainement bien plus intéressant de s’efforcer de le ressentir comme une fascinante expérience sonore et philosophique, n’évoquant d’ailleurs pas essentiellement la mélancolie, sinon peut-être celle de l’adieu à la beauté du monde.

J. Stockhammer (© Marco Borggreve)
Presque exactement contemporaine, La Melancholia (1991) de Dusapin, s’imposait cependant avant tout au regard de la thématique retenue par la Cité de la musique. Séparées par deux interludes, les trois parties chantent le «haut mal» en plusieurs langues (grec, latin, allemand, italien et anglais): ce sont celles des textes choisis, de l’Antiquité à Shakespeare, en passant par le Moyen Age, généralement intelligibles, et pas seulement quand ils sont confiés aux trois voix parlées (dont celle d’un d’enfant) préenregistrées et intervenant à la fin de chacune des parties. Cela étant, les forces vocales – quatre solistes, aussi remarquables que les trente-trois chanteurs de l’Ensemble vocal de la SWR – sont généralement exploitées avec un souci de couleur instrumentale. De taille relativement modeste, l’orchestre n’en est pas moins puissant, d’autant que s’en détache un trio de cuivres solistes (cor, trompette et trombone) qui, un peu avant la fin de la deuxième partie, quittent le premier balcon pour rejoindre la scène, où ils restent debout. Bien qu’invité à titre de remplaçant, Stockhammer retrouve ici un univers qui lui est familier, lui qui a dirigé la première parisienne de Faustus, the last night voici exactement cinq ans.
A trois jours de la présentation de son nouveau spectacle O Mensch! aux Bouffes du Nord, le compositeur, assis derrière la console, est venu à assister à la reprise bienvenue de son «opératorio», terminologie nouvelle qui dit bien la force dramatique de ce véritable coup de poing à la Zimmermann ou à la Penderecki: voilà de quoi tordre le cou au cliché d’une musique contemporaine froide, aride ou intellectuelle. Car c’est là une mélancolie tout sauf douce, mais ravageuse, torrentielle, portée par une expression tour à tour incantatoire, rageuse et déchirante, en vagues sonores d’une densité impressionnante, qui ne se retirent que pour de courtes suspensions, même si, a cappella, une infinie douceur prend finalement le dessus.
Le site du Festival d’automne à Paris
Le site de Jonathan Stockhammer
Le site de l’Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg
Le site de l’Ensemble vocal de la SWR
Simon Corley
|