|
Back
CD et livres: l’actualité de septembre
09/15/2022
Au sommaire :
Les chroniques du mois
En bref
Face-à-face
ConcertoNet a également reçu
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Alexandre Kantorow interprète Brahms Alexandre Kantorow interprète Brahms
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Adam Laloum interprète Brahms Adam Laloum interprète Brahms
 Jonathan Fournel interprète Brahms Jonathan Fournel interprète Brahms
 François Mardirossian interprète Glass François Mardirossian interprète Glass
 Bernard Foccroulle interprète Correa de Arauxo Bernard Foccroulle interprète Correa de Arauxo
 Le pianiste Francesco Piemontesi Le pianiste Francesco Piemontesi
 Le chœur Spirito Le chœur Spirito
 Intégrale de la musique de chambre de Franck Intégrale de la musique de chambre de Franck
 L’ensemble Faenza L’ensemble Faenza
  Oui ! Oui !
Le pianiste Guillaume Coppola
La pianiste Célia Oneto Bensaid
Reinbert de Leeuw interprète Oustvolskaïa
Œuvres pour orgue d’Etienne
Jean‑Christophe Revel interprète Lenot
Le quatuor de saxophones Kebyart
François‑Xavier Roth dirige Mahler
Michi Gaigg dirige Schubert
Thomas Dausgaard dirige Schubert
Roger Norrington dirige Nielsen
Trois œuvres de Cavanna
Henryk Szeryng interprète Brahms
Le chef Serge Koussevitzky
Le Quatuor (d’accordéons) Æolina interprète Berlioz
Alexander Paley interprète Rachmaninov
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Le Paris Urban Quartet
Cédric Tiberghien interprète Ravel
Simon Rattle dirige Mahler
Fiona Monbet dirige Romitelli
René Jacobs dirige Schubert
Roger Norrington dirige Martinů
Michael Korstick interprète Beethoven
Haochen Zhang interprète Beethoven
Christian Tetzlaff interprète Brahms et Berg
Gianandrea Noseda dirige Tchaïkovski
Musica Nigella interprète Fauré
Pas la peine
Dimitri Papadopoulos interprète Bach/Godowsky
Tomás Netopil dirige Mahler
Semyon Bychkov dirige Mahler
En bref
Les mélanges fertiles de Cavanna
Orgue de notre temps : Etienne et Lenot
Le métal hurlant de Romitelli
Norrington modern
Symphonies de Schubert : trois intégrales
Les (re)lectures de Kebyart
Actualité mahlérienne
Les mélanges fertiles de Cavanna

Berg et la techno, Beethoven et la tango brésilien, l’orchestre et les smartphones, le violon et la cornemuse : Bernard Cavanna (né en 1951), par‑delà les querelles de chapelles, se plaît à mêler le pur et l’impur, le savant et le populaire, la délicatesse et la trivialité, le raffinement et le prosaïsme, l’ancien et le moderne. Et ces mélanges inattendus, voire incongrus, se révèlent fertiles, comme le montre cette récente monographie. On y retrouve les deux mouvements on ne peut plus antagonistes (« Vif, chaotique », « Lent, immuable ») de son Premier Concerto pour violon (1999), partition capitale dont la puissance expressive demeure intacte, même dans la version de 2006 pour orchestre de chambre (seize musiciens), dont c’est ici le premier enregistrement. Premier Concerto, car un deuxième est apparu en 2019, un « concerto pour violon(s) » : pas un concerto pour plusieurs violons à la Vivaldi mais un concerto pour un soliste nanti de quatre violons, dont trois (parmi lesquels un quart de violon) (dés)accordés de manière totalement inhabituelle, « extrême », même, pour le compositeur – d’où le titre de l’œuvre, Scordatura. Le Premier était écrit à la mémoire de son père et dédié à Noëmi Schindler (née en 1969), qui en assura la création ; la dimension personnelle de Scordatura est tout aussi importante, l’œuvre étant elle aussi dédiée à la violoniste, qui l’a également créée, mais aussi à sa mère, d’où ces souvenirs d’enfance inspirant le troisième et dernier mouvement, « Matchitche », où l’on entend le quart de violon et une ancienne boîte à musique. Dans le premier, « In memoriam Berg », on entend bien sûr le Concerto « A la mémoire d’un ange », mais aussi une mandoline, et dans le deuxième, « Pulsations », le soliste entre en conflit avec la cornemuse et avec le rythme qu’impose l’orchestre. Les Geek bagatelles (2016), « Introspections d’après quelques fragments de la IXe symphonie de Beethoven pour orchestre et ensemble de smartphones », mettent en avant Arie van Beek (né en 1951) et l’Orchestre de Picardie, dont il a été le directeur musical de 2011 à 2022. Des applications ont été conçues, « permettant [aux smartphones] d’opérer différents filtrages ou d’agir sur divers paramètres comme l’intensité, le timbre et la hauteur », tandis que des bribes des deuxième et quatrième mouvements de la symphonie apparaissent ici ou là comme « dans un champ de ruines ». Ni Sinfonia de Berio, ni Dixième de Beethoven d’Henry, le résultat est souvent stimulant et même parfois drôle, mais dans tout (bon) comique, il y a une part de tragique : au fond, il y a du Boltanski chez Cavanna, car ce qui lie les trois œuvres, derrière le dérisoire, la dérision, le brio, le défi et l’iconoclastie, c’est l’angoisse de vies, de civilisations, de mémoires qui s’effacent (L’empreinte digitale ED13261). SC
Orgue de notre temps : Etienne et Lenot
 
Comme la guitare, l’orgue semble constituer un univers à part dans le domaine de la musique dite « classique » ou même « contemporaine ». Il serait pourtant dommage de passer à côté, car les compositeurs de notre temps, qu’ils soient eux‑mêmes organistes ou non, continuent de trouver leur inspiration dans cet instrument et d’en écrire l’histoire.
Jean‑Luc Etienne (né en 1963), professeur au conservatoire à rayonnement régional de Tours, reconnaît des influences multiples : avant tout Jean‑Pierre Leguay, ancien cotitulaire de Notre‑Dame de Paris – Incandescence (2002) et Murmure (2015) lui sont d’ailleurs dédiés – mais aussi Webern, le dernier Stravinski, Carter et Birtwistle. On retrouve visiblement leur prédilection pour la concision dans les Meslanges (2009), « onze pièces brèves », qui donnent leur titre à l’album, mais peut‑être ces influences sont‑elles davantage sensibles dans la musique instrumentale et vocale d’Etienne, car le langage harmonique, une certaine radicalité de l’écriture et le caractère directement expressif de sa musique d’orgue évoquent davantage un disciple de Messiaen – il y a pire référence en la matière. Mais à la différence de Messiaen, la préoccupation liturgique n’apparaît que marginale, seule Strophe (2018), monodie écrite pour la revue Préludes de l’Association nationale pour la formation des organistes liturgiques (ANFOL), pouvant être considérée comme appropriée à un office. Les 75 minutes de ce disque offrent des sonorités d’une grande variété, ne serait‑ce que parce qu’Etienne se dit souvent stimulé par sa rencontre ou sa proximité avec un instrument : l’écart est grand entre le Diptyque (2009) aux volets « fortement opposés », la seule de ses œuvres destinée à un orgue d’esthétique symphonique (inspirée par le Dalstein-Haerpfer de l’église Saint‑Sébastien de Nancy), et Una toccata (2015), destinée « aux couleurs claires et lumineuses d’un orgue italien ancien ». Dédicataire d’Escapade (2006) et à l’origine de la commande des cinq pièces de Trente (2015), Pascale Rouet (née en 1961), professeur au conservatoire à rayonnement départemental de Charleville-Mézières et rédactrice en chef de la revue Orgues Nouvelles, et le compositeur lui‑même, pour les pages les plus récentes, se partagent le Cavaillé‑Coll (1848) de la cathédrale Saint‑Corentin de Quimper, fort bien enregistré, et jouent même ensemble les Fanfares (2019) (Triton TRIHORT576).
Sans être lui‑même organiste, Jacques Lenot (né en 1945) aura grandement contribué à enrichir le répertoire. Ainsi du Troisième Livre d’orgue (1995) sur lequel il vient de revenir, ramenant notamment le nombre de pièces de dix‑sept à quatorze, de proportions très variables (1 à 10 minutes), pour une durée totale d’une heure et quart. Chacune est associée à quelques mots extraits du Livre de la pauvreté et de la mort de Rilke, dont la « hantise existentielle » (Lenot) et l’écho que lui donne notre époque (guerres, sida, covid) imprègnent la musique, d’allure lente ou modérée, de tonalité sombre, intense et prenante, comme un pendant actuel, moins religieux mais tout aussi spirituel, aux Sept Dernières Paroles de Haydn. Titulaire des orgues de la cathédrale d’Auch, Jean‑Christophe Revel, ici sur le Cavaillé‑Coll de l’abbaye de Royaumont, demeure un interprète d’élection de Lenot, et tout particulièrement de ce recueil, ayant contribué à la création de la première version il y a plus de vingt‑cinq ans (L’Oiseau Prophète 007). SC
Le métal hurlant de Romitelli

La disparition prématurée de Fausto Romitelli (1963‑2004) a conféré à An Index of Metals (2003) une valeur d’œuvre testament. S’il la qualifiait de « vidéo‑opéra », il ne la décrivait pas moins comme une « narration abstraite et violente, épurée de tous les artifices de l’opéra, un rite initiatique d’immersion, une transe lumino-sonore ». « Composer visuellement le son, filmer acoustiquement l’image, les soumettre aux mêmes transformations informatiques », voici donc encore un avatar de l’opéra comme Gesamtkunstwerk, chacune de ses composantes étant d’égale importance pour contribuer à un tout : musique tour à tour planante et saturée (chant, onze musiciens et informatique), texte incantatoire (en anglais) de Kenka Lekovich, vidéo de Paolo Pachini et Leonardo Romoli. Mais il n’y a pas plus d’intrigue que de scénario dans la trilogie des Qatsi (1982‑2002) de Glass et Reggio, avec laquelle elle partage peut‑être un message de dénonciation de la civilisation industrielle, celle du métal. Captée en public, la performance de Linda Oláh (née en 1988), qui tient l’unique « rôle » de la Drowningirl, et de l’ensemble Miroirs Etendus, « compagnie dédiée à la création lyrique », dirigé par Fiona Monbet (née en 1989), rend parfaitement justice à cette partition éclectique et radicale, mais il manque sans doute l’immersion totale que procure la vidéo pour que l’impact de ce spectacle total soit entier (B Records LBM 043). SC
Norrington modern
 
On connaît évidemment la prédilection de Roger Norrington pour le répertoire baroque, classique et même romantique, passé aux rayons X d’un souci aussi maniaque que controversé d’authenticité. On se souvient peut‑être aussi qu’il a enregistré plusieurs symphonies de son compatriote Vaughan Williams avec le Philharmonique de Londres. Mais la surprise est grande de le trouver, grâce à l’éditeur SWR Classic, avec feu l’Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart, dont il fut le Chefdirigent de 1998 à 2011, diriger deux symphonistes, certes parmi les plus importants du siècle passé, mais auxquels son nom ne semblait pas devoir être associé.
L’étonnement est sans doute un peu moins marqué avec Nielsen, compositeur dont la notoriété en dehors de son Danemark natal doit beaucoup aux Britanniques, également promoteurs précoces de Sibelius. Dans la Deuxième « Les Quatre Tempéraments » (1902) et la Quatrième « Inextinguible » (1916), on ne sait à quelles considérations philologiques s’est livré Norrington, mais toujours est‑il que ses affinités avec cette musique ressortent nettement. Autrement dit, il n’est pas certain qu’il serait facile de l’identifier comme un « intrus » dans une comparaison « à l’aveugle ». A moins qu’on ne reconnaisse dans ces enregistrements réalisés respectivement en janvier 2003 et décembre 2001 une direction vive, acérée et humoristique, qui, si elle allège les textures, ne les assèche nullement, laissant les mouvements lents s’épanouir avec le lyrisme requis et n’exagérant pas l’étrangeté de partitions dont l’originalité se suffit à elle‑même : bien au contraire, Norrington tient fermement la ligne, en particulier dans le déroulement plus sinueux la Quatrième (SWR19120CD).
En revanche, on n’imagine guère Martinů – bien qu’adepte, comme Nielsen, de la « tonalité progressive » – dans l’univers et la culture du chef anglais. De fait, dans les Cinquième (1946) et Sixième « Fantaisies symphoniques » (1953), enregistrées respectivement en septembre 2003 et février 2008, ce qu’il propose diffère assez sensiblement de ce que l’on a l’habitude d’entendre, ne serait‑ce que sa manière bien à lui de clarifier le texte, ce qui permet d’entendre ici moult détail d’une riche orchestration – mais qui dit que Martinů doit être réservé aux Tchèques et même aux Américains ou aux Français ? Ce faisant, il souligne la dimension rythmique davantage que la couleur de cette musique, qu’il tire ainsi vers le Stravinski de la Symphonie en ut, ce qui, sans être un contresens, demeure un peu réducteur : s’il met en valeur de manière assez marquée la violence (Larghetto et conclusion de la Cinquième), les textures méritent sans doute davantage de rondeur et le propos davantage de lyrisme (SWR19119CD). SC
Symphonies de Schubert : trois intégrales

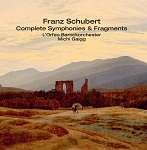 
Trois intégrales fort différentes : l’une se conclut, l’autre vient d’être publiée, la troisième est opportunément rééditée. Mais toutes trois font de nouveau apparaître qu’entre les Première et Sixième (1813‑1817), d’une part, et les deux dernières (1822‑1828), d’autre part, il y a une frontière que certains ne franchissent pas aisément.
L’intégrale de René Jacobs (né en 1946) avec l’Orchestre B’Rock se conclut sur un généreux album de près de 90 minutes associant les deux dernières symphonies. Se fondant sur les travaux d’Adolf Schering (1939) et d’Arnold Feil (2002) et toujours en quête de pistes inexplorées, le chef flamand voit dans « Mon rêve », célèbre texte de juin 1822, donc exactement contemporain de l’Inachevée et dit ici par Tobias Moretti (né en 1959) en introduction de chacun des deux mouvements, une structure en deux parties prouvant que la symphonie ne compte que deux mouvements et qu’elle est donc... achevée. Pourquoi pas, même s’il reste de (courtes) esquisses pour un troisième mouvement et si l’on compte sans doute sur les doigts d’une main les symphonies « à programme » en deux mouvements de compositeurs ayant précédé Schubert. Moins extravagante que cette hypothèse mais aussi moins surprenante que dans les précédents volumes, l’approche de Jacobs, avec un effectif très légèrement accru (vingt‑neuf à trente et une cordes), paraît presque convenue, assez traditionnelle dans le premier mouvement, même si le second mouvement se révèle inhabituellement allant, suivant à la lettre l’indication Andante con moto. De même, la Neuvième est étonnamment sage, nonobstant un silence inattendu vers la fin de la reprise du Scherzo, et presque retenue, hormis l’Andante con moto, une fois de plus... très con moto (Pentatone PTC 5186 894).
Michi Gaigg (née en 1957), pour les vingt‑cinq ans de son Orchestre baroque Orfeo, fondé en 1996 et basé à Linz, propose une intégrale enregistrée en public en mai 2018 durant la Schubertiade de Hohenems (dans une acoustique malheureusement un peu confuse) avec des raccords réalisés dans la foulée de ces concerts puis en avril 2021. Dans les six premières symphonies, hormis une Quatrième « Tragique » un peu trop paisible, on apprécie les contrastes, les traits incisifs mais aussi la spontanéité, avec souvent quelque chose de rustique, naïf, frais, de gracieux dans le Trio des menuets. On goûte aussi les saveurs instrumentales : rien de sec et décharné comme chez certaines formations sur instruments « anciens », avec même de formidables basses, qu’on n’imagine peu nombreuses mais qui n’en sonnent et n’en grondent pas moins. Et – non sans surprise, il faut le reconnaître – la réussite est également au rendez‑vous dans les deux dernières symphonies. L’Inachevée est même assez originale, avec un premier mouvement très lent, et elle est complétée par les seules 35 premières secondes écrites du Scherzo. L’intégrale se conclut sur une Neuvième parfaitement équilibrée et maîtrisée mais pas ennuyeuse pour deux Groschen. Le coffret comprend par ailleurs plusieurs courtes et passionnantes ébauches des années 1811‑1814 et le seul fragment orchestré d’une Septième Symphonie de 1821 par ailleurs entièrement écrite (coffret de quatre disques CPO 555 228‑2).
Saluée en son temps dans nos colonnes virtuelles (voir ici et ici), l’intégrale dirigée par Thomas Dausgaard (né en 1963), réalisée entre octobre 2006 et juin 2013, revient en un coffret de quatre SACD au minutage très généreux (5 heures au total). Entre‑temps, le chef danois est devenu chef honoraire de l’excellent Orchestre de chambre de Suède (basé à Orebro, sixième ville du pays, à 150 kilomètres à l’ouest de Stockholm) après en avoir été le chefdirigent de 1997 à 2019. Les six premières symphonies se situent toutes à un niveau élevé, avec des tempi vifs mais pas précipités (saut peut‑être l’Andante con moto de la Cinquième), ce qui est bienvenu notamment dans les introductions lentes, pas trop pompeuses, et les Menuets, qui avancent bien. Alternant ampleur et élégance, légèreté et puissance, Dausgaard déploie du caractère et un sens dramatique certain, comme dans l’accélération subite qui suit l’entrée en matière très mesurée de l’Allegro moderato final de la Sixième. Les deux dernières symphonies déçoivent quelque peu, curieusement à front renversé avec Jacobs : autant celui‑ci semblait se ranger, autant Dausgaard, dans la continuité des six premières, a visiblement la volonté d’alléger, de mordre dans les attaques et de souligner les accents, avec en outre un Allegro moderato de l’Inachevée étonnamment vif. Plutôt que de s’aventurer dans le maquis des symphonies partielles ou reconstruites, cette intégrale est complétée par les trois Entractes et les deux Musiques de ballet pour Rosamonde, l’Ouverture pour La Harpe enchantée (qui servit aussi pour Rosamonde) et une « Marche funèbre » pour un opéra inachevé, Adraste (Bis BIS‑2514). SC
Les (re)lectures de Kebyart

Fondé en 2014, le quatuor de saxophones Kebyart – du nom du gamelan gong kebyar, genre de musique de gamelan balinais – propose un programme aussi séduisant que cohérent, mêlant pages originales et transcriptions, dans son album « Lectures différentes ». Le titre est repris d’une œuvre (2014) de Peter Eőtvős (né en 1944) : en quatre parties, elle comprend deux « scènes », chacune suivie d’une autre « lecture », d’où son titre. Pour entourer cette partition habile et élégante, l’ensemble barcelonais a par ailleurs réalisé ses propres arrangements d’extraits de Pulcinella (1920/1922) de Stravinski et du Quatuor opus 33 n° 3 « L’Oiseau » (1781) de Haydn, défis techniques et peut‑être encore davantage stylistiques relevés sans peine par les saxophonistes, qui ont notamment reçu l’enseignement de membres des Quatuors Berg, Casals, Hagen et Quiroga. Ils ont par ailleurs passé commande au compositeur palmesan Joan Pérez‑Villegas (né en 1994) : Sólo el misterio (2021), à la mémoire de García Lorca, est une pièce de 10 minutes, fondée sur trois des Chansons populaires anciennes du poète, de caractère tour à tour brillant et ludique, poétique et expressif, les musiciens étant également amenés à frapper des mains et des pieds, à la manière du flamenco. Deux arrangements « bonus » concluent, comme des bis à un récital : Take This Waltz (1988), chanson de Leonard Cohen (1934‑2016), dont les paroles sont une traduction de Pequeno vals vienés de García Lorca, et l’Adagio du Dixième Quatuor (1813) de Schubert, sur lequel Roger Comella a réalisé un court métrage intitulé Schubertiade (Linn CKD 691). SC
Actualité mahlérienne
 
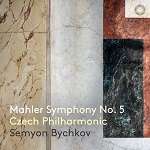 
Trois intégrales ou séries qui se poursuivent et une version isolée : la fortune de Mahler au disque ne se dément pas. Quantitativement, du moins, car qualitativement, c’est une autre histoire.
Après les Sixième et Neuvième, Tomás Netopil poursuit avec la Deuxième « Résurrection » (en un seul disque de plus de 85 minutes enregistré en public en mai 2022) son parcours avec l’Orchestre philharmonique d’Essen, où il est Generalmusikdirektor depuis 2013. Le chef tchèque dispose d’un ensemble de qualité et de forces vocales tout à fait appropriées : la mezzo Bettina Ranch chante fort bien « Urlicht », rejointe par la soprano Giulia Montanari dans le finale, où le Chœur philharmonique de Prague déploie son savoir‑faire habituel. Mais, à force de contrôle et de méticulosité, certes sans doute aussi de finesse et d’élégance, il passe en grande partie à côté de l’œuvre : trop souvent, le drame manque dans le premier mouvement, le charme dans le deuxième, l’ironie dans le troisième, la force visionnaire dans le finale (Oehms Classics OC 1717).
Pour la Quatrième, les enregistrements se suivent mais ne se ressemblent pas : après la déception suscitée par Semyon Bychkov, François‑Xavier Roth, qui a déjà brillamment réussi la Première avec son orchestre Les Siècles en 2018 (mais aussi enregistré les Troisième et Cinquième à Cologne), apporte de bien plus amples satisfactions dans cet enregistrement réalisé en novembre 2021. D’abord celles de son ensemble d’instruments « d’époque » (mais aussi « de lieu », avec notamment fagotts, cors viennois et trompettes germaniques à palettes), à l’effectif relativement réduit (quarante‑deux cordes), particulièrement adapté à l’œuvre, et aux sonorités fruitées et rustiques qui apportent indéniablement du caractère à cette symphonie volontiers bucolique, de même que le généreux portamento des cordes auquel on n’est évidemment plus habitué. On les doit aussi à la direction du chef français, légère, fraîche et sereine, facétieuse et espiègle au besoin, où le sens du détail ne fait jamais perdre la ligne générale. On pourra avoir le regret d’un Scherzo plus sarcastique ou la nostalgie d’un troisième mouvement bénéficiant de davantage de profondeur sonore et expressive mais certainement pas regretter la présence bienfaisante, tour à tour terrestre et angélique, de Sabine Devieilhe dans le lied final (Harmonia mundi HMM 905357).
Après une décevante Quatrième inaugurant une intégrale entreprise avec sa Philharmonie tchèque, Semyon Bychkov ne change pas fondamentalement la donne dans la Cinquième, enregistrée en décembre 2021 une semaine après avoir été donnée en concert. Sans surprise, l’orchestre se montre tout à fait à son avantage et la mise en place est parfaitement réussie, mais l’interprétation ne décolle pas, s’enlise même parfois, n’exprime pas grand‑chose, l’étincelle qui pourrait l’illuminer et l’élan la réveiller font trop souvent défaut. On peine à trouver le tragique du premier mouvement, les tempêtes du deuxième, la fraîcheur du troisième, la tendresse du quatrième et la joie du finale, et l’ennui ne tarde donc pas à s’installer (Pentatone PTC 5187 021).
Captée en public en novembre 2021, la Neuvième proposée par Simon Rattle était prometteuse : l’un de ses premiers disques dans ses jeunes années à Brimingham fut une remarquable Deuxième et il dirige ici l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, phalange mahlérienne s’il en fut, pour les premiers concerts faisant suite à l’annonce de la conclusion d’un contrat de cinq ans aux fonctions de Chefdirigent (à compter de la saison 2023‑2024), concerts dédiés à la mémoire de Bernard Haitink, chef mahlérien s’il en fut. Pour son troisième enregistrement de l’œuvre, après Vienne (1993, EMI, également en public) et Berlin (2007, EMI), le chef anglais conjugue flamboyance – ce serait dommage de s’en priver avec un orchestre dont la virtuosité et la puissance jamais pesante apparaissent prodigieuses – et modernité – on sent que Berg n’est pas loin –, mais il y a toujours la crainte qu’on ne se situe davantage dans la démonstration que dans l’impératif et l’urgence d’un sentiment : le ländler est rustique à souhait mais, comme aurait dit Debussy (à propos du Sacre), « avec tout le confort moderne », tandis que le Rondo. Burleske paraît trop léché pour être vraiment caustique et désespéré. Au‑delà du brio exceptionnel de la réalisation, il est donc difficile de savoir si Rattle souhaite exprimer quelque chose (BR‑Klassik 900205). LPL
Face-à-face
Beethoven : Concertos pour piano
 
Combien Beethoven a‑t‑il composé de concertos pour piano ? Cinq, bien sûr ! Ou bien six ? Ou même sept ? Qui dit mieux ? Voilà déjà qui différencie deux intégrales récemment parues, l’une audacieusement maximaliste, l’autre traditionnellement minimaliste... aucune ne comprenant toutefois la Fantaisie chorale ou le Triple Concerto.
Michael Korstick (né en 1955) offre pas moins de huit concertos, incluant la version piano assez connue réalisée par Beethoven de son Concerto pour violon (avec l’intervention des timbales dans le cadence du premier mouvement). Mais il inclut aussi un concerto en mi bémol de jeunesse (1784), dont n’a survécu qu’une réduction pour piano, généralement désigné sous le « n° 0 » et présenté ici non pas dans la réalisation de Willy Hess mais dans une version « reconstruite » par l’Autrichien Hermann Dechant (né en 1939), ainsi que le premier mouvement d’un Concerto en ré (1815), réalisé par le Britannique Nicholas Cook à partir de 258 mesures d’esquisses, et, pour faire bonne mesure, un Rondo en si bémol, première version du finale du Deuxième Concerto (qu’il est en effet permis de préférer). Exhaustive, comme on le voit, cette intégrale devient parfois également exhausting tant le chef, Constantin Trinks – à la tête d’un honnête Orchestre symphonique de la Radio autrichienne (ORF) de Vienne, et le pianiste sont pêchus, le problème venant surtout de ce dernier son jeu très articulé et tonique en devient parfois dur, avec des accents très marqués. Si cela réussit certes au Deuxième, plein de peps, cela tient également parfois de l’éléphant dans le magasin de porcelaine, comme cette manière très exagérée de souligner les basses dans l’accompagnement de la mélodie du Largo du Premier. Mais en prenant à bras‑le‑corps, pour ne pas dire à la hussarde, l’impossible adaptation du Concerto pour violon, il en donne une interprétation parmi les plus convaincantes, qui se veut fidèle aux indications métronomiques assez extrêmes recueillies par Czerny. Les raretés se révèlent en revanche d’un intérêt musical franchement décevant, voire dérisoire (coffret de quatre disques CPO 555 447‑2).
Plus équilibré, nuancé, élégant et poétique que son aîné, Haochen Zhang (né en 1990), vainqueur du Concours Van Cliburn en 2009, aurait toutefois tendance à faire (trop) imperturbablement défiler les notes. Davantage qu’un Deuxième joué du bout des doigts, le Quatrième est sans doute celui qui lui convient le mieux. Il bénéficie d’un accompagnement de grand luxe avec l’Orchestre de Philadelphie, attentivement dirigé par Nathalie Stutzmann, qui en est la principal guest conductor depuis 2021 (coffret de trois SACD Bis BIS‑2581). SC
Brahms : Concerto pour violon
 
Voilà de ces bourdes fameuses qui abondent dans l’histoire de la musique : Wieniawski refusant d’interpréter un concerto qu’il trouve « injouable » et Sarasate s’indignant de devoir « rester sur scène, violon à la main, pour écouter le hautbois jouer la seule mélodie de l’Adagio ». Le jugement péremptoire de ces deux immenses violonistes contemporains n’a heureusement pas empêché l’œuvre de faire son chemin, pas davantage que, peu de temps après sa création à Leipzig par Joachim (qui avait contribué à sa genèse), sa brouille avec Brahms. Au point de susciter une discographie non seulement considérable mais d’une grande variété, comme le montrent ces deux versions récemment parues ou rééditées, aussi dissemblables que possible.
Henryk Szeryng (1918‑1988) a bien sûr laissé de nombreux témoignages de ce concerto, ne serait‑ce qu’« officiels », sous la direction de Monteux (1958, RCA), Dorati (1962, Mercury) ou Haitink (1973, Decca). Pour autant, le concert viennois du 1er juin 1967, déjà publié en 2007, méritait assurément d’être réédité, tant son archet apollinien et souverain mais également précis, élégant et pudique, s’impose avec la force de l’évidence. L’accompagnement se situe au même niveau et en parfaite osmose, avec Rafael Kubelík à la tête de son Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, qui complète ce disque, bien court mais pas moins à chérir, par une Ouverture hussite de Dvorák intense et haute en couleur (Orfeo C220081).
Significativement plus rapide et engagé, avec une rage beethovénienne, Christian Tetzlaff (né en 1966), sans rechercher une sonorité flatteuse ou même la puissance, cultive le conflit et même le trouble. Jusque dans l’Adagio, l’intranquillité, la fuite, l’inquiétude sont de mise, d’un expressionnisme inattendu, Dans ces conditions, le couplage avec le Concerto « A la mémoire d’un ange » de Berg en devient presque naturel. Le violoniste, qui n’a pas besoin ici d’exagérer autant le trait, se fait plus sobre et retenu, avec une péroraison qui évoque un surprenant effet d’engourdissement. Comme dans Brahms, Robin Ticciati, avec l’Orchestre symphonique allemand de Berlin, dont il est le Chefdirigent depuis 2017, est à l’unisson tant dans l’esprit que dans la qualité instrumentale (Ondine ODE 1410‑2). SC
Tchaïkovski : Cinquième Symphonie
 
Encadrée par les non moins célèbres Quatrième et Sixième « Pathétique », la Cinquième (1888) est, à l’unisson de ce triptyque symphonique, sous l’emprise du destin, même si celui‑ci, matérialisé par un thème, exposé d’emblée mais dont le caractère diffère d’un mouvement à l’autre, prend finalement un tour résolument plus optimiste, et même triomphal, que dans les deux autres symphonies. En voici deux versions enregistrées à Londres à près de soixante‑dix ans de distance.
L’interprétation de Serge Koussevitzky (1874‑1951), non avec le Symphonique de Boston, dont il fut le directeur musical durant un quart de siècle, mais avec le Philharmonique de Londres, pas toujours irréprochable en ce 1er juin 1950 au Royal Albert Hall, a évidemment quelque chose de daté, avec une gestion élastique du tempo et du phrasé que personne ne pourrait désormais plus oser. Si ces libertés peuvent surprendre aujourd’hui, l’ensemble reste tenu d’une poigne de fer, mais non sans une élégance surannée dans la Valse, et n’en continue pas moins à fasciner par son énergie vitale, sa passion débordante, sa force expressive. Une semaine plus tard, la Deuxième Symphonie de Sibelius, un compositeur que le chef fut l’un des tout premiers à promouvoir aux Etats‑Unis et que l’orchestre avait « appris » avec Beecham dès les années 1930, est du même tonneau, toujours aussi enflammée quoique sujette à moins d’embardées stylistiques. Ces deux captations, admirablement restaurées par Lani Spahr, sont complétées par un documentaire d’une heure de Jon Tolansky (en anglais), comprenant des témoignages aussi admiratifs que définitifs de quatre musiciens des orchestres de Boston et de Londres ayant travaillé sous sa direction (album de deux disques SOMM Recordings/Ariadne 5017‑2).
Gianandrea Noseda (né en 1964) s’est notamment fait un nom dans la musique russe, en particulier avec l’Orchestre symphonique de Londres, dont il est le principal guest conductor depuis 2016, ce dont témoigne une remarquable intégrale Chostakovitch en cours (voir ici). Pourtant, manquent dans cette captation de concert de novembre 2019 l’électricité, la tension, la conviction que le chef italien sait généralement insuffler dans ses interprétations. Et comme la formation anglaise, certes fidèle une fois de plus à sa réputation, n’a pas non plus son pareil pour se mettre en pilotage automatique à un niveau d’excellence, le résultat reste en deçà des attentes. En complément, la Suite de La Légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia (1905), l’avant‑dernier opéra de Rimski‑Korsakov, réalisée par son élève et gendre Maximilian Steinberg, paraît plus inspirée (LSO Live LSO0858). SC
ConcertoNet a également reçu
 Quatuor Æolina : Berlioz Quatuor Æolina : Berlioz
Depuis Liszt, arranger la Symphonie fantastique constitue un défi, tant le compositeur innove en accordant une fonction capitale à la couleur orchestrale. Le quatuor d’accordéonistes français relève ce défi dans une transcription réalisée par l’un de ses membres, Thibaut Trosset. L’aptitude des musiciens à évoquer les sonorités des instruments de l’orchestre, jusqu’aux trémolos des cordes et grondements des timbales (« Scène aux champs »), est à la fois fascinante et amusante, même si l’imitation ne constitue évidemment pas la seule dimension de cette entreprise. On ne peut s’empêcher aussi de sourire lorsqu’« Un bal » prend un tour « musette » assez éloigné de l’atmosphère originale mais on se recueille quand le Religiosamente concluant « Rêverie. Passions » résonne comme un orgue et on ne parierait pas que la « Marche au supplice », avec ses tapotements angoissants, et le « Songe d’une nuit du sabbat », avec son Dies Iræ (dé)braillé et autres effets spéciaux, soient moins terrifiants qu’à l’orchestre. Remarquable, tant par la réalisation technique que par l’esprit artistique et, cerise sur le gâteau, la notice de Bruno Messina, directeur artistique du Festival de La Côte‑Saint‑André (Klarthe KLA131). SC
 Alexander Paley : Rachmaninov Alexander Paley : Rachmaninov
Après l’Opus 3 n° 2 et les dix de l’Opus 23 il y a deux ans, le pianiste moldave en vient logiquement aux treize Préludes de l’Opus 32 (1910), un recueil dont on ne voit pas trop pourquoi la notoriété est moindre. Et il complète non moins logiquement avec les deux des huit Etudes‑Tableaux de l’Opus 33 (1911) qu’il n’avait pas enregistrées dans son premier disque. Même s’il possède la versatilité et la technique que requièrent ces pièces redoutables, il n’y a chez lui ni étalage de science pianistique, ni tapage indu, ni complaisance interprétative, ce qui est la meilleure manière de servir une musique qui ne se refuse pas à une certaine austérité. La satisfaction est augmentée par une notice exemplaire de Michel Fleury (La Música LMU 027). LPL
 Musica Nigella : Fauré Musica Nigella : Fauré
Après « Offenbach. Le Diabolique », « Poulenc. L’Espiègle », « Chausson. Le Littéraire » et « Ravel. L’Exotique », l’ensemble pas‑de‑calaisien dirigé par Takénori Némoto poursuit son exploration de la musique française des XIXe et XXe siècles. Voici donc maintenant « Fauré. Le Dramaturge; », qui est une fois encore l’occasion d’associer œuvres célèbres – Pelléas et Mélisande (dans l’orchestration de Koechlin et incluant la trop rare « Melisande’s Song », bien chantée par Cécile Achille), Masques et bergamasques avec la très célèbre Pavane que Fauré y avait associée – et pages rares – Shylock, dans sa version originale reconstituée et avec le ténor Cyrille Dubois (qui vient d’achever une intégrale des mélodies fauréennes) – ou même inédites – Le Voile du bonheur, pour une pièce de Clemenceau. Car le fil conducteur est évidemment, comme l’annonce le titre de l’album, ce que le compositeur a écrit pour le théâtre. Dans les partitions les plus célèbres, on pourra trouver des interprétations plus entraînantes, mais la qualité des musiciens doit être saluée, avec mention spéciale pour la flûte d’Anne‑Cécile Cuniot (Klarthe KLA142). SC
La rédaction de ConcertoNet
|