|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de novembre
11/15/2015
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Julia Lezhneva chante Haendel Julia Lezhneva chante Haendel
 Antonio Pappano dirige Aïda Antonio Pappano dirige Aïda
 Quintettes avec clarinette anglais Quintettes avec clarinette anglais
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 John Barbirolli dirige Elgar et Berlioz John Barbirolli dirige Elgar et Berlioz
 Masaaki Suzuki dirige Bach Masaaki Suzuki dirige Bach
 Gilles Deleuze, la pensée-musique Gilles Deleuze, la pensée-musique
  Oui ! Oui !
Philippe Herreweghe dirige Haydn
Philippe Herreweghe dirige Bach
Chœurs de femmes et mélodies de Koechlin
Anna Christensson interprète Mankell et Nystroem
Adriano dirige Ibert
La revue de l’Association Beethoven France
Carl Petersson interprète Grieg et Evju
Edition spéciale Arvo Pärt
Neeme Järvi et Tõnu Kaljuste dirigent Pärt
Marcel Worms et Ursula Schoch interprètent Pärt
Herbert Kegel dirige Orff
Václav Neumann dirige Janácek et Dvorák
Jirí Běhlohlávek dirige Smetana
Ruy Blas de Marchetti
André Previn dirige Walton
Oleg Caetani dirige Gounod
Gordan Nikolitch dirige Gounod
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Thomas Hengelbrock dirige Niobe de Steffani
Masaaki Suzuki dirige Bach
Simon Rattle dirige Le Paradis et la Péri
Musique pour la Rothko Chapel
Christopher Russell dirige Damrosch
Gustavo Dudamel et l’histoire d’El Sistema
Così fan tutte à Salzbourg (2013)
Heinz Bongartz et Günther Herbig dirigent Brahms
Tannhäuser à Bayreuth (2012)
«Musica selecta» de Pärt
Aureliano in Palmira à Pesaro (2014)
T. A. Irnberger interprète Mendelssohn et Gade
Gidon Kremer interprète Kancheli
Pas la peine
Michael Alexander Willens dirige Kalliwoda
Hermann Max dirige Luther à Worms de Meinardus
Maria di Rohan de Donizetti à Bergame (2011)
Yannick Nézet-Séguin dirige L’Enlèvement au sérail
En bref
Arvo Pärt: un riche anniversaire
Attention! Un concerto de Grieg peut en cacher un autre...
Plongée au cœur du Sistema
Filippo Marchetti, dans l’ombre de Verdi
Gidon Kremer au service de Kancheli
Donizetti à son meilleur, mais pas la production
Gounod symphoniste
Le ravissement Ibert
Londres honore Walton
Tannhäuser à Bayreuth: journée portes ouvertes entreprises
Au cœur de la tradition de la Philharmonie tchèque
Gade dans les pas de Mendelssohn
Brahms symphonique mais sans symphonies
L’Enlèvement au sérail: luxueux ratage
Così: de Zurich à Salzbourg
La clémence d’Aureliano
Trionfi d’Orff: le triomphe de Kegel
Luther à Worms de Meinardus: une version d’attente
Association Beethoven France: pari tenu
Arvo Pärt: un riche anniversaire
 
 
A l’occasion des 80 ans d’Arvo Pärt, rééditions et nouveautés n’ont pas manqué. ECM, qui a grandement contribué à sa notoriété au-delà même des cercles du «classique» depuis sa création voici trente ans et qui a d’ailleurs inauguré avec lui ses New Series en 1984, se devait d’être au rendez-vous. C’est chose faite d’abord avec le retour de la Special Edition publiée pour le soixante-quinzième anniversaire du compositeur estonien: rien de bien neuf, donc, d’autant qu’il s’agit de l’enregistrement (avec Kremer, Jarrett, Russell Davies...) de pièces très célèbres, toutes écrites en 1977 (Cantus, Fratres, dans les versions pour violon et piano de 1980 et pour douze violoncelles de 1982, et Tabula rasa, qui donne son titre à l’ensemble). Mais la publication, sous forme de livre, est particulièrement soignée puisqu’elle comprend, outre le texte et les photos de l’album original ainsi qu’une courte introduction de Paul Griffiths (en allemand et en anglais), la partition intégrale des quatre œuvres et la reproduction du manuscrit de deux d’entre elles (1275). Cette année, Manfred Eicher, fondateur de la maison d’édition munichoise, y va aussi de son hommage, présentant «Musica Selecta»: en deux disques, une compil des très nombreux albums qu’il a dédiés à Pärt, avec ses interprètes d’élection, pour dix-sept morceaux de musique vocale, chorale, instrumentale et orchestrale composée entre 1976 et 2011 (481 1905).
Mais celui qui souhaitera disposer d’un panorama plus étendu de l’œuvre de Pärt, c’est-à-dire couvrant les périodes antérieures à sa conversion, dans la première moitié des années 1970, à la religion orthodoxe et à l’adoption de son style «tintinnabuli» qui fait les délices d’ECM, devra se tourner vers d’autres publications. En premier lieu, un album regroupe, sous le titre «The Sound of Arvo Pärt», deux disques enregistrés entre 2000 et 2003 pour Virgin et un entre 1993 et 1996 pour EMI, respectivement sous la direction de Paavo Järvi (né en 1962) – dans le sillage de son père Neeme, qui a aussi enregistré des œuvres de son compatriote (Bis) – et de Tõnu Kaljuste (né en 1953). Depuis le néoclassicisme de l’élève de Tormis et d’Eller à la fin des années 1950, soumis aux canons de l’esthétique officielle (cantate Notre Jardin), jusqu’à l’avant-gardisme le plus débridé (Pro et contra, Deuxième Symphonie) en passant par le sérialisme (Première Symphonie «Polyphonique»), le premier disque illustre les quinze premières années créatrices de Pärt dans toute leur diversité et leur verdeur – comme Penderecki, il figurait alors parmi les novateurs les plus hardis dans des pays où il ne faisait pas bon l’être. L’anthologie est d’autant plus complète que le second disque de Järvi associe à la grande œuvre de transition – la Troisième Symphonie (1971) – les pages plus récentes d’un Pärt plus familier. Quant à Kaljuste, il donne un florilège tout à fait représentatif de la musique chorale, auquel s’ajoutent la violoniste Tasmin Little et le pianiste Martin Roscoe dans Spiegel im Spiegel (1978). Hélas, trois fois hélas, il n’a pas été jugé utile d’éclairer ce passionnant programme par une notice (Erato 825646080731).
L’éditeur néerlandais Zefir propose pour sa part une nouveauté rassemblant l’intégrale de la musique pour piano et de la musique pour violon et piano. Marcel Worms (né en 1951) s’attaque donc à ces très courtes pages solo – aucune ne dépasse 4 minutes, y compris le fondateur Pour Alina de 1976). Isolées ou en recueil, parfois destinées à la jeunesse, comme les Quatre Pièces de danse faciles (1959) ou le plus récent Pour Anna Maria (2006), elles témoignent aussi de la très grande variété des premières années du compositeur, entre la prudence académique des deux Sonatines (1958-1959), le néoclassicisme de la Partita (1958) et le pointillisme wébernien de Diagramme (1964), sans compter un Pärt totalement inattendu dans la Valse Ukuaru (1973/2010) d’après une musique pour le film éponyme. Le pianiste néerlandais accompagne la violoniste allemande Ursula Schoch (née en 1971), membre de l’Orchestre du Concertgebouw, dans trois pages plus célèbres, dont il existe bon nombre de versions pour d’autres formations instrumentales: on retrouve ainsi Spiegel im Spiegel aux côtés de l’incontournable Fratres mais aussi de la Passacaille (2003), le tout joué avec un fort sens dramatique qu’on ne prête pas nécessairement à ces partitions (ZEF 9641). SC
Attention! Un concerto de Grieg peut en cacher un autre...

Amateurs d’Edvard Grieg, ne vous fiez pas à la couverture de ce disque, bien ringarde, et osez en faire l’achat! La belle interprétation du célèbre Concerto en la mineur, composé en 1868, interpelle par la version utilisée ici – celle publiée par Percy Grainger en 1919. Le compositeur australien se lia en effet d’amitié avec le maître un an avant sa mort, recueillant ses propres corrections et en proposant de nouvelles. A l’écoute, seuls les puristes sauront en percevoir les infimes nuances, essentiellement identifiables dans la cadence, tandis que l’interprétation sans rubato se rappelle que le compositeur haïssait les variations de tempo. Mais plus encore que sur ce Concerto bien connu, c’est sur l’autre œuvre gravée ici, due à Helge Evju (né en 1942), que l’on s’attardera. L’origine de ce disque vient de la publication dans les années 1990 de fragments d’un Concerto pour piano en si mineur esquissé par Grieg en 1883. Des extraits d’une durée d’à peine trois minutes, dévoilés sur ce disque, qui vont servir de base, en 1998, à l’élaboration d’un Concerto dans le style de Grieg. Incontestablement, Evju a su relever le défi, embrassant la veine romantique généreuse de son compatriote – particulièrement dans le superbe Adagio, à écouter en priorité. Cette première mondiale du nouveau Concerto bénéficie du piano engagé de Carl Petersson (né en 1981), impérial dans cet enregistrement et parfaitement épaulé par un superlatif Orchestre symphonique de la Radio de Prague, sous la direction de Kerry Stratton. Une belle découverte, un rien trop courte (56’35), qui aurait mérité l’ajout de la version pour deux pianos du Concerto d’Evju (Grand Piano GP689). FC
Plongée au cœur du Sistema

Tricia Tunstall a exploré «El Sistema» de l’intérieur, se rendant sur place, au Venezuela, jusque dans certains centres reculés, appelés nucleos, pour mieux comprendre le fonctionnement de cet extraordinaire programme d’éducation musicale. Dans ce long reportage, rédigé à la première personne du singulier et intitulé Changer des vies par la pratique de l’orchestre (Gustavo Dudamel et l’histoire d’El Sistema), l’auteur saisit l’état d’esprit positif qui anime ces jeunes échappant à la pauvreté et à la violence grâce à la pratique de la musique, travaillant sans relâche et dans un bel élan collectif, sans entrer en compétition, chacun ayant toujours quelque chose à apprendre, à l’autre et de l’autre. Parmi ces musiciens émergent quelques figures majeures, comme, bien sûr, Gustavo Dudamel, ambassadeur du Sistema à travers le monde et aujourd’hui directeur musical du Philharmonique de Los Angeles. L’auteur aborde également les projets inspirés du programme aux Etats-Unis, ceux-ci demeurant sans commune mesure avec celui du Venezuela – Cécile Roure, la traductrice de cet ouvrage paru en 2012 chez W. W. Norton & Company, consacre un appendice aux démarches similaires en France. Transparaît également la figure du fondateur, qui se lança dans l’aventure il y a quarante ans avec trois fois rien: José Antonio Abreu, homme visionnaire, infatigable, jamais à court d’idées. Sans être un modèle de littérature, d’une lecture parfois monotone, ce livre qui en dit long sur les vertus de la persévérance et de la solidarité devrait être médité par nos élus, et pas uniquement ceux en charge de la culture et de l’éducation (Symétrie) SF
Filippo Marchetti, dans l’ombre de Verdi

Cette superbe réédition permet de découvrir l’un des contemporains italiens largement éclipsé par le génie verdien, Filippo Marchetti (1831-1902). Le natif de la région des Marches est en réalité de la génération de Ponchielli (Boito venant ensuite), tandis que celle des années 1850 et suivantes va réussir à s’imposer largement, de Catalani à Leoncavallo en passant par Mascagni, sans parler de Puccini. Ce Ruy Blas, chef-d’œuvre de son auteur, mérite pourtant davantage qu’une écoute polie. Créé en 1869, dans la foulée de La Force du destin, l’œuvre directement adaptée du drame hugolien étonne par sa variété – des grands ensembles aux duos – il est vrai magnifiés ici par des interprètes hors pair, hormis le chœur masculin, dépassé dans les accélérations. C’est surtout Dimitria Theodossiou qui impressionne par la rondeur de sa voix, tandis que l’incandescence de ses graves rappelle parfois Maria Callas. Une des belles découvertes de ce disque enregistré en public à Jesi en septembre 1998. A ses côtés, les interprètes masculins, même s’ils fatiguent un peu au cours de la représentation, se montrent à la hauteur. Alberto Gazale compense ainsi un timbre un peu terne par une ligne de chant et une force de conviction admirables. De même pour Mario Malagnini, à l’aigu serré, mais incomparable d’engagement lui aussi. Un très beau document, magnifiquement capté, dont on pourra seulement regretter l’absence de livret et surtout l’amputation d’une partie de l’opéra (album de deux disques GB 2237/38-2). FC
Gidon Kremer au service de Kancheli

Le beau violon de Gidon Kremer met en valeur les finesses sonores de Chiaroscuro (2010-2011) de Giya Kancheli (né en 1935), tout comme sa direction du Kremerata Baltica. Augmentées d’une grosse caisse vigoureuse, les cordes soulignent cependant sans ménagement les traits violemment percussifs qui ressortent sans préparation du tissu orchestral à la manière abrupte habituelle chez le compositeur géorgien. Pour violon, piano, vibraphone, grosse caisse et cordes, la version orchestrale de Chiaroscuro fait alterner l‘ombre et la lumière, comme son titre l’indique, par l’alternance de tempos lisses, lents et rêveurs aux scintillements de vibraphone, et de tempos pulsés presque martelés, les écarts dynamiques passant soudain d’une douceur extrême à une puissance fracassante. Typiques de leur auteur, les sonorités modales à majorité consonantes s’écoulent par modulation dans une lente germination qui peut friser une dissonance jamais abrasive. La charge émotionnelle chez Kancheli est toujours très grande et l’existence d’un programme douloureux intime n’est pas à exclure. Le programme de Twilight (2004) pour deux violons, alto, synthétiseur et orchestre à cordes, est explicite: c’est une méditation sur la mortalité fondée sur la métaphore des évolutions saisonnières. La pièce se construit selon les mêmes caractéristiques que la première mais les juxtapositions brutales s’effacent en faveur de transitions plus graduelles aux crescendos étirés. Le violon engagé de Patricia Kopatchinskaja rejoint celui de Kremer, toujours à la tête du Kremerata et, que l’on adhère ou non à ces œuvres ressenties mais très typées, l’interprétation est en tout point de haut niveau (ECM New Series 481 1784). CL
Donizetti à son meilleur, mais pas la production

Parmi les soixante-et-onze opéras du très productif Donizetti, Maria di Rohan (1843), créé cinq ans avant sa mort dans la foulée de Don Pasquale, se situe parmi les tout derniers. Le compositeur lombard est à son meilleur, autour d’une œuvre qui allie classiquement le drame historique avec les déchirements amoureux individuels. La production présentée ici, de bonne qualité technique, a été captée en 2011 au festival de Bergame. Pas de grandes satisfactions à attendre au niveau scénique, qui se contente d’un décor unique pendant toute la représentation. Assez réussi visuellement, il offre malheureusement peu de possibilités de déplacement à ses interprètes en costumes d’époque, tous cantonnés en des espaces revisités selon les actes grâce aux accessoires – des incontournables statues au classique cabinet de travail. Autour de cette mise en scène classique et sans surprise de Roberto Recchia, l’interprétation est dominée par un Marco Di Felice impressionnant en Enrico. Voix profonde, bien projetée, il excelle dans son autorité naturelle, un peu moins dans la variété des couleurs. A ses côtés, Salvarore Cordella (Riccardo) déçoit par sa justesse relative, particulièrement dans les attaques de phrasés. Si Majella Cullagh (Maria) se montre plus à l’aise techniquement, son timbre aigre n’est pas des plus charmeurs. A noter que le DVD ne comporte ni livret, ni sous-titres en français. Pour un compte rendu en anglais de cette publication, lire par ailleurs sur notre site (Bongiovanni AB 20028). FC
Gounod symphoniste
 
Si les grands ouvrages lyriques de Gounod restent fermement installés au répertoire des maisons d’opéra, on ne peut pas dire que les deux Symphonies (en ré et en mi bémol – il existe par ailleurs une délicieuse Petite Symphonie en si bémol de 1885 pour nonette d’instruments à vent) aient acquis ce statut au concert. Si elles ne sont certes pas totalement inconnues, elles mériteraient une audience comparable à celle de la Symphonie en ut de Bizet (qui s’inspira d’ailleurs de la Première), d’esprit voisin et exactement contemporaine (1855). Heureusement, elles sont bien représentées au disque, avec encore deux nouvelles versions qui les défendent de manière fort convaincante, quoique de manière très différente.
En studio à Lugano (2011 et 2012), Oleg Caetani (né en 1956), avec l’Orchestre de la Suisse italienne, ne cherche pas à faire oublier que, malgré le style, on se situe bien au milieu (et non pas au début) du XIXe: une direction fine et charmeuse, d’un parfait équilibre, rend pleinement justice à cette musique dont l’absence de prétention n’est nullement synonyme de médiocrité. Atout supplémentaire de ce disque: le chef italien a pu avoir accès, grâce à la famille Gounod, au manuscrit d’une Troisième Symphonie (en ut) beaucoup plus tardive (vers 1890-1892, donc peu avant la mort du compositeur). Enregistrée ici pour la première fois, elle est hélas inachevée, comprenant un fragment (introduction Andante molto maestoso et exposition Moderato) de premier mouvement et un deuxième mouvement (Andante) complet. Si l’écriture – notamment harmonique – a grandement évolué, elle ne traduit pas la même ambition que les grandes œuvres françaises contemporaines de Franck, Chausson ou, bientôt, Dukas, et le modèle classique reste très prégnant. Mais la découverte n’en est pas moins importante et captivante (CPO 777 863-2).
Gordan Nikolitch (né en 1968), bouillonnant concertmaster de l’Orchestre symphonique de Londres, est aussi directeur artistique (et premier violon) de l’Orchestre de chambre des Pays-Bas depuis 2005. Avec cette formation peut-être moins nombreuse et certainement moins charnue, il met davantage en valeur l’ascendance de Haydn, du premier Beethoven, de Schubert et de Mendelssohn – le répertoire de la Société des concerts du Conservatoire, pour laquelle ces œuvres avaient été écrites. En concert (février 2013), la Première emporte encore davantage l’adhésion que la Deuxième, réalisée quant à elle en studio (juin 2014): avec humour et vivacité, le violoniste prend sans doute davantage de risques, mais ils se révèlent payants (Tacet 214). Entre le velouté de Caetani et le peps de Nikolitch, Gounod bénéficie d’éclairages très contrastés et l’auditeur d’un véritable choix – mais faut-il choisir? SC
Le ravissement Ibert

Encore une belle réédition signée Naxos, cette fois d’un enregistrement paru chez Marco Polo en 1993. On retrouve les forces du très bon Orchestre symphonique de la radio slovaque, jadis dirigé par Ľudovít Rajter, autour de quatre œuvres centrées sur la période d’activité de Jacques Ibert (1890-1962) à la villa Médicis à Rome, ainsi qu’une autre plus tardive de 1942, la Suite élisabéthaine. Cette œuvre composée dans le style néoclassique comporte pas moins de quatre morceaux adaptés de compositeurs anglais (Blow, Bull, Gibbons et Purcell pour le Finale) sur les neuf au total, auquel Ibert adjoint notamment une admirable «Chanson des Fées», délicatement interprétée par la soprano Daniela Kubrická. Principalement symphonique, cette œuvre délicieuse mériterait de figurer au répertoire des orchestres français. Avec La Ballade de la geôle de Reading (1921), tout premier des envois de Rome, un an avant Escales, c’est davantage vers Ravel qu’Ibert se tourne, faisant preuve de ses qualités d’orchestrateur mâtinées d’une légèreté toute française. Les trois pièces du ballet Les Rencontres (1922) restent dans cette optique, mais c’est surtout le petit poème symphonique Féerique (1924) qui ravit par ses effluves aussi évanescentes qu’envoûtantes. Ultime petit bijou gravé sur ce disque avec le Chant de folie, tout dernier envoi de Rome en 1924, dédié à Koussevitzky. On retrouve le Chœur utilisé à la manière du Honegger du Roi David, accompagné d’un grand orchestre symphonique. Avec un sens de l’élégance qui n’en oublie pas la construction narrative, le compositeur et chef d’orchestre suisse Adriano (né en 1944) se régale de ces œuvres incontournables du maître français. Un très beau disque pour parfaire la découverte de ce compositeur, quelques mois après la réussite chez Timpani d’une autre gravure due à Jacques Mercier (8.555568). FC
Londres honore Walton

A l’image des principales personnalités du Groupe des Six en France ou de son ami Hindemith en Allemagne, William Walton (1902-1983) ne resta que peu de temps le provocateur avant-gardiste du surréaliste «divertissement» Façade et ne tarda pas à devenir une figure de la vie musicale britannique. Bien qu’ayant pris du recul en s’établissant définitivement à Ischia dès le milieu des années 1950, il eut ainsi droit, pour son soixante-dixième anniversaire, à un dîner officiel offert 10 Downing Street par le Premier ministre (et chef d’orchestre à ses heures) Edward Heath ainsi qu’à un concert dirigé par André Previn (né en 1929) au Royal Festival Hall. Dix ans plus tard en ce même lieu, devant les caméras de Humphrey Burton, c’est un octogénaire impérial et hiératique mais fatigué que célèbre de nouveau le chef américain, familier du compositeur – il lui a ainsi commandé une (troisième) symphonie qui ne vit hélas jamais le jour. A la tête de l’Orchestre symphonique de Londres, dont il fut le chef principal de 1968 à 1979, il débute ce «London Concert», après le God Save the Queen de rigueur, avec la marche Orb and Sceptre (1953), écrite pour le couronnement d’Elizabeth II. Des images du carrosse royal apparaissent en incrustation: de fait, Walton s’inscrit ici bien dans la lignée des marches elgariennes. C’est aussi la tradition anglaise, celle de l’oratorio, qui inspire Le Festin de Balthazar (1931/1948), mais elle est revisitée par un instrumentarium élargi (cuivres en abondance, saxophone alto, enclume...) et, surtout, par une luxuriance et une sauvagerie qui pourraient rappeler La Tragédie de Salomé de Schmitt: œuvre dense, où s’exprime un formidable talent d’orchestrateur, et où le baryton Thomas Allen (né en 1944) impose sa haute stature vocale. Entre ces deux démonstrations spectaculaires, Kyung-Wha Chung (née en 1948) s’implique avec une grande énergie dans le Concerto pour violon (1939/1943), qui n’a pas grand-chose à envier, à la même période, à celui de Barber: destiné à Heifetz, il révèle en effet une autre facette de Walton, le mélodiste (Arthaus Musik DVD 109110 ou Blu-ray 109111). SC
Tannhäuser à Bayreuth: journée portes ouvertes entreprises

Pour Sebastian Baumgarten, l’action de Tannhäuser se déroule dans une entreprise de recyclage (voir le compte rendu des représentations en 2012): un dispositif impressionnant mais ce fatras de concepts malaisés à interpréter accapare l’attention au détriment de la musique, la scène s’animant longuement avant chaque acte, puis finit par lasser, malgré l’intensité de la direction d’acteur. C’est assez laid et parfois grotesque: que Vénus apparaisse enceinte et déguste une sucette de manière suggestive ou qu’une vidéo montre des spermatozoïdes tentant de percer un ovule passe encore, mais quel sens faut-il accorder, dans le premier acte, à ces espèces de raies géantes qui dodelinent en entendant chanter Tannhäuser? Et dire qu’il faut patienter sur une liste d’attente pendant de longues années pour voir tout ça... Musicalement, en tout cas, rien à redire: profondément engagés, Torsten Kerl (Tannhäuser), Camilla Nylund (Elisabeth), Michelle Breedt (Vénus), Markus Eiche (Wolfram) et Kwangchul Youn (Landgrave) composent de beaux personnages et se montrent impressionnants d’autorité vocale tandis qu’Alex Kober dirige, dans un souffle puissant et romantique, un orchestre impeccable (album de deux DVD Opus Arte OA 1177 D ou un Blu-ray OA BD7171 D). SF
Au cœur de la tradition de la Philharmonie tchèque
 
Deux parutions récentes honorent la Philharmonie tchèque, enregistrée dans la spacieuse acoustique de la salle Smetana de la Maison municipale (1905-1912), édifiée quelques années seulement après la fondation de l’orchestre en 1894: avec les deux chefs qui ont le plus marqué son existence parmi les successeurs de Talich, Kubelík et Ancerl, elle s’illustre dans les trésors nationaux qui ont grandement contribué à établir sa réputation.
En 1986, c’est d’abord Václav Neumann (1920-1995), peu de temps avant la fin de son long mandat (1968-1989) commencé au lendemain de la répression du Printemps de Prague et achevé l’année de la Révolution de velours. Captés en concert par une caméra un peu hésitante, Taras Bulba de Janácek et Le Pigeon des bois de Dvorák n’apprennent rien de neuf quant aux affinités que les interprètes entretiennent avec ces compositeurs: une vérité stylistique et instrumentale inspirée par une direction empathique, avec un effectif dont tous les pupitres sont généreusement renforcés. Toujours en coproduction avec la Radio bavaroise mais dans une salle cette fois-ci vidée de son public, le bonus est au moins aussi long que le programme proprement dit: précédé d’une brève introduction (en allemand) par le chef, c’est un bouquet de trois valses et trois marches de Julius Fucík (1872-1916), un Johann Strauss tchèque dont la musique est bien plus célèbre que le nom – l’Entrée des gladiateurs (1897) a pourtant retenti sur toutes les pistes de cirque du monde. Si les bulles sont moins légères qu’à Vienne le 1er janvier, les gags sonores et visuels n’en sont pas moins de mise, comme l’enclume dans Les Joyeux Forgerons du village (Arthaus Musik DVD 109121 ou Blu-ray 109122).
En 2014, l’orchestre s’est féminisé mais c’est encore de grande tradition nationale qu’il s’agit avec le concert d’ouverture de la soixante-neuvième édition du Printemps de Prague: comme chaque année en effet, le festival s’ouvre le 12 mai, jour anniversaire de la mort de Smetana, avec l’intégralité des six poèmes symphoniques de son cycle Ma Patrie. Le moment est toujours à la fois solennel et festif, chargé de symboles comme une dernière nuit des «Proms», même si la ferveur du public s’y exprime de façon certes beaucoup moins extravertie et si ce concert, au demeurant, n’est pas nécessairement l’apanage de la Philharmonie tchèque ni même d’un orchestre tchèque. Directeur musical et chef principal de 1990 à 1992 et, de nouveau, depuis 2012, Jirí Bělohlávek (né en 1946) a lui aussi choisi un effectif énorme, ce dès les six harpes de Vysehrad: l’émotion ne jaillit pas volontiers de cette interprétation magnifiquement maîtrisée, peut-être un peu paralysée par l’occasion quoique sachant user de ressorts dramatiques tout à fait efficaces, notamment dans Sarka, avec la musicalité idéale des soli du clarinettiste Frantisek Bláha (DVD EuroArts 2022758). SC
Gade dans les pas de Mendelssohn

Retour à Mendelssohn pour Thomas Albertus Irnberger (né en 1985), incontournable artiste pour la firme autrichienne Gramola, à l’aise aussi bien dans le répertoire concertant (Schumann, Dvorák, Goldmark, Richard Strauss, entre autres) qu’en musique de chambre. Voilà trois ans, le violoniste salzbourgeois s’intéressait au Premier Concerto pour violon de Mendelssohn, une œuvre de jeunesse composée en 1822. Place cette fois au chef-d’œuvre de la maturité, pour une version soutenue par l’archet conquérant d’Irnberger dans les tutti, malheureusement plus étriqué dans les passages lents. C’est face à l’Orchestre symphonique de Jérusalem, dirigé par Doron Solomon, que le jeune violoniste se montre à son meilleur, dialoguant avec une belle conviction, en des tempi très vifs. L’intérêt de ce disque réside surtout dans le rare Concerto pour violon de Niels Gade, une œuvre beaucoup plus tardive datant de 1880. Le compositeur danois s’est peut-être souvenu qu’il avait lui-même assuré la création du Concerto de Mendelssohn en 1845, tant l’influence de ce dernier semble patente. Outre cette inspiration indéniable, on reconnaît l’élan d’un Schumann, même si Gade manque par trop d’inspiration mélodique. Toute l’écoute s’avère ainsi agréable mais ne résiste pas à la durée, faute d’originalité. Les interprètes, tous de bon niveau, ne sont pas en cause: l’histoire de la musique, oublieuse, n’est pas toujours injuste (SACD 99075) FC
Brahms symphonique mais sans symphonies

Brahms a composé des œuvres de musique symphonique presque aussi importantes – en volume, sinon en qualité – que ses quatre Symphonies et, pour l’essentiel, antérieures à celles-ci. Certaines d’entre elles sont bien connues, comme la version pour orchestre des Variations sur un thème de Haydn ou bien les deux Ouvertures, mais les deux Sérénades demeurent en revanche injustement dans l’ombre. Ayant eu la bonne idée de rassembler ces cinq partitions (auxquelles auraient pu être adjointes l’orchestration par Brahms lui-même de trois de ses Danses hongroises), Brilliant Classics a essentiellement puisé pour ce faire dans le catalogue est-allemand de Berlin Classics, dont on retrouve ici deux des piliers. Heinz Bongartz (1894-1978), l’un des maîtres de Kurt Masur, a enregistré les Sérénades au début des années 1960 à la tête de la Philharmonie de Dresde, dont il fut le Chefdirigent de 1947 à 1963: dans une prise de son cotonneuse, il confère un statut symphonique à ces pages qu’on joue aujourd’hui avec davantage de légèreté, notamment dans les menuets. Günther Herbig (né en 1931) succéda à Masur au Philharmonique de Dresde – à ne pas confondre avec la Staatskapelle – mais c’est ici avec l’Orchestre symphonique de Berlin (devenu depuis 2006 Konzerthausorchester Berlin), dont il fut le Chefdirigent de 1977 à 1983, qu’il donne à la fin des années 1970 les Variations Haydn et l’Ouverture tragique, deux versions où, à la différence de Bongartz, la tradition semble l’emporter sur la personnalité. Fait bizarrement exception à ces archives de l’ex-RDA la très dispensable Ouverture académique, dans une interprétation très convenable du Symphonique de Londres dirigé en 1989 par Rafael Frühbeck de Burgos (1933-2014), qui fut lui aussi – décidément – l’un des directeurs musicaux de la Philharmonie de Dresde (album de deux disques 95073). SC
L’Enlèvement au sérail: luxueux ratage

Dans cet Enlèvement au sérail de Mozart, on aura beau insister sur la direction de Yannick Nézet-Séguin à la tête de l’Orchestre de chambre d’Europe, d’une clarté irrésistible dans l’aigu, d’une imagination inépuisable dans le soutien mélodique et rythmique, sans parler de la délicatesse de l’enchevêtrement des timbres ou de l’intelligence des phrasés: quand les voix sont absentes d’un opéra, particulièrement de l’un de ceux dont on ne manque pas de versions réussies, tout le projet tombe à plat. Premier écueil, assez incompréhensible tant il est évident dès les premières notes, la prestation catastrophique de Diana Damrau (Constance). Ligne de chant instable du fait d’une voix trop lourde, incapacité à maîtriser les vocalises ou à respecter la nécessaire justesse dans l’aigu: les griefs sont nombreux et rapidement insupportables, et ce alors que la même Damrau s’en sortait beaucoup mieux en Lucia en début d’année. A ses côtés, Rolando Villazón (Belmonte) fait ce qu’il peut avec une voix à l’émission étroite, sans substance, par ailleurs bien trop forcée dans l’aigu. Il lui reste pour autant une musicalité autrement plus fine que Damrau, mais le compte n’y est pas. Seul Franz-Josef Selig (Osmin) sauve la mise parmi les interprètes principaux, dévoilant un soyeux de timbre et une force de conviction à la hauteur des ambitions de ce disque. Trop peu, hélas, pour en conseiller l’achat (coffret de deux disques Deutsche Grammophon 479 4064). FC
Così: de Zurich à Salzbourg

A la fin du mandat de Franz Welser-Möst à Zurich, Sven-Eric Bechtolf y avait monté la «trilogie Da Ponte» entre 2006 et 2009 (voir ici). Alexander Pereira était alors l’intendant de la maison zurichoise: une fois investi des mêmes fonctions à Salzbourg (2012-2014), il a confié de nouveau la trilogie à cette même équipe artistique, décors, costumes et lumières compris. Le chef a cependant déclaré forfait, invoquant un planning de représentations trop serré: dès ce Così fan tutte d’août 2013, il a été remplacé par Christoph Eschenbach, qui, comme dans Don Giovanni, quoique peut-être à un degré moindre, l’été suivant, tend à ralentir et à raidir le déroulement de la partition. Le metteur en scène allemand, comme à Zurich en 2009, défend un concept original avec une fin inhabituelle – mais ce n’est pas le même: il suffira de dire qu’il souligne l’échec des théories rationalistes de Don Alfonso, qui n’a pas anticipé la victoire de la déraison. Pour ce faire, le livret n’est pas détourné, bien au contraire: la direction d’acteurs l’exploite habilement, faisant ressortir des angles d’attaque drôles ou inventifs. Le décor unique d’immense jardin d’hiver et les costumes XVIIIe (sauf pour le chœur), s’ils ne sont pas tout à fait aussi chics et confortables que dans Don Giovanni, n’ont cependant guère dû désarçonner le festivalier. Vocalement, le plateau se tient bien, davantage du côté des femmes avec Malin Hartelius en Fiordiligi, Marie-Claude Chappuis en Dorabella et Martina Janková, Despina plus corsée qu’à l’accoutumée. Chez les hommes, Luca Pisaroni en Guglielmo et Gerald Finley en Don Alfonso offrent de bonnes compositions, mais le maillon faible de la distribution est le Ferrando de Martin Mitterrutzner, très en difficulté dans l’aigu (EuroArts album de deux DVD 2072748 ou un Blu-ray 2072744). SC
La clémence d’Aureliano

Le décor d’un autre âge de cet Aureliano in Palmira (1813) à Pesaro l’été dernier ne présente guère d’intérêt, Mario Martone se contentant d’une direction d’acteur sommaire – pas de transposition ni de terroriste. C’est cependant tout juste suffisant pour cet opéra qui tire en longueur mais qui présente un intérêt indéniable pour les inconditionnels de Rossini, quelques pages illustres se retrouvant dans Le Barbier de Séville. Vocalement, c’est de haut niveau. Le phénoménal Michael Spyres (Aurélien) et la fabuleuse Jessica Pratt (Zénobie) comptent parmi les meilleurs interprètes du compositeur. Lena Belkina, au minois trop charmant pour croire tout à fait au mâle tempérament d’Arsace, met en valeur un beau timbre et respecte les canons du chant rossinien. Raffaella Lupinacci a quelque chose de substantiel à chanter seulement à la fin, mais elle démontre un art du chant accompli dans le rôle de Publia. Auteur d’une édition complète de ce dramma serio, Will Crutchfield dirige en fin connaisseur un orchestre vif, net et avenant, malgré des cuivres parfois imprécis. Le chef américain se profile en héritier spirituel d’Alberto Zedda, retiré de la direction artistique du festival Rossini de Pesaro depuis cette année (album de deux DVD Arthaus Musik 109073 ou un Blu-ray 109074). SF
Trionfi d’Orff: le triomphe de Kegel

Déjà rééditée chez Berlin Classics, l’intégrale des Trionfi de Carl Orff dirigée par Herbert Kegel (1920-1990) abandonne sa belle couverture de velours marron pour revenir dans une présentation plus habituelle et encore plus économique chez Brilliant Classics. Même si l’intérêt des Catulli carmina et, bien davantage, du Trionfo di Afrodite n’est pas comparable à celui des Carmina burana, ces enregistrements de la première moitié des années 1970 méritent d’être connus car on y retrouve le sens dramatique typique du chef allemand, qui se conjugue à une totale absence de complaisance, tout à fait bienvenue dans cette musique. Les prestations vocales des solistes sont inégales, mais l’important est que tous les chanteurs jouent le jeu d’un Orff expressionniste, qui rappelle ainsi, plus qu’à l’accoutumée, Stravinski ou le modernisme allemand de l’entre-deux-guerres (album de deux disques 95116). SC
Luther à Worms de Meinardus: une version d’attente
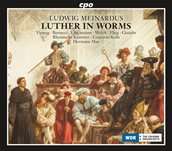
Pilier parmi les chefs fidèles à l’éditeur CPO, l’Allemand Hermann Max (né en 1941) s’est principalement illustré dans la musique religieuse du XVIIIe siècle, avec de plus rares incursions au XIXe siècle – de Ries à Bruch. C’est encore le cas cette année avec l’enregistrement de Luther à Worms, le plus important succès rencontré par Ludwig Meinardus (1827-1896) au cours de sa carrière. Ce compositeur conservateur proche de Liszt aura eu la chance de voir son chef-d’œuvre créé en 1874 par le maître hongrois, dans la ville de Weimar. Agréablement varié et assez inspiré au niveau mélodique, cet oratorio rappelle la manière de Mendelssohn, sans jamais chercher à sortir du moule romantique. Pour intéressante qu’elle soit, cette œuvre pâtit de l’interprétation trop placide de Max, d’habitude plus inspiré avec son bel ensemble de la Rheinische Kantorei, ici accompagné par un sage Concerto Köln. Si l’idée de proposer une version chambriste, aérée et allégée, avait de quoi séduire, force est de constater que cette lecture manque de ferveur, tandis que les solistes, corrects, ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu. Une version d’attente acceptable, mais l’on aimerait qu’un Bernius ou un Spering se penche sur cet oratorio pour en proposer une approche plus stimulante (album de deux disques 777 540-2). FC
Association Beethoven France: pari tenu

En fin d’année dernière, l’Association Beethoven France avait fait appel à un financement participatif pour assurer la parution du dix-septième numéro de sa revue, fondée en 2003: objectif atteint dès le 18 janvier 2015 pour une parution avant l’été. Conformément au sommaire projeté, et dans le droit fil de la ligne éditoriale de cette publication, des aspects négligés et peu connus de la vie et de l’œuvre du compositeur sont mis en lumière: la longue amitié avec (Nikolaüs) Zmeskall (von Domanovecz), pour débuter une série consacrée à «Beethoven et son entourage»; la musique de scène pour Egmont de Goethe, au travers d’un dossier complet; la suite de l’analyse très détaillée de la Missa solemnis par Bernard Fournier; un subtil article «Beethoven et l’humour», abondamment illustré d’exemples musicaux. Mais on découvrira aussi une très minutieuse présentation des tout premiers enregistrements beethovéniens sur cylindres (essentiellement français), à la toute fin du XIXe, et la suite d’une longue étude sur les productions théâtrales mettant en scène le personnage de Beethoven. Pointu et érudit, sans doute, mais toujours passionné et passionnant. SC
La rédaction de ConcertoNet
|