|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de mai
05/15/2015
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Claude de Thierry Escaich Claude de Thierry Escaich
 Karl Böhm dirige à Salzbourg Karl Böhm dirige à Salzbourg
 Le Conte d’hiver de Christopher Wheeldon Le Conte d’hiver de Christopher Wheeldon
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 David Geringas interprète Balakauskas David Geringas interprète Balakauskas
 Keith Jarrett dans Barber et Bartók Keith Jarrett dans Barber et Bartók
 Edward Gardner dirige Szymanowski Edward Gardner dirige Szymanowski
 Christian Zacharias interprète Beethoven Christian Zacharias interprète Beethoven
 John Storgårds dirige Zemlinsky John Storgårds dirige Zemlinsky
 L’ensemble de cuivres Namestra L’ensemble de cuivres Namestra
 Hannu Lintu dirige Enesco Hannu Lintu dirige Enesco
 Cornelius Meister dirige Strauss Cornelius Meister dirige Strauss
  Oui ! Oui !
Martha Argerich et ses amis interprètent Bach
Symphonies de Hoffmann et Witt
Edward Gardner dirige Mendelssohn
Il Guarany de Gomes
Roman Válek dirige F. X. Richter
Autobiographies de Telemann
Mariss Jansons dirige Strauss
Alun Francis dirige Graener
«The Hollywood Album» de Daniel Hope
Kristóf Baráti interprète Korngold
Hervé Billaut interprète Dukas
Le Quintette (à vents) Aquilon
Avi Avital interprète Vivaldi
Mémoires de Valentin Berlinsky
Lorin Maazel chez Deutsche Grammophon
Raphaël Sévère et Adam Laloum interprètent Brahms
Le Quatuor Psophos interprète Brahms et Dohnányi
Jacques Rouvier interprète Ravel
Musique de chambre de Goubaïdoulina
Edward Gardner dirige Janácek
Simplicius de J. Strauss à Zurich (1999)
 Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Rigoletto à Zurich (2014)
Thomas Dorsch dirige Woyrsch
Cahiers de conversation de Beethoven
Andrew Davis dirige Elgar
Bernard Haitink dirige Strauss
Laurent Wagschal interprète Dukas
«The Handel Festival Collection»
Le tubiste Florian Coutet
Hilary Hahn interprète Mozart et Vieuxtemps
Le Quatuor (de saxophones) Ellipsos
JoAnn Falletta dirige Paine
La Flûte enchantée à Amsterdam (2012)
Le Gaucher de Chédrine
Le Trio Talweg interprète Brahms
Le Quatuor Gringolts interprète Brahms
Itzhak Perlman chez Deutsche Grammophon
Valery Gergiev dirige Moussorgski
Pas la peine
Le Quatuor Carducci interprète Chostakovitch
«American Songs» par Anne Cambier et Maiko Inoué
Paul Watkins interprète Brahms
Le Quatuor Chiara interprète Brahms
Les solistes du Concertgebouw interprètent Brahms
Les Quintettes à cordes de Michael Haydn
La pianiste Audrey Vigoureux
Les matchs du mois
 
Concerto pour violon de Korngold: D. Hope ou K. Baráti?
  
Une vie de héros de Strauss: B. Haitink, M. Jansons ou C. Meister?
 
L’œuvre pour piano de Dukas: H. Billaut ou L. Wagschal?
En bref
Le jeune Maazel chez Deutsche Grammophon
Itzhak Perlman: 70 bougies et 25 disques
Schnittke et ses citations
Les phrasés ensorcelants d’Avi Avital
Rouvier et l’importance de bien ar-ti-cu-ler dans Ravel
Les mémoires d’un homme de compromis
Sofia Goubaïdoulina hier et aujourd’hui
Un (Johann) Strauss peu connu
John Knowles Paine, symphoniste américain
Janácek à Bergen avec Edward Gardner
Le Moussorgski trop maniéré de Gergiev
Le tuba en vedette
Impressions de Waldteufel
Trop sage Hilary Hahn
De «miraculeuses métamorphoses» à Kansas City
L’absurde façon Chédrine
Trois quarts d’heure avec Audrey Vigoureux
Brahms le chambriste
Les quatre saxophones d’Ellipsos
Une Flûte enchantée impossible à rationaliser
L’autre Haydn
«American Songs» sans charme
Le Quatuor Carducci à la surface de Chostakovitch
Le jeune Maazel chez Deutsche Grammophon

Un technicien sans âme... avec un penchant pour la virtuosité démonstrative, voire les effets douteux… On n’a pas épargné Lorin Maazel, disparu en juillet dernier. Mais prenons garde: s’il a pu justifier cette fâcheuse réputation, il connut aussi, jusqu’à la fin de sa carrière, des moments de grâce. Et ses premières années restent dans les mémoires, ne prêtant guère le flanc à la critique. Deutsche Grammophon eut du nez et lui confia d’emblée la Philharmonie de Berlin, que Karajan ne s’était pas encore appropriée, avant qu’il ne prenne la succession de Ferenc Fricsay à la tête de l’Orchestre symphonique de la RIAS – la radio du secteur américain. Ainsi commença en 1957 une collaboration que nous rappelle le copieux coffret des «Complete Early Recordings on Deutsche Grammophon», qui succède aux compilations Sony et Decca: jusqu’en 1965, des gravures majeures où s’affirme un talent hors du commun. Les grands classiques sont revisités, décapés, anticipant souvent l’avenir. La jeune génération ne désavouerait pas ces Schubert sanguins, impatients, sveltes – ne manquent que la Première et la Neuvième Symphonie. Ni cette Cinquième de Beethoven anguleuse et sans pathos, encore moins cette Pastorale aussi fine que bondissante. Ni cette Quatrième de Tchaïkovski, où les élans de l’énergie excluent les surenchères de l’effusion. Certes, la Troisième de Brahms n’est pas encore parvenue à maturité, les Mozart peuvent passer leur chemin. Mais le Mendelssohn de l’Italienne et de la Réformation débordent de sève, de lumière et de couleurs, comme les rutilants Pins respighiens, ou les éblouissants Falla – avec la Bumbry dans L’Amour sorcier. Et le jeune Maazel montre déjà ses affinités avec la musique française: Symphonie de Franck à la fois claire et pensée, Heure espagnole et Enfant et les sortilèges de Ravel surtout, références absolues cinquante ans après, servis par un National qui alors avait du caractère, des arômes bien à lui, et des chanteurs représentants d’une école française qui n’en avaient pas moins. Accompagnés d’une très intéressante présentation, ces dix-huit disques remplacent avantageusement le coffret déjà publié sous étiquette jaune, moins complet et plus austère de présentation: voilà un bel objet, comme on dit, où ont été repris, selon l’usage récent, minutages et pochettes des anciens disques noirs (coffret de dix-huit disques 479 4306). DvM
Itzhak Perlman: 70 bougies et 25 disques

Le 31 août prochain, Itzhak Perlman fêtera ses soixante-dix ans. Trois jours plus tôt, Deutsche Grammophon aura publié son plus récent disque, consacré à Fauré et Strauss, en duo avec Emanuel Ax. L’éditeur célèbre toutefois d’ores et déjà cet anniversaire avec la réédition de l’intégralité des enregistrements réalisés – quasi exclusivement en studio – par le violoniste américano-israélien non seulement sous étiquette jaune (seize disques entre 1978 et 2001) mais aussi chez Decca, marque à laquelle la firme hambourgeoise est associée au sein d’Universal (huit disques entre 1968 et 1975, et un autre en 1994). Perlman a également travaillé pour RCA, CBS (puis Sony) et, surtout, EMI, où se trouve sans doute le meilleur de sa discographie (Concertos de Beethoven et Brahms avec Giulini, Caprices de Paganini...), et il leur a également livré d’autres facettes de sa riche personnalité artistique – sa voix de basse pour un petit rôle dans Tosca, son goût pour le crossover. Cela étant, ce coffret de vingt-cinq disques fidèles à leurs programmes – parfois courts, en raison notamment des limites inhérentes aux 33 tours – et leurs pochettes d’origine, avec un propos introductif et rétrospectif de l’artiste ainsi qu’une notice (en anglais et en allemand) de Tully Potter sur les enregistrements, n’en recèle pas moins quelques trésors.
On n’en retiendra pas principalement le domaine concertant, hormis évidemment, pour des débuts fracassants chez DG, les Concertos de Stravinski et Berg sous la direction d’Ozawa et un disque beaucoup moins connu mais non moins splendide et époustouflant avec Mehta, associant le Poème de Chausson à des pièces brèves de Ravel, Saint-Saëns et Sarasate (1986). En revanche, le reste ne s’est pas imposé: Berlioz, Elgar, Lalo, Saint-Saëns, Wieniawski avec Barenboim, une intégrale Mozart aux cadences personnelles et au spectre large (y compris les mouvements alternatifs ainsi que la Symphonie concertante pour violon et alto – en public – et le Concertone pour deux violons avec Zukerman) mais aux œillades assez datées et presque complaisantes (avec un Philharmonique de Vienne bien pâteux sous la baguette de Levine). Enfin, deux escapades dans le répertoire baroque font se succéder l’acceptable – Les Quatre Saisons (emmenées par un Mehta dynamique et partagées – en public – avec Stern, Zukerman et Mintz) – et l’ineptie kitsch – treize airs avec violon obligé extraits de cantates et de la Messe en si de Bach où, moins que le principe même d’un tel album et le style assez peu orthodoxe de Perlman, c’est Kathleen Battle qui sidère, hors sujet en Zerbinette des bénitier à l’accent improbable aussi bien en allemand qu’en latin (impossible à écouter aujourd’hui – mais l’était-ce déjà il y a un quart de siècle?).
C’est le chambriste qui est en revanche essentiellement à l’honneur, à commencer par l’intégrale des Sonates de Beethoven avec Ashkenazy, gravée pour Decca entre 1973 et 1975 (après la Sonate de Franck et le Trio avec cor de Brahms avec Tuckwell dès 1968): une entente parfaite, une même envie de jouer, une santé inépuisable font alterner puissance, énergie, sensualité et charme avec la force de l’évidence (vingt ans plus tard, les mêmes, rejoints par Harrell au violoncelle, ne renouvellement pas cette réussite dans Ravel et Debussy). Les seize dernières Sonates et deux séries de Variations de Mozart avec Barenboim (1983-1990) se situent légèrement en retrait, avec une tendance à se laisser aller au grand format et à des joliesses. Représentée par un seul disque avec un bien terne Philharmonique d’Israël (2001), l’activité de Perlman en tant que chef d’orchestre n’est guère valorisée: il accompagne mollement un Ilya Gringolts surexcité et complaisant dans le Concerto de Tchaïkovski puis le Premier de Chostakovitch (479 4708). SC
Schnittke et ses citations

Alfred Schnittke (1934-1998) compte parmi les compositeurs russes de l’après-guerre les mieux représentés au disque. Voici dans une excellente prise de son une nouvelle version de la Troisième Symphonie (1981), caractéristique du polystylisme cher à son auteur. Empruntant différents styles (notamment le jazz et la tango), cette œuvre de grande envergure et conçue pour un orchestre important comporte maintes références à plusieurs compositeurs, jusqu’à vingt dans le premier mouvement, de Schütz à Zimmermann en passant par Chostakovitch, Wagner, Hindemith ou encore Webern – les oreilles les plus exercées s’amuseront à les déceler. La symphonie se termine sur un bouleversant Adagio de vingt minutes qui rappelle la Neuvième Symphonie de Mahler. A la tête d’un excellent Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, Vladimir Jurowski livre une interprétation intense et éloquente de cette œuvre captivante, malgré l’inégalité de son inspiration (SACD Pentatone PTC5186485). SF
Les phrasés ensorcelants d’Avi Avital

2012 avait marqué les débuts réussis d’Avi Avital (né en 1978) chez Deutsche Grammophon par un disque Bach. Retour au baroque trois ans plus tard avec un album entièrement consacré à Vivaldi et des transcriptions réalisées par Avital lui-même autour du superbe Concerto pour mandoline en ut, composé la même année que les célèbres Quatre Saisons (1725). Si les transcriptions des œuvres moins connues offrent une couleur indubitablement charmante, on est moins convaincu en revanche par l’adaptation de L’Eté des Quatre Saisons, trop légère et maniérée pour réellement convaincre. Un détail tant ce disque constitue une nouvelle réussite autour des superbes phrasés du mandoliniste israélien, accompagné du clin d’œil savoureux – la conlusion en est effectivement confiée à Avital et Juan Diego Flórez dans La biondina in gondoleta, l’une des mélodies populaires que Vivaldi pouvait entendre en son temps dans les rues de Venise (479 4017). FC
Rouvier et l’importance de bien ar-ti-cu-ler dans Ravel

Indésens réédite l’intégrale de l’œuvre pour piano de Ravel par Jacques Rouvier, déjà parue en disque compact chez Calliope. Le label précise que les bandes originales, datant de 1974 et de 1975, ont bénéficié d’un traitement pour leur donner une «seconde jeunesse». La neutralité apparente de cette interprétation pudique et cérébrale déroute au premier abord mais de la poésie et de la sensibilité se dégagent de cette lecture au trait sec et précis. Le pianiste, qui partage le clavier avec Théodore Paraskivesco dans Ma mère l’Oye, cultive un jeu scrupuleusement articulé et restitue chaque partition dans les détails, sans rien concéder au spectaculaire, la musique progressant sans alanguissement ni précipitation. Cet enregistrement a reçu à l’époque le Grand Prix de l’Académie du disque français, récompense qui paraît encore justifiée aujourd’hui même s’il est bien sûr autorisé de préférer une approche différente (album de deux disques CAL1521). SF
Les mémoires d’un homme de compromis
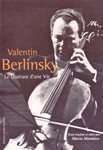
Remarquablement présenté, comme d’habitude, par Aedam Musicae, Valentin Berlinsky. Le quatuor d’une vie rassemble les mémoires de Valentin Berlinsky (1925-2008), traduits et annotés par Maria Matalaev, petite-fille du violoncelliste (et fille de Ludmilla Berlinskaïa). Ceux-ci se mêlent à des extraits de correspondance et à des entretiens entre le membre fondateur du Quatuor Borodine et Vera Teplitskaya, qui a recueilli les souvenirs de personnalités qui ont bien connu ce musicien, notamment Dimitri Chebaline, membre de la formation de 1953 à 1996. Se lisant comme un roman, malgré la disparité de son contenu, l’ouvrage plonge le lecteur dans le quotidien contraignant dans lequel les musiciens soviétiques ont dû évoluer. Berlinsky n’occulte pas les difficultés de toutes sortes auxquelles le quatuor a été confronté mais il ne manifeste aucune amertume envers son pays, qu’il a toujours refusé de quitter. Il évoque des anecdotes savoureuses et émouvantes sur des personnalités aussi importantes que Chostakovitch, Richter, Oïstrakh et Rostropovitch et parle aussi sans rancœur de quelques membres de la formation avec lesquels les rapports furent parfois tendus. Le portrait qui se dégage est celui d’un homme de compromis, épris de perfection et manifestant une haute estime de sa mission artistique. Les nombreuses annexes présentent un grand intérêt pour ceux qui s’intéressent à ce quatuor puisqu’elles comportent, outre une discographie (toujours utile pour le collectionneur), le répertoire de la formation et une liste de concerts mémorables, établie par le violoncelliste lui-même (AEM-150). SF
Sofia Goubaïdoulina hier et aujourd’hui

Sofia Goubaïdoulina (née en 1931) propose souvent des associations instrumentales rares ou inusitées qu’elle mène ensuite dans un jaillissement constant de sonorités inventives sans en occulter la charge poétique et expressive et sans s’écarter d’une écriture rigoureuse. C’était vrai en 1980 pour Garten von Freuden und Traurigkeiten, où son traitement de l’effectif debussyste innovait encore. C’est toujours le cas pour deux récentes compositions qui l’amènent à explorer les possibilités de timbres plus sombres. Un groupe d’instrumentistes d’origines différentes mais habitués à se produire ensemble dans des formations diverses présentent ici Repentance (2008) pour violoncelle, trois guitares et contrebasse – qui donne son titre à l’album – et Sotto voce (2010-2013) pour alto, contrebasse et deux guitares: l’altiste Hariolf Schlichtig, le violoncelliste Wen-Sinn Yang, le contrebassiste Philipp Stubenrauch ainsi que les guitaristes Franz Halász, Jacob Kellermann et Lucas Brar. Augmenté d’une contrebasse ténébreuse, l’intrigant Repentance dérive de Ravvedimento (2007) et exige des guitares des techniques classiques ou avancées en soutien contrasté aux cantilènes du violoncelle lyrique traité en soliste. Les oppositions entre cordes frottées et cordes pincées se déploient plus puissantes encore dans le surprenant Sotto voce polyphonique qui, sur un large ambitus, alterne entre un contrepoint complexe et deux duos ensemble mais distincts, avec une impressionnante variété d’archet et d’effets à la guitare, avec ou sans plectre, aux glissandos résonants et aux frappes percussives directement sur le bois. Deux pièces pour instrument seul du jeune âge de la compositrice russe viennent compléter le programme. Petite pièce sans prétention au-delà de son charme, Sérénade (1960) pour guitare, échoit à Franz Halász, Kellermann et Brar assumant le duo de Sotto voce. La pianiste brésilienne Débora Halász défend avec talent la sémillante Sonate pour piano (1965) si souvent interprétée et appréciée pour sa forme classique, l’intrigante exploitation d’une série dodécaphonique, les timbres inventifs et les rythmes piqués, jazziques à l’occasion (SACD Bis BIS-2056). CL
Un (Johann) Strauss peu connu

Hormis La Chauve-Souris, les nombreux ouvrages lyriques de Johann Strauss ne se sont pas vraiment imposés – c’était déjà le cas de son vivant. Il est pourtant intéressant d’y jeter un coup d’œil, comme le montrent Une nuit à Venise ou ce Simplicius (1887) monté à Zurich en 1999. On ne le connaît en effet plus guère aujourd’hui que par les six pages symphoniques, notamment la valse Donauweibchen, que le compositeur, comme à son habitude, en a tirées. L’inspiration de Strauss n’est pas aussi primesautière qu’à l’accoutumée, la rudesse de la Guerre de Trente Ans, qui sert de toile de fond au Simplicius Simplicissimus de Grimmelshausen, affleurant à moult reprise sous le livret de Victor Léon (qui écrivit ensuite La Veuve joyeuse et Le Pays du sourire pour Lehár). Il y a du Offenbach dans ce persiflage militaire grinçant, mais en même temps, le sujet – les aventures d’un chaste fol à la Parsifal tenté par les armes après avoir été élevé depuis son plus jeune âge, comme Siegfried, au fin fond d’une forêt – évoque évidemment Wagner, encore que les passages moins légers de cette opérette (qui tient souvent plus de l’opéra) en un prologue et trois actes renvoient davantage à Weber qu’au maître de Bayreuth. Face à cet ensemble dramatiquement comme musicalement assez composite, David Pountney est l’homme de la situation, enrichissant le XVIIe siècle où se situe l’action d’une de ces scénographies finement déjantées dont il a le secret, à base de gigantisme et d’anachronismes: ce baroque, comme du temps de Strauss, a donc des résonances contemporaines. Les chanteurs défendent plus que convenablement des rôles souvent difficiles, à commencer par Martin Zysset en Simplicius; dans les emplois sérieux, Michael Volle, Piotr Beczala et Elizabeth Magnuson sont à la hauteur de leur grande réputation, tandis qu’Oliver Widmer déploie une vis comica convaincante aux côtés de l’actrice vedette (et vétérane) Louise Martini. Franz Welser-Möst, qui était alors au début de son mandat zurichois (1995-2008), dirige avec sûreté une partition... dont il reprendra douze ans plus tard plusieurs extraits pour son concert du Nouvel An 2011 (Arthaus Musik DVD 100 365 ou Blu-ray 108 127). SC
John Knowles Paine, symphoniste américain

Après un premier volume paru en 2013, Naxos consacre un nouveau disque aux œuvres orchestrales de John Knowles Paine (1839-1936). Membre de l’école de Boston aux côtés de George Chadwick, Horatio Parker, Arthur Foote, Amy Beach et surtout Edward MacDowell, l’Américain donna ses premières lettres de noblesse à la symphonie américaine. Paine est l’auteur d’un corpus symphonique réduit à deux Symphonies, un prélude, une ouverture et un poème symphonique. Ce second album de JoAnn Falletta (née en 1954) et l’Orchestre de l’Ulster conclut donc ainsi l’intégrale de ses œuvres symphoniques. Le geste à l’ample respiration de Falletta exalte les couleurs et le lyrisme de la Deuxième Symphonie «Au printemps» (1879), en une direction narrative toujours intéressante, même si l’on aimerait davantage de mordant en certains passages. Sa direction met en valeur la transparence et l’élégance de la musique de Paine, qui fait immanquablement penser à Mendelssohn et Schumann. Rien d’original mais un plaisir constant à l’écoute d’un savoir-faire charmant. Les deux compléments gravés ici (le prélude Œdipe roi et la «fantaisie océane» Poséidon et Amphitrite), plus tardifs, ne sont malheureusement pas du même niveau – un certain manque d’inspiration, particulièrement au niveau mélodique. A noter que Zubin Mehta a lui aussi enregistré les deux Symphonies avec le Philharmonique de New York (Concord, 2005): en comparaison de la gravure de Falletta, Mehta perd en délicatesse ce qu’il gagne en caractère (8.559748). FC
Janácek à Bergen avec Edward Gardner

Après la quasi-intégrale de la musique orchestrale de Lutoslawski et en parallèle à celle encore en cours de Szymanowski, Edward Gardner se tourne vers la musique orchestrale de Janácek. Cette fois, il dirige l’Orchestre philharmonique de Bergen, dont il deviendra le chef principal à l’automne. Le premier volume se consacre à trois œuvres tardives parmi les plus marquantes du compositeur. Gardner obtient de la phalange norvégienne des couleurs extraordinaires et un remarquable relief orchestral. Sa vision cohérente de la Sinfonietta (1926) est une totale réussite. Les puristes regretteront peut-être l’absence d’une certaine verdeur idiomatique mais le chef anglais rend bien compte des regards poétiques que Janácek jette sur sa ville natale comme de la radieuse fanfare vif-argent née d’un souvenir ému. Sous sa baguette, l’orchestre livre avec verve des impressions touchantes et lumineuses pénétrées d’élans et d’irisations aux contours burinés et variant intensément au cours des cinq mouvements. Jean-Efflam Bavouzet les rejoint pour une interprétation souriante et fantasque du désarmant Capriccio de 1926, pour piano main gauche, piccolo, flûte, deux trompettes, trois trombones et tuba ténor. Malgré le petit effectif et l’absence de cordes, l’ensemble éloquent sonne de manière orchestrale, le piano pleinement mis en valeur. La Suite tirée de La Petite Renarde rusée (1922-1924) n’est pas celle en partie réorchestrée sur commande de Talich mais celle de Charles Mackerras, qui restitue l’orchestration originale et quelques passages initialement omis. Malgré sa pertinence, une suite ne peut livrer le caractère profond d’un opéra aussi frappant et savoureux que celui-ci mais la musique est belle et on y prend grand plaisir, quand bien même à certains timbres manqueraient les crêtes acidulées et à certains traits une fragrance de terroir ou des arêtes vives. L’interprétation reste toujours aussi vibrante, poétique et finement dessinée, bien servie par une prise de son spacieuse et claire (SACD Chandos CHSA 5142). CL
Le Moussorgski trop maniéré de Gergiev

Treize ans après une première gravure avec le Philharmonique de Vienne (Philips), Valery Gergiev remet sur le métier sa lecture des Tableaux d’une exposition de Moussorgski avec l’Orchestre du Mariinsky. On retrouve tous les tics actuels de direction propre au chef russe: ralentissement dans les mouvements lents, accélération dans les passages rapides, accentuation de la rythmique ou raideur artificielle (quasi métronomique dans la «Promenade»).Cette lecture analytique, fuyant toute effusion ou postulat narratif, différencie chaque morceau par rapport à l’autre, alternant climat morne où la mélodie s’étire («Il vecchio castello») avec un beau tempérament de coloriste («Ballet des poussins dans leurs coques»), vite rattrapé par un geste brutal dans «La Cabane sur des pattes de poule». Une partition torturée dans tous les sens pour faire du neuf, à oublier. Gergiev est plus intéressant dans les Chants et Danses de la mort (orchestrés par Chostakovitch), où il démontre ses qualités d’accompagnateur attentif. Son orchestre reste toujours à sa place pour mettre au premier plan le chant noble et serein de Ferruccio Furlanetto. En complément, une belle version d’Une nuit sur le Mont chauve, moins maniérée, avec un Gergiev très sage (SACD Mariinsky MAR0553). FC
Le tuba en vedette

Le premier disque de l’ensemble Namestra a séduit par son indéniable originalité dans la conception du programme, sans parler de la réalisation technique parfaite (voir ici). Florian Coutet figure parmi les artistes de ce disque: avec lui, place ici, sous le titre «Keep in Touch», au tuba et à ses sonorités songeuses et mystérieuses. Un méconnu Ravel (Vocalise en forme de habanera) laisse entrevoir toute la délicatesse et la sensibilité propre à l’instrument. Mais on atteint aussi quelques limites dès lors que le tuba se prend à vouloir jouer les solistes. C’est particulièrement audible dans la Sonate du Norvégien Trygve Madsen (né en 1940), où les sonorités trop floues du tuba se marient mal avec la netteté imperturbable du piano (Véronique Goudin-Léger). Peut-être l’accompagnement plus dramatique du violoncelle (Thierry Amadi) réussit-il mieux à l’imbrication des textures, comme c’est le cas dans Saturnalis du clarinettiste américain Meyer Kupferman (1926-2003). Il n’en reste pas moins que l’instrument aux teintes trop graves a bien du mal à imprimer les mélodies mouvantes et ensorcelantes d’Astor Piazzolla (Café 1930). Dommage, car après des œuvres de Bloch et David R. Gillingham, l’ultime pièce du disque, due à l’obscur trompettiste allemand Oscar Böhme (1870-1938) et enregistrée avec l’ensemble Smart Is Brass, prouve combien les cuivres gagnent à être confrontés entre eux – le tuba retrouvant un rôle plus classique de soutien à la mélodie principale accordée aux instruments plus aigus. Un disque idéalement capté et au minutage généreux (Animato ACD 6149). FC
Impressions de Waldteufel

«Valse avec les Impressionnistes»: sous ce titre aguicheur, retour d’un enregistrement paru en 2001, plusieurs fois primé, dans lequel l’Ensemble Fa dirigé par Dominique My (!) interprète sept valses du compositeur alsacien Emile Waldteufel, réorchestrées par le compositeur français Paul Mefano pour un ensemble de sept musiciens. L’esprit de la Belle Epoque demeure intact dans ces arrangements qui, grâce a des instruments comme la flûte, l’accordéon et le piano, confèrent à cette musique un petit air moderne, quasi schoenbergien. Bien sûr c’est la célébrissime valse Amour et Printemps qui ouvre l’album, celle-là même du générique de Ciné-Club, qu’ont fredonnée des millions de téléspectateurs. Figurent aussi la valse la plus jouée au monde à l’égal du Beau Danube bleu, la Valse des patineurs, et un amusant pot-pourri des Contes d’Hoffmann d’Offenbach, la Valse de la poupée. Bref, que des tubes d’un répertoire habituellement réservé à l’orgue de Barbarie, à qui l’excellent ensemble de Dominique My rend pleinement justice et réhabilitation (Jade 699 859-2). OB
Trop sage Hilary Hahn

Plus que pour un énième Mozart, c’est pour le Quatrième Concerto d’Henri Vieuxtemps (1820-1881) qu’il faut choisir ce nouveau disque gravé par Hilary Hahn. Cheval de bataille de la violoniste américaine depuis plusieurs saisons au concert (voir par exemple ici), il a reçu dès sa création parisienne en 1852 les éloges de Berlioz, s’imposant comme l’une des œuvres les plus souvent jouées du compositeur belge, aux côtés de son Cinquième Concerto. Mais si l’on salue l’intention, l’interprétation est beaucoup trop sage pour réellement convaincre, restant dans une constante volonté de «beau son», tandis que l’accompagnement analytique de Paavo Järvi, à la tête de la Philharmonie de chambre allemande de Brême, ne séduit guère à force de raideur. La volonté de dégraisser est sans doute louable, mais on en restera aux versions plus anciennes de Heifetz/Barbirolli – nettement plus personnelle et engagée – et, dans une moindre mesure, de Perlman/Barenboim, l’accompagnement de ce dernier se révélant plus brouillon. La gravure du Cinquième Concerto de Mozart, ultime de la série composée à seulement 19 ans, se révèle également d’une extrême lisibilité, sans alanguissement, tout en proposant de beaux dialogues avec l’orchestre. C’est surtout dans le Rondo final que Järvi surprend par le martellement quelque peu brutal des scansions «turques». Un disque honnête mais aucunement essentiel (Deutsche Grammophon 479 3956). FC
De «miraculeuses métamorphoses» à Kansas City

Michael Stern (né en 1959), directeur musical de l’Orchestre symphonique de Kansas City, présente, sous le titre «Miraculeuses métamorphoses», un programme audacieux dans le sens où les mélomanes désireux d’acquérir telle ou telle pièce sont confrontés à un large choix d’excellence, d’Abbado à Boulez, à la tête d’orchestres de légende. Stern réunit trois œuvres phares du XXe siècle: les Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Carl Maria von Weber (1943) de Hindemith, la Suite (1925) de l’opéra L’Amour des trois oranges de Prokofiev, et la Suite (1928) du mimodrame Le Mandarin merveilleux de Bartók. Les associer avec un équilibre qui peut surprendre, c’est son premier atout: elles procurent ensemble un immense plaisir d’écoute. Le second atout – l’excellence de la prise de son HD, claire, spacieuse, d’une belle présence et bien définie sur tout le spectre sonore – donne une valeur certaine à la prestation, les trois pièces ayant un commun d’étincelants solos instrumentaux surgissant de l’ensemble, des alliances de timbres d’un grand raffinement et une inventivité sonore exceptionnelle. On peut toujours regretter le souffle d’un Abbado, le relief orchestral d’un Boulez ou les fortes couleurs d’un Dorati, mais l’interprétation transmet tout à fait correctement l’alacrité ou le caractère énigmatique du discours symphonique. Le chef américain, concentré, obtient une attention enthousiaste de ses musiciens qui défendent les trois œuvres avec passion atteignant un sommet d'intensité pour la conclusion de la Suite de Bartók. C’est un beau concert d’un soir – sur lequel on revient inlassablement pour un plaisir renouvelé (Reference Recordings RR132). CL
L’absurde façon Chédrine

Composé pour l’inauguration de la deuxième salle du Théâtre Mariinsky en 2013, l’opéra Le Gaucher est dédié à Valery Gergiev. Rien d’étonnant dès lors à retrouver le chef d’origine ossète à la baguette du présent enregistrement, réalisé dans la foulée de la création à Saint-Pétersbourg, Gergiev défendant avec constance l’œuvre de Rodion Chédrine (né en 1932) – l’époux de la danseuse Maïa Plissetskaïa, disparue il y a deux semaines – au concert comme au disque depuis de nombreuses années. Le Mariinsky avait ainsi déjà édité voilà cinq ans un autre double album consacré à ce compositeur. Parmi ces œuvres, on trouvait son quatrième opéra Le Vagabond ensorcelé, adapté d’une nouvelle de son compatriote Nikolaï Leskov, également auteur de la Lady Macbeth qui avait inspiré Chostakovitch. C’est à nouveau Leskov qui nourrit l’inspiration de Chédrine, autour d’une satire rocambolesque de l’aveuglement du pouvoir – les artisans russes étant chargés de prouver leur supériorité technique face aux Anglais, au risque de l’absurde. Une histoire qui va comme un gant au coloriste Chédrine, jamais avare d’effets en tout genre pour animer sa partition. L’œuvre lorgne très souvent vers la comédie musicale par son côté «facile», sans prétendre à une quelconque originalité avec ses différents emprunts aux grands maîtres russes du XXe siècle, mais elle reste plaisante dans sa fantaisie même (album de deux SACD Mariinsky MAR0554). FC
Trois quarts d’heure avec Audrey Vigoureux

Encore une de ces cartes de visite qui prouvent le savoir-faire d’un interprète sans en dévoiler toute la personnalité artistique. Pour son premier disque, intitulé «Quasi una Fantasia», qui ne dure que quarante-cinq minutes mais comporte une notice dithyrambique à son sujet, Audrey Vigoureux (née en 1981) associe deux courtes Sonates de Beethoven, la Treizième et la Trente-et-unième, avec deux Fantaisies et Fugues de Bach, les BWV 904 et BWV 906: du piano de qualité, précis, bien sonnant. Conciliant imagination et clarté de la structure, la pianiste cultive un jeu net, articulé et contrasté. Les moyens sont là mais l’interprétation ne présente pas un intérêt très marqué (Evidence EVCD010). SF
Brahms le chambriste
 
 
 

Musiciens et mélomanes ne se lassent pas de la musique de chambre de Brahms – sans doute l’un des corpus les plus remarquables et homogènes qui soient, tant il est vrai que du duo jusqu’au sextuor, pas une de ces vingt-quatre œuvres n’est ratée ou même simplement négligeable.
Les deux Sonates pour violoncelle et piano trouvent en Paul Watkins (né en 1970) et Ian Brown (le frère de la regrettée violoniste Iona Brown) des interprètes d’une grande honnêteté – un violoncelle digne, presque trop sobre, un piano un peu effacé. A ce disque sans défauts ni qualités saillants mais au minutage généreux se joint l’excellent Michael Collins (né en 1962) pour le rare et tardif Trio en la mineur, mais pas plus à trois qu’à deux il ne se passe quelque chose (Chandos CHAN 10825).
C’est à la clarinette que Brahms a consacré ses quatre dernières partitions chambristes, mais ce sont de (très) jeunes musiciens qui s’attaquent avec succès à trois d’entre elles. Raphaël Sévère (né en 1994) et Adam Laloum (né en 1987) donnent des deux Sonates une vision d’une constante musicalité et d’une infinie délicatesse, instrumentalement splendide, entre la luminosité de la clarinette et la profondeur du piano – les riches affinités que Laloum entretient avec cet univers sont connues de longue date (voir ici). Victor Julien-Laferrière (né en 1990) les rejoint pour le Trio en la mineur, autrement plus vivant, captivant et somptueux de sonorité que la version britannique sus-évoquée (Mirare MIR 250).
Constitué en 2004, mais, suite au remplacement (depuis l’enregistrement du présent disque) du violoncelliste Sébastien Walnier par Eric-Maria Couturier, n’ayant conservé de sa formation d’origine que le pianiste Sébastien Surel, le Trio Talweg propose une intégrale des œuvres écrites pour cette formation – le Trio de jeunesse en la majeur n’est cependant pas au programme. Il est loisible d’attendre ou de préférer des versions plus originales et échevelées, mais le caractère différent des trois Trios de même que leurs ascendances beethovénienne et schubertienne sont remarquablement mis en valeur par cette interprétation engagée, franche et lyrique, aussi claire que dépourvue d’affectation, qui souffre toutefois d’une intonation parfois imprécise du violon (double album Pavane Records ADW 7566/7).
Dans les trois Quatuors à cordes, le Quatuor Gringolts déploie une virtuosité spectaculaire (Vivace initial du Troisième), mais l’urgence confine parfois à la bousculade (Allegro initial du Premier). Le jeu des musiciens pétersbourgeois est fin et incisif, plus attentif à la clarté de la polyphonie qu’à la cohésion et à la puissance, et manque un peu de souffle. Avec le concours de Peter Laul (né en 1977), qui ne le cède en rien en fiabilité instrumentale, le Quatuor Gringolts fait précéder son intégrale d’un Quintette avec piano dans le même esprit (album de deux disques Orchid Classics ORC100042).
L’intégrale du Quatuor Chiara est sous-titrée «Brahms par cœur»: du cœur, elle en a assurément davantage que celle des Gringolts («Romance» du Premier), mais aussi du sentiment et de la chaleur, plus conforme aussi en cela à une certaine tradition interprétative. Elle paraît néanmoins plus terne et, surtout, moins performante en termes de qualité instrumentale et d’intonation. En complément, les musiciens américains ont, eux aussi, choisi un quintette, en l’occurrence le Second Quintette à cordes, en compagnie de Roger Tapping (né en 1960), ancien altiste du Quatuor Takács, qui a rejoint en 2013 le Quatuor Juilliard et auquel on doit peut-être ici un regain de dynamisme dans l’interprétation (album de deux disques Azica ACD-71289).
Pas d’intégrale pour le Quatuor Psophos mais pourquoi n’en serait-ce pas ici le premier volume? Car le couplage de ce disque réunit fort opportunément le Premier (1899) des trois Quatuors d’un compositeur alors âgé de vingt-deux ans seulement, Ernö Dohnányi, qui s’inscrit nettement dans la descendance brahmsienne, et le Premier de Brahms – il ne reste qu’à procéder de même pour les deux autres quatuors de chacun de ces deux musiciens. La suggestion est on ne peut plus sérieuse, car le résultat de cet album est extrêmement probant: davantage que les Gringolts et les Chiara, les Psophos donnent l’impression de s’être appropriés la partition, qu’ils restituent à la fois avec un parfait naturel et un sens aigu des contrastes, un bon équilibre entre construction, narration et dramatisation, sachant faire ressortir tour à tour la dimension symphonique et la parenté schubertienne. Délibérément moins ambitieuse, l’œuvre de Dohnányi bénéficie d’une verve et d’un charme inépuisables (Ar Re-Se AR2014-1).
Enfin, les solistes de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam peinent à soutenir constamment l’intérêt dans les Sextuors à cordes, certes parfaitement mis en place et d’une qualité instrumentale globalement satisfaisante, mais où l’on ne sort pas assez souvent d’une routine trop confortable pour rendre justice à la richesse d’invention et à la générosité d’expression de ces deux œuvres (SACD Bayer Records BR 100 370 CD). SC
Les quatre saxophones d’Ellipsos

Formé à Nantes en 2004, le Quatuor Ellipsos s’inscrit dans la lignée du Quatuor de saxophones de Paris, célèbre formation créée par Marcel Mule en 1936. Proche du quatuor à cordes, l’assemblage de quatre saxophones réunit quatre voix différentes (soprano, alto, ténor et baryton) – contrairement à l’usage américain qui allie deux altos aux saxophones ténor et baryton. Il en ressort des sonorités plus variées, mais qui restent insuffisamment différenciées pour réellement convaincre au-delà de la seule curiosité. Les transcriptions des œuvres de Ravel offrent néanmoins de beaux moments, telle l’entrée du thème principal presque fragile dans la Pavane pour une infante défunte. Mais ce sont surtout les contrechants qui surprennent, apportant des dialogues intéressants dans cette œuvre. Si le Prélude du Tombeau de Couperin offre un beau tempo vif et des atmosphères tournoyantes, la transcription déçoit ensuite, particulièrement dans la Fugue, aux stridences pénibles. Il est vrai que la prise de son très sèche n’aide pas. Le début du Boléro, qui donne son titre à cet album au minutage généreux, se tient bien mais échoue dans l’intensité de la progression, se contentant d’une augmentation du volume sonore sans pouvoir jouer sur les effets de masse propres à l’orchestration originale. Parmi les compléments (Introduction et Variations sur une ronde populaire de Pierné, Le Bal et Tango virtuoso d’Escaich), on retiendra le Petit quatuor pour saxophones (1935) de Jean Françaix aux accents délicieusement malicieux (Genuin GEN 14543). FC
Une Flûte enchantée impossible à rationaliser

Opus Arte donne à voir une production de La Flûte enchantée créée à l’Opéra national néerlandais en décembre 2012 (et présentée à Aix-en-Provence en 2014). Simon McBurney n’avait d’autre expérience de mise en scène d’opéra que la création de Cœur de chien de Raskatov deux ans plus tôt. On retrouve ici aussi bien la diversité des techniques – vidéo, marionnettes, illusions d’optique – que les qualités de ce spectacle – inventivité, précision de la direction d’acteurs. Son credo, qu’il rappelle dans le traditionnel documentaire en forme de making of offert en bonus, est simple: le livret est un «désordre impossible à rationaliser» (et «Bergman l’ennuie à mourir»). Autant, dès lors, faire feu de tout bois, que ce soit au travers des costumes de Nicky Gillibrand (Tamino en survêtement, Papageno en baba cool excentrique, la Reine de la nuit en femme âgée se déplaçant en fauteuil roulant, Dames en treillis, Enfants zombies...), des bruitages ajoutés ou des retouches apportées aux dialogues (assez souvent en tuilage ou en superposition avec la musque), voire, très légèrement, à la partition, notamment dans l’ordre des numéros. A l’image de Sarastro prenant le micro pour s’adresser au public, le théâtre prime, avec les moyens du bord, le décor de Michael Levine tirant efficacement parti d’un simple plateau au pied duquel est disposé l’orchestre (dont le flûtiste et le joueur de glockenspiel sont associés à plusieurs reprises à l’action). Allégorie, fantaisie, science-fiction, tout cela ne revendique pas de sens autre que la volonté d’émerveiller et de surprendre, même si, au fur et à mesure de l’initiation des personnages, le propos tend vers l’épure (encore qu’on ait l’impression d’avoir déjà souvent vu faire de l’entourage de Sarastro des hommes de main et de ses prêtres les membres du conseil d’administration de quelque multinationale). Plus efficace que stylé, le chant est néanmoins mis en valeur par le Tamino de Maximilian Schmitt et la Pamina de Christina Landshamer. A la tête de l’Orchestre de chambre néerlandais, Marc Albrecht impose une direction sèche, nerveuse et contrastée, entre précipitation et ralentissements (DVD OA 1122 D ou Blu-ray OABD7133D). SC
L’autre Haydn

De cinq ans le cadet de son illustre frère Joseph, Michael Haydn (1737-1806) a donné son meilleur dans la musique religieuse – s’illustrant auprès de Mozart à Salzbourg, où il a passé l’essentiel de sa carrière. On connaît peu sa musique de chambre, bien que celle-ci comporte pas moins de dix-neuf Quatuors mais aussi cinq Quintettes à cordes, dont CPO propose l’intégrale. Les deux Quintettes MH 187 et MH 189, composés en 1773, portent le nom de «nocturne», tandis que les deux de 1786 (MH 411 et MH 412) sont qualifiés de «divertimentos». En ce dernier cas, la coupe classique en quatre mouvements n’est pas respectée, Michael Haydn s’offrant une liberté particulièrement perceptible dans les variations des deux Allegretto. Un certain sens de la mélodie irrigue ces œuvres assez mineures, malheureusement desservies par un Quintette Haydn de Salzbourg techniquement moyen, qui en livre une interprétation propre et sans risques (album de deux disques 777 907-2). FC
«American Songs» sans charme

On sera peut être surpris d’apprendre que de cet enregistrement intitulé «American Songs» le meilleur est la partie purement pianistique. Maiko Inoué y joue les Trois Préludes de Gershwin avec un sens du swing et des couleurs qui force l’écoute. On n’en dira pas autant de la partie chantée. Anne Cambier (née en 1968), soprano belge qui, ayant été remarquée au concours Reine Elisabeth en 1996, fait surtout carrière de chanteuse et de pédagogue dans son pays. Non que sa sélection de chansons américaines ne soit pas intéressante, les Six Chansons élisabéthaines de Dominick Argento (né en 1927), sur des poèmes de Shakespeare, Constable, Ben Johnson..., sont rares et ne manquent pas de charme, celles de Samuel Barber sont aussi très représentatives et si le cycle I Hate Music de Bernstein est très populaire, on est toujours content de le retrouver. Ce qui manque à cet enregistrement, c’est un charme vocal qui permettrait de différencier les compositeurs les uns des autres et même de conférer à chaque chanson une teinte singulière. La variété n’est pas le fort d’Anne Cambier et – hélas! – on se demande vite «Pourquoi cet enregistrement?», alors qu’il y a tant par ailleurs qui explorent ce répertoire avec des voix moins ingrates et beaucoup plus d’intelligence. Pour n’en rester qu’au même éditeur néerlandais, Et’Cetera, à ses débuts, il avait notamment enregistré Roberta Alexander dans deux albums, l’un consacré à Leonard Bernstein, l’autre intitulé «Songs my mother taught me». Il semble qu’ils soient toujours disponibles... (KTC1527). OB
Le Quatuor Carducci à la surface de Chostakovitch

Le Quatuor Carducci reste à la surface des Quatrième, Huitième et Onzième Quatuors de Chostakovitch. La formation britannique fluidifie les échanges, équilibre le dialogue et souligne les contrastes mais la tension baisse trop souvent tandis que le sentiment de malaise ne se ressent qu’épisodiquement, peut-être à force de trop se focaliser sur la sonorité et la précision (Signum SIGCD418). SF
La rédaction de ConcertoNet
|