|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité d’avril
04/15/2015
Les chroniques du mois
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Jun Märkl dirige Hosokawa Jun Märkl dirige Hosokawa
 Nathalie Stutzmann interprète Haendel Nathalie Stutzmann interprète Haendel
 Fabio Biondi interprète Vivaldi Fabio Biondi interprète Vivaldi
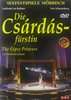 Princesse Czardas à Mörbisch (2002) Princesse Czardas à Mörbisch (2002)
 Le Comte de Luxembourg à Mörbisch (2006) Le Comte de Luxembourg à Mörbisch (2006)
 Lucia di Lammermoor avec Diana Damrau Lucia di Lammermoor avec Diana Damrau
 Les cuivres du Concertgebouw Les cuivres du Concertgebouw
 Musique anglaise du XXe siècle Musique anglaise du XXe siècle
 David Lloyd-Jones dirige Standford David Lloyd-Jones dirige Standford
  Oui ! Oui !
Nelson Freire interprète Chopin
Jean-Efflam Bavouzet interprète Haydn
L’Orchestre Mozart de Claudio Abbado (documentaire)
Michael Schneider dirige Beck
Riccardo Minasi et Dmitry Sinkovsky interprètent Vivaldi
Zoltán Kodály dirige ses propres œuvres
Arno Paduch dirige Pachelbel
Les Vêpres siciliennes à Covent Garden (2013)
Concert de la Saint-Sylvestre 1999
David Fray et Jacques Rouvier interprètent Schubert
Les quarante ans d’«El Sistema»
«Révolution» avec Emmanuel Pahud
Roman Simovic dirige Tchaïkovski et Bartók
Jonathan Morton dirige Tchaïkovski et Chostakovitch
Rémi Geniet interprète Bach
Sandrine Piau chante Mozart
Richter, l’Insoumis de Bruno Monsaingeon
Le Quatuor Schneider interprète Haydn
Le Quatuor Festetics interprète Haydn
Ludovic Morlot dirige Fauré
«Lux» par l’octuor vocal Voces8
Tianwa Yang interprète Castelnuovo-Tedesco
Le Marchand de Venise de Tchaikowsky à Bregenz (2013)
Robin Ticciati dirige L’Enfance du Christ
La Petite Bande interprète Telemann
Riccardo Muti dirige Prokofiev
Colin Davis dirige Nielsen
Alan Gilbert dirige Nielsen
Sakari Oramo dirige Nielsen
Et Lux de Rihm
Jean-Luc Tingaud dirige Dukas
 Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Concert à la mémoire de Claudio Abbado (2014)
D. Inbal dirige Le Comte de Luxembourg de Lehár
Concerts de la Saint-Sylvestre (1996-1998)
François Chaplin interprète Schubert
Guillaume Coppola interprète Schubert
András Schiff interprète Schubert
Intégrale des enregistrements d’Ivo Pogorelich
Florian Uhlig interprète Schumann
Claire-Marie Le Guay interprète Bach
Bruno Monsaingeon filme Menuhin
Le Quatuor Doric interprète Haydn
Rachel Kolly d’Alba interprète Franck et Chausson
Ludovic Morlot dirige Dutilleux
«Danses» par le duo (de piano) Jatekok
Beatrice Berrut interprète Bach
Concerts autour de Sviatoslav Richter
Jonathan Kaell dirige Koster
Martin Rummel interprète Zani
Stéphane Denève dirige Ravel
Jean-Luc Tingaud dirige Bizet
Pas la peine
Concert à la mémoire de Herbert von Karajan (1999)
Anna Bolena à Rieti (2013)
Michael Korstick interprète Schubert
Nami Ejiri interprète Schubert
Paul Badura-Skoda interprète Schubert
Aaron Pilsan interprète Beethoven et Schubert
Franz Hauk dirige Mayr
Yetzabel Arias Fernández chante Jommelli
Jean-Claude Malgoire dirige Aben Hamet de Dubois
Ludovic Morlot dirige Ravel et Saint-Saëns
Wendy Warner interprète Haydn et Myslivecek
Hélas !
Tzimon Barto interprète Brahms
En bref
Bruno Monsaingeon, libre et insoumis
Un Marchand de Venise posthume
Et Lux, méditation de Rihm sur le requiem
«Lux», ou le zen vocal
Sandrine Piau: merci pour ce (bref) moment
34 ans, et déjà une compilation pour Dudamel!
Duo Jatekok: eh bien, dansez maintenant!
Une belle redécouverte: Andrea Zani
Emmanuel Pahud: rien de bien révolutionnaire
Richter au coin du feu: décembre 1985
Castelnuovo-Tedesco, puissamment évocateur
Bach au piano (1): Le Guay et Geniet
Bach au piano (2): le cas Berrut
Une compositrice luxembourgeoise à découvrir
Prokofiev à l’américaine avec Muti
Haydn: trois générations de quatuors
Robin Ticciati poursuit son exploration berliozienne
Florian Uhlig plus Eusebius que Florestan
Aben Hamet attendra
Jommelli attendra
Nielsen trois intégrales pour un anniversaire
Duo suisse, musique française
Quatre-vingt-dixième disque pour La Petite Bande!
Ludovic Morlot, un Français à Seattle
Stéphane Denève, un Français à Stuttgart
Tchaïkovski: le match Ecosse-Angleterre
Wendy Warner, un second choix pour Haydn
Mayr desservi par les voix
Barto et Eschenbach s’égarent dans Brahms
Bruno Monsaingeon, libre et insoumis
 
Les films de Bruno Monsaingeon (né en 1943) bénéficient d’une reparution en Blu-ray chez EuroArts Idéale Audience. Ainsi le luxueux coffret consacré à Yehudi Menuhin (1916-1999) réunit-il treize films réalisés entre 1979 et 1996 et un intéressant livret (illustré de quelques photos, qui donnent un avant-goût du livre annoncé pour l’année du centenaire de l’artiste américain). Davantage que par les insolites Quatre Saisons (produites pour TF1 en 1979), on reste assez fasciné par les conversations filmées à Mykonos en 1994, où le violoniste se fait musicologue autant qu’humaniste et philosophe, comme par les échanges avec la pianiste Viktoria Postnikova. Ouvert par l’incontournable Violon du siècle, le résultat est assez massif – pas forcément aisé à manipuler, mais les fans de Menuhin y dénicheront des pépites – notamment dans les extraits musicaux. Ainsi de ce granitique Concerto de Brahms capté en 1982, qui voit Kurt Masur mettre le feu au Gewandhaus de Leipzig (coffret de quatre Blu-ray 2075014). Datant de 1998, le film Richter, l’Insoumis fait, lui aussi, son entrée dans la galaxie du Blu-ray. Inutile d’aligner les superlatifs pour décrire ce qui constitue l’un des plus fascinants documentaires musicaux jamais réalisés, dont les illustrations musicales prennent à la gorge, dont la cohérence intellectuelle et la logique de l’architecture frappent de bout en bout. Il faut dire que Monsaingeon connaît son sujet («Richter est l’un de ceux qui donnent le plus fort ce sentiment de dématérialiser la musique. Tel un canon qui tirerait un obus sans recul, un avion qui s’envolerait verticalement dans élan, il est capable de varier les couleurs à l’infini et sans dégradé, de passer du pianissimo le plus impalpable au fortissimo le plus volcanique sans césure ni force d’inertie. S’il donne parfois l’impression d’une lutte avec la matière, c’est pour la pulvériser, et laisser naître le chant pur, dans l’ivresse des pièces les plus hystériquement virtuoses où ses doigts font reculer les limites du physiquement possible»). Une vidéo qui fait parler Sviatoslav Richter (1915-1997) au soir de sa vie, donnant à ses paroles comme à son regard perçant un parfum d’éternité. Le Blu-ray lui redonne du vernis (EuroArts Idéale Audience 3073514). GdH
Un Marchand de Venise posthume

Après que Toccata Classics a entamé, l’an dernier, une série de disques consacrés à André Tchaikowsky (1935-1982) par un premier volume permettant de découvrir sa musique pour piano, EuroArts publie une captation de son unique opéra, Le Marchand de Venise. Né à Varsovie, Robert Andrzej Krauthammer devient, en 1942, Andrzej Robert Jan Czajkowski pour mieux échapper aux persécutions antisémites – sa mère est assassinée à Treblinka. Après des études à Paris avec Lazare Lévy, il retourne en Pologne, remporte le huitième prix du concours Chopin (1955) puis le troisième prix du concours Reine Elisabeth à Bruxelles (1956), où Rubinstein le prend sous son aile. Ayant définitivement quitté son pays, il prend des leçons de composition avec Nadia Boulanger et, à la demande de son imprésario, se fait connaître comme pianiste sous le nom de Tchaikowsky. Mais il subit d’autant plus le poids écrasant de son illustre homophone qu’il se considère avant tout comme un compositeur, la carrière de concertiste de cet écorché vif souffrant en outre d’une personnalité complexe, tourmentée et volontiers provocatrice. Passionné de Shakespeare, il songe dès 1968 avec son librettiste, John O’Brien, à un opéra tiré du Marchand de Venise, resserré en trois actes et un épilogue, dont la composition occupera les toutes dernières années de sa vie – Alan Boustead n’eut à mettre la dernière main qu’à vingt-quatre mesures d’orchestration. S’agit-il, comme le pense David Pountney – qui programma l’œuvre en 2013 au festival Bregenz, dont il fut l’intendant de 2003 à 2014 et où il avait déjà assuré, trois ans plus tôt, une autre création posthume d’un opéra «polonais», La Passagère de Weinberg – de «l’adaptation opératique la plus importante de Shakespeare depuis le XIXe siècle»? Ce serait oublier notamment Le Songe d’une nuit d’été (Britten), Troïlus et Cressida (Walton), Antoine et Cléopâtre (Barber) et Lear (Reimann), mais le metteur en scène britannique, qui s’en voulait d’avoir laissé passer l’occasion, fin 1981, lorsqu’il était en fonctions à l’English National Opera et qu’une lecture de l’ouvrage y fut organisée, a eu raison de mener finalement à bien ce projet.
Car pour un coup d’essai, Tchaikowsky réussit un coup de maître de plus de deux heures et demie: le résultat se révèle tout à fait probant, même si la musique est certes un peu datée, non pas parce qu’elle se livre à quelques citations furtives (la trompette de Fidelio, le thème de l’anneau de la Tétralogie de Wagner et la Quatrième Symphonie de... Tchaïkovski) mais parce qu’elle traduit l’influence de la seconde Ecole de Vienne (Lulu plus encore que Wozzeck ou Moïse et Aaron), avec des voix mises en valeur par de longues lignes lyriques et un orchestre alternant impact dramatique et finesse instrumentale. Reprise à Varsovie en octobre dernier, la mise en scène de Keith Warner opte pour une pertinente transposition dans la finance londonienne du début du XXe siècle, ses bureaux et ses coffres, et met habilement en valeur les thématiques qui ont certainement stimulé le compositeur – argent, psychanalyse, judéité, homosexualité, marginalité sociale. La distribution masculine est luxueuse (Christopher Ainslie, Adrian Eröd, Charles Workman) mais les principaux rôles féminins leur répondent au même niveau (Magdalena Anna Hofmann, Kathryn Lewek, Verena Gunz) tandis que dans la fosse, le Symphonique de Vienne est dirigé avec conviction par Erik Nielsen. Un documentaire de Mark Charles – dont le sous-titrage en français est encore plus truffé d’erreurs que celui du spectacle proprement dit – complète cette publication, hélas sous la forme du traditionnel making of à l’unanimisme louangeur, où de courts entretiens avec les protagonistes sont entrecoupés d’extraits des répétitions et représentations (album de deux DVD 2072708 ou un Blu-ray 2072704). SC
Et Lux, méditation de Rihm sur le requiem

Wolfgang Rihm (né en 1952) allie un quatuor à cordes à un octuor vocal avec le plus heureux effet. Et Lux en un seul mouvement est un requiem indirect. C’est une méditation sur le requiem pour laquelle le compositeur allemand conçoit des motifs polyphoniques fondés sur la modalité aux sonorités anciennes qui peuvent sonner brièvement en choral. Les motifs se brisent, ou s’étirent à l’horizontale, s’étendent à la verticale pour évoluer vers une dissonance éloquente jamais abrasive, quoique plus acérée ou rugueuse lors des moments les plus dramatiques. De climats douloureux ou protestataires surgissent en latin des associations de mots ou des bribes de mots isolés qui renvoient aux différentes parties de la messe de requiem. L’ensemble relève de la structure inattendue du rêve dont la logique étrange en perpétuelle métamorphose s’impose comme une évidence naturelle. Le titre de l’œuvre suggère une intention d’aboutir à la lumière et à l’apaisement. Si c’est le cas, c’est sans cesse au cours d’une apparence d’éternel renouvellement qui avive puis berce le désarroi. Son traitement exigeant des deux ensembles et jusques à chacune des douze voix en accuse les troublantes ressemblances possibles malgré les techniques classiques et avancées qui diffèrent tels les pizzicati tout à fait bartókiens. L’interprétation est de haut niveau. L’Ensemble Huelgas chante avec la même perfection et la même pureté mélodique que lorsqu’ils interprètent leur répertoire plus habituel qui relève du Moyen-Age et de la Renaissance tout en étant tout à fait convaincants dans un style plus mordant nettement de notre temps. Interprète expérimenté des quatuors de Rihm, le Quatuor Minguet, en contrepoint et à l’écoute des voix, assure la mise en place impeccable du quatuor qui sonne et résonne avec elles. La direction méticuleuse de Paul van Nevel met en valeur la clarté énergique de l’ensemble et les instants de fine douceur éplorée (ECM New Series 481 1585). CL
«Lux», ou le zen vocal

Parfait produit élaboré pour un public qui pourra s’exclamer «Je n’aime pas la musique classique, mais ça j’aime!», ce disque de l’octuor vocal Voces 8 intitulé «Lux» n’en est pas moins une belle réussite. Mariant habilement tubes du répertoire, de Tallis à Elgar en passant par Allegri, à des morceaux plus inattendus – comme l’adaptation du groupe britannique Massive Attack – ce pot-pourri réserves aussi quelques surprises avec un Ave Maria dû non pas à l’inévitable Schubert, mais à Rihards Dubra. Cette publication très calibrée propose des morceaux qui n’excèdent jamais 5 minutes, hormis le Miserere d’Allegri (tout de même raccourci d’environ 5 minutes), en gommant toutes les ruptures au profit d’une atmosphère méditative nimbée d’une réverbération omniprésente. La rythmique semble dénervée pour procurer l’apaisement, en une «ambiance zen» où l’affirmation des individualités vocales est proscrite. Gageons que ce disque pourra donner envie aux plus curieux de s’initier à la musique classique vocale autour d’un répertoire autrement plus consistant, osant se confronter aux nécessaires aspérités bien éloignées de ce confort trop enfermant (Decca 478 8053). FC
Sandrine Piau: merci pour ce (bref) moment

Quarante-huit minutes: la durée du dernier disque de Sandrine Piau, «Desperate Heroines», rappelle celle des trente-trois tours d’antan – et encore. La soprano a sélectionné neuf airs d’opéras de la maturité de Mozart (Don Giovanni, Idoménée, Les Noces de Figaro) et dans des ouvrages du compositeur un peu moins souvent représentés (Il re Pastore, La finta giardiniera, Lucio Silla, Mitridate), comme dans le récital qu’elle lui a consacré en 2001. Fine et légère, la voix séduit grâce à sa plasticité, sa pureté et la beauté de son timbre. Le chant, qui témoigne d’un tempérament affirmé, se caractérise par un souci permanent de la clarté et de la juste mesure. Dirigé par Ivor Bolton, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg livre une prestation convenable (Naïve V5366). SF
34 ans, et déjà une compilation pour Dudamel!

On ne présente plus le bouillonnant jeune chef de l’Orchestre symphonique Simón Bolívar, Gustavo Dudamel. Un chef indissociable de son orchestre fétiche, qu’il dirige depuis ses 18 ans, à tel point qu’on le confond souvent avec celui-ci tant les deux trajectoires sont solidement arrimées. A croire qu’il l’a lui-même créé! Et pourtant il n’en est rien, même si le présent disque, intitulé «El Sistema 40. A Celebration», ne contribue pas à éviter la confusion, seuls des enregistrements dirigés par Dudamel étant présentés pour célébrer les quarante ans du programme «El Sistema». Lancé en 1975, cet ambitieux projet public chargé de soutenir les vocations musicales à travers tout le Venezuela a reçu une audience internationale avec l’ascension de son jeune chef depuis dix ans. Et c’est bien lui qui est célébré ici, tant sa direction vive et enjouée, exaltant les contrastes et fouillant les partitions, renverse tout sur son passage. Seul bémol à cet enthousiasme, les enregistrements ici réunis ne sont qu’une compilation d’extraits d’autres disques déjà parus chez Deutsche Grammophon. Un cadeau à offrir pour découvrir le geste dévastateur de Dudamel et aller plus loin ensuite avec l’achat des intégrales, évidemment bien plus recommandables (479 4447). FC
Duo Jatekok: eh bien, dansez maintenant!

Le premier enregistrement du Duo Jatekok sort seulement maintenant alors qu’Adélaïde Panaget (née en 1985) et Naïri Badal (née en 1984) se produisent ensemble dans cette formation depuis 2007. Elèves de Brigitte Engerer, Nicholas Angelich, Claire Désert et Ami Flammer, les pianistes le consacrent au thème pas très original de la danse: Danses polovtsiennes de Borodine, Rapsodie espagnole de Ravel, Valses-Caprices et Danses norvégiennes de Grieg et, choix original, Souvenirs de Barber. Elles livrent une exécution rythmée et précise de ces pièces qui prennent, entre leurs mains (photographiées de près dans la notice), du relief et du caractère. Ce disque dégage une énergie saine et revigorante (Mirare MIR261). SF
Une belle redécouverte: Andrea Zani

Andrea Zani (1696-1757) fait partie de cette cohorte de compositeurs du XVIIIe siècle totalement oubliés qui, à la faveur d’une redécouverte de manuscrits ou d’une initiative personnelle d’un musicien, sont remis à l’honneur. Tel est le cas ici avec cette intégrale des douze Concertos pour violoncelle et orchestre à cordes, enregistrés en première mondiale par Martin Rummel (né en 1974), accompagné par l’Académie de Cologne sous la direction de son fondateur, Michael Alexander Willens. Bien que le rapprochement puisse sembler facile avec le style d’Antonio Vivaldi, lui aussi compositeur prolixe pour le violoncelle, force est de constater que la musique de Zani ne lui ressemble que peu. Certes, on peut y déceler certains accents «vivaldiens» (la fin du premier mouvement du Septième Concerto ou le troisième mouvement du Huitième), mais l’oreille se tourne bien davantage vers le style classique de Leopold Hofmann ou de Haydn. C’est notamment le cas des mouvements lents qui, sans grande recherche technique, sont agréables à écouter et dispensent généralement une douce et calme mélodie où Zani semble ne rechercher que les belles sonorités du soliste (Huitième et Dixième). Dans les mouvements rapides, la technique n’est pas non plus le premier critère recherché; certes, il en faut, et Martin Rummel n’en manque pas (qu’il s’agisse par exemple du premier mouvement du Quatrième ou du premier mouvement du Troisième, dont l’intérêt repose en partie sur un ostinato de motifs réptés), mais c’est avant tout la mélodie qui importe, surtout quand elle est jouée de façon enjouée et dansante (le dernier mouvement du Dixième ou le premier mouvement du Deuxième). Sans être essentielle, voici en tout cas une belle redécouverte, interprétée avec soin autant qu’avec conviction (double album Capriccio C 5145). SGa
Emmanuel Pahud: rien de bien révolutionnaire

Compositeur prolifique, François Devienne (1759-1803) a surtout écrit de la musique de chambre et des concertos pour ses deux instruments de prédilection, le basson et la flûte, dont il fut l’un des plus éminents virtuoses de son temps. C’est par l’un de ses quatorze concertos qu’Emmanuel Pahud ouvre ce disque intitulé «Révolution» et consacré à la période jouxtant la Révolution française. Aucune découverte majeure, toutes les œuvres réunies se situant dans l’élégance musicale propre à cette période musicale. Giovanni Antonini, à la tête de l’Orchestre de chambre de Bâle, essaie d’imprimer un certain caractère en marquant les ruptures orchestrales, adoptant un ton volontiers abrupte dans l’ouverture rugissante du Septième Concerto de Devienne. Mais la flûte adoucit le propos, Pahud ne pouvant faire oublier, malgré toute sa virtuosité, l’optique classique et insouciante des œuvres ici réunies. On découvrira cependant avec intérêt le final entraînant du Premier Concerto de Luigi Gianella (avant 1778-1817), autre virtuose de l’instrument, tandis que celui de Gluck, plus connu, laisse respirer une inspiration poétique dans son bel Adagio. C’est Ignaz Pleyel, ancien élève puis rival de Haydn, qui conclut ce disque par un très beau Concerto en ut (également transcrit pour clarinette ou violoncelle), particulièrement mélodieux (Warner Classics 0825646276783). FC
Richter au coin du feu: décembre 1985

On n’en finit pas de célébrer Sviatoslav Richter (1915-1997) – dieu parmi les pianistes, dont ces disques et la réédition du film de Bruno Monsaingeon donnent surtout à voir le visage pétri d’humanité et de modestie dans l’expression du génie. Décembre 1985 à Moscou: Richter réunit, au Musée Pouchkine, des artistes de talent pour le festival des «Soirées de décembre». Ces captations de musique de chambre sont, pour la première fois, portées au CD. Tant mieux pour Schumann, dont la discographie s’enrichit d’un exceptionnel Trio en ré mineur, aussi frémissant qu’angoissant (avec le vieux complice Oleg Kagan et l’irréprochable Natalia Gutman), d’éloquents Contes de fées (avec l’incontournable Youri Bashmet) et de moins indispensables Fantasiestücke (au côté du clarinettiste Anatoli Kamyshev). Kagan fait un partenaire idéal dans la Sonate en la majeur de Schubert à la légèreté badine, parfaitement bien balancée. Quant à Chopin, on reste moins scotché par une impeccable Sonate pour violoncelle et piano (Gutman, toujours) que par deux must du répertoire du natif de Jytomyr: la Polonaise-Fantaisie et la Quatrième Ballade. La première déploie les ailes de Lucifer sur un clavier transformé en bloc d’ivoire – une déambulation bouleversante au-dessus du néant des touches et de la résonnance. La seconde inondée par l’énergie du désespoir. Une interprétation au bord de l’abîme – malheureusement peu avare en approximations digitales – pour oreilles averties (double album Melodiya MEL CD 10 02204). GdH
Castelnuovo-Tedesco, puissamment évocateur

Après le répertoire concertant pour piano de Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) paru voilà trois ans chez Naxos (puis l’année suivante chez Capriccio), la firme hongkongaise s’intéresse à ses deux Concertos pour violon, dont le Premier «Italiano» pour la première fois au disque. L’ancien élève de Pizzetti et protégé de Casella a mené une belle carrière, riche de ses différents talents pour le piano, la critique musicale ou la composition de nombreuses musiques de film à Hollywood. Sa musique «sérieuse» reste tonale et néoromantique, dans la veine d’un Rachmaninov ou d’un Korngold, sans l’intense imagination mélodique du premier ni la virtuosité orchestrale du second. Mais il n’en reste pas moins très proche de ces grands maîtres par la puissance d’évocation, la fluidité d’une musique descriptive qui emprunte souvent à ses origines juives – comme c’est le cas pour le Second Concerto «Les Prophètes» composé en 1931 pour Jascha Heifetz. Le célèbre violoniste a d’ailleurs gravé cette œuvre avec Alfred Wallenstein à la baguette (RCA), une version plus «orientalisante» dans sa luxuriance débridée mais moins bien captée que le présent disque. Ici, Tianwa Yang (née en 1987) dispense un violon plus sage mais toujours précis et lyrique, accompagnée d’un Pieter-Jelle de Boer (né en 1978) qui fait ressortir les couleurs de l’excellent Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg (8.573135). FC
Bach au piano (1): Le Guay et Geniet
 
Mirare ajoute deux récitals Bach à son catalogue, l’un de Claire-Marie Le Guay (née en 1974), l’autre de Rémi Geniet (né en 1993). Dans le Concerto italien, la Onzième Sinfonia à trois voix, la Première Partita, la Quatorzième Invention à deux voix et la Fantaisie chromatique et Fugue , la pianiste cultive une sonorité agréable et joue avec précision et souplesse. De nature pudique, son interprétation demeure, à chaque instant, poétique et stimulant (MIR264). Deuxième prix au Concours Reine Elisabeth de 2013, Rémi Geniet a choisi, pour son premier disque, un programme peu plus substantiel (Quatrième Partita, Première Suite anglaise, Toccata en ut mineur) avec, comme point commun avec celui de sa consœur, le Caprice sur le départ de son frère bien-aimé. Ce pianiste méticuleux approche ces œuvres de manière raisonnée, sans paraître trop sérieux, un sourire en coin se devinant même parfois au détour d’une phrase. Il s’attache à clarifier les voix intermédiaires grâce à des tempi modérés, ce qui favorise le naturel de la respiration. Son interprétation, aux nuances fines et à l’articulation nette, manque parfois de fantaisie mais l’approche s’avère pertinente. Geniet se profile comme un des grands pianistes de demain (MIR268). SF
Bach au piano (2): le cas Berrut

Beatrice Berrut opte, elle, pour un Bach introspectif. Sur un magnifique Bösendorfer, la pianiste de nationalité suisse – ce que suggère la photo de couverture – étire les tempi, relâche la dynamique, arrondit les angles. Cette approche, qui en abandonnera beaucoup sur le bord du chemin, fonctionne à la rigueur dans la Sicilienne et l’Aria (arrangées respectivement par Kempff et Siloti) mais l’attention se dissipe à plus d’une reprise dans les transcriptions de Busoni, la Chaconne et les Préludes de choral pour orgue – cette demi-heure paraît longue. Le dernier quart du programme réveille enfin les esprits endormis: dans Trois Etudes baroques (inspirées des chorals de Bach) et Jeux de doubles de Thierry Escaich, l’interprète exploite une large palette de couleurs et accuse davantage les contrastes. Ce disque marqué du sceau de l’audace témoigne d’une sensibilité importante et d’une technicité considérable, ce qui incite, malgré tout, à suivre cette pianiste (Aparté AP100). SF
Une compositrice luxembourgeoise à découvrir

Après un premier disque consacré aux mélodies françaises de Lou Koster (1889-1973) paru chez Ar Re-Se l’an passé, c’est au tour de Naxos de s’intéresser à la compositrice luxembourgeoise. Professeur de piano au Conservatoire de Luxembourg, Koster n’a jamais reçu de formation en composition et orchestration mais s’est pourtant montrée très prolifique tout au long de sa vie, produisant pas moins de 250 œuvres dont 170 mélodies (pour la plupart non datées) inspirées de textes poétiques en langues française, allemande ou luxembourgeoise. Comprenant cinq valses, l’Ouverture légère et la Suite dramatique, le présent disque s’intéresse à sa musique légère, composée pour l’essentiel dans l’entre-deux-guerres, où elle fait montre d’un réel talent pour l’élégance et la transparence. Traditionaliste fidèle au langage tonal, Koster voulait ainsi s’adresser au peuple – une volonté sans doute déçue par le peu d’écho rencontré par ses œuvres. A la tête d’un honnête orchestre de chambre luxembourgeois, Estro Armonico, Jonathan Kaell (né en 1975) dispense un accompagnement chambriste du meilleur effet, très souple. On regrettera la captation lointaine des vents au détriment des cordes – elles-mêmes trop timides pour donner un peu plus de caractère à cette musique plaisante mais tout à fait dispensable (8.573330). FC
Prokofiev à l’américaine avec Muti

Voici l’Orchestre symphonique de Chicago, sous la direction de son actuel directeur musical, Riccardo Muti, dans un des ponts aux ânes du répertoire symphonique, Roméo et Juliette de Prokofiev. Soulignons dès à présent l’excellence de la prise de son – les extraits provenant d’un concert d’octobre 2013 – qui permet à l’auditeur de bénéficier des moindres détails d’une partition dont on connaît depuis longtemps la luxuriance. Sur le strict plan musical, sans être véritablement déçu, on reste néanmoins quelque peu sur sa faim car, à l’instar de ce que l’on avait pu constater lors de leur dernière tournée européenne (voir ici et ici), Muti et Chicago nous donnent à entendre du beau son, du très beau son même, servi par une technique exceptionnelle, mais où sont les couleurs? La finesse des cordes dans le «Madrigal» ou dans « La Jeune Juliette » est digne de tous les éloges mais on pourrait souhaiter davantage de caractérisation comme, avec un orchestre voisin (Boston en l’occurrence), Ozawa avait su le faire il y a près de trente ans (Deutsche Grammophon). Surtout connu pour la beauté de ses cuivres, le Chicago Symphony trouve en maintes occasions l’opportunité de briller, le chef italien n’hésitant pas à parfois miser sur le spectaculaire («La Mort de Tybalt») et n’évitant pas toujours certaines lourdeurs. Pour autant, on salue la performance de l’orchestre pour un disque fort court mais de belle tenue qui, à notre sens, cède néanmoins le pas face aux références habituelles que sont notamment Ancerl, Dorati, Ozawa ou Gergiev où les accents russes sont plus marqués et la distance avec la pure brillance de la partition plus assumée (CSO-Resound CSOR9011402). SGa
Haydn: trois générations de quatuors

 
Constituant la base incontestée du répertoire du quatuor à cordes, Haydn, qui conféra ses lettres de noblesse au genre et écrivit le premier chapitre d’une histoire menant jusqu’à Bartók et au-delà via, notamment, Mozart et Beethoven, est honoré par deux splendides rééditions et une intéressante nouveauté.
Music & Arts publie, à la mémoire de son fondateur Frederick J. Maroth (1929-2013) et dans une restauration par Lani Spahr à partir des bandes et microsillons originaux, l’intégrale entreprise en 1951 pour la Haydn Society of North America, qui venait d’être fondée à Boston, par le Quatuor Schneider. Réalisée pour l’essentiel à New York, où elle fut doublée d’une exécution intégrale en seize concerts durant la saison 1951-1952, l’entreprise fut hélas interrompue le 5 octobre 1954, faute de moyens, au beau milieu de l’Opus 64 n° 1, dont on peut entendre ici les deux mouvements extrêmes (restés inédits jusqu’alors), et le quatuor ne se réunit ensuite plus jamais. Quarante-sept et demi (y compris Les sept dernières paroles du Christ sur la Croix) des soixante-neuf quatuors que l’on s’accorde généralement à attribuer à Haydn avaient alors été gravés – la première intégrale au disque ne devait aboutir qu’en 1976, grâce au Quatuor Aeolian (Decca) – et l’on peut relever que les Opus 2 n° 3 et Opus 2 n° 5 sont donnés ici sous leur forme originale de divertimenti avec deux cors (en l’occurrence les époux Weldon et Kathleen Wilber). D’origine lituanienne, Alexander Schneider (1908-1993), ancien second violon du Quatuor de Budapest (1932-1944), avait rassemblé autour de lui en 1950, à l’occasion du premier festival de Prades, trois jeunes Américains: le violoniste Isidore Cohen (1922-2005), futur membre du Quatuor Juilliard (1958-1966) et du Beaux-Arts Trio (1968-1992), l’altiste Karen Tuttle (1920-2010) et la violoncelliste Madeline Foley (1922-1982), remplacée en 1953 par Hermann Busch (1897-1975). La durée de vie cet ensemble fut extrêmement brève mais il laissera à jamais sa marque dans l’histoire précisément grâce à ce parcours haydnien, enfin réédité dans ce coffret de quinze disques (vendus au prix de huit), avec une notice (en anglais) de Tully Potter consacrée, pour l’essentiel, au contexte de ces enregistrements – les riches notices originales de Karl Geiringer et Marion M. Scott (en anglais), consacrées à l’analyse des œuvres, peuvent être téléchargées sur le site de l’éditeur. Tout au long du corpus, la netteté du trait et la fermeté de la pensée expurgent le phrasé de toute tentation chichiteuse, mais le Quatuor Schneider ne se départ jamais d’un charme et d’un moelleux très viennois. On a certes perdu l’habitude, dans Haydn, de tempi parfois aussi mesurés – même marqués «scherzo», les menuets restent des menuets – et du pathos dont s’entourent volontiers les tonalités mineures: la dimension préromantique est souvent mise en valeur et l’interprétation souligne, dès l’Opus 20, la prémonition de Beethoven. Mais ces versions ne sont nullement démodées pour autant, tant leur évidente musicalité, leur respiration naturelle, leur ardeur passionnée et leur qualité instrumentale s’imposent encore à l’auditeur, parvenant ainsi à captiver dès les tout premiers opus, où, pourtant, la forme et la personnalité se cherchent encore (CD-1281).
L’écoute parallèle de l’intégrale réalisée par le Quatuor Festetics chez Arcana entre 1993 (tout juste après que Michel Bernstein eut fondé cette maison d’édition) et 2005 est passionnante. Car autant, avec les Schneider, les textures étaient fondues et la dimension presque symphonique, autant prévaut ici une grande clarté, autonomisant nettement les quatre voix. Se revendiquant «sur instruments anciens», la formation hongroise, dans les faits, semble moins se rattacher à cette catégorie – la sonorité ne pâtit jamais des aigreurs ou maigreurs des cordes en boyau et, variant considérablement la couleur et la sonorité, sait même se faire veloutée – qu’à celle des interprétations «historiquement informées»: diapason à 421, respect intégral des reprises (y compris dans le retour des menuets et scherzos), travail sur les éditions et les manuscrits (auquel s’était également livré le Quatuor Schneider), placement des musiciens (de gauche à droite: violon I, alto, violoncelle, violon II). Et même à cette aune, l’élégance et l’exigence des Festetics, moins confortables et si différentes de la truculence parfois terrienne des Schneider, se situent généralement assez loin du radicalisme de certains, par exemple de la hauteur de vue parfois intimidante des Mosaïques, même s’ils n’hésitent pas à faire ressortir l’extraordinaire modernité de l’écriture. D’une grande régularité de conception et de réalisation, d’une droiture irréprochable qui ne dissimule pas pour autant le plaisir de jouer et faire partager cette musique exceptionnelle, le travail des Festetics susciterait une admiration sans réserve s’il n’était entaché de problèmes d’intonation hélas récurrents (hormis toutefois l’admirable violoncelliste Rezsö Pertorini). Les dix-neuf disques (au même coût unitaire – fort avantageux – que ceux du Quatuor Schneider), qui comprennent tous les recueils à partir de l’Opus 9 (mais excluent Les sept dernières paroles), soit au total cinquante-huit quatuors, sont enrichis d’une notice très complète (en anglais) de László Somfai (coffret A 378).
La main passe encore... Avec le Quatuor Doric, fondé en 1998, c’est une troisième génération qui, en débutant par l’Opus 20, se lance à son tour dans une intégrale, quelques mois à peine après qu’Hélène Vincent a remplacé, à l’alto, Simon Tandree. Se fondant sur une technique époustouflante, les Britanniques, qui ont, quatre ans plus tôt, déjà publié trois quatuors enregistrés en concert (Wigmore Hall Live), exacerbent toutes les dimensions des partitions – dynamiques, tempi, couleurs, phrasé. Les Doric assument crânement ces risques stylistiques, mais c’est parfois au prix d’une affectation excessive et leur approche à la fois très réfléchie et contrastée, bien que sur instruments «modernes», porte sans doute davantage encore que les Festetics la marque des «baroqueux» (album de deux disques Chandos 10831). SC
Robin Ticciati poursuit son exploration berliozienne

Tout juste nommé directeur musical du Glyndebourne Festival Opera en 2014, après avoir été pendant cinq ans chef principal du Scottish Chamber Orchestra, Robin Ticciati (né en 1983) poursuit chez Linn Records son exploration de l’œuvre de Berlioz – ses deux premières gravures ayant été consacrées aux Nuits d’été et à la Symphonie fantastique. Ce sont certainement ses deux mentors et compatriotes Simon Rattle et surtout Colin Davis qui l’ont sensibilisé à la musique du grand maître français, souvent plus célébré outre-Manche que dans l’Hexagone. Dans cette belle gravure de L’Enfance du Christ, le chef anglais tisse d’ensorcelantes atmosphères fondées sur une attention minutieuse aux nuances, ainsi qu’un réel travail sur les sonorités – particulièrement les graves de l’Orchestre symphonique de la Radio suédoise, admirablement mis en valeur. On regrettera le choix d’un chœur non francophone, celui de la Radio suédoise, en difficulté constante avec la prosodie française, tout comme les deux solistes masculins – Stephan Loges et Alastair Miles – qui s’en sortent mieux néanmoins grâce à une belle éloquence. Véronique Gens imprime quant à elle son art du chant en une interprétation d’une expressivité toujours convaincante. Une gravure intéressante pour la prestation de Gens et la direction de Ticciati, mais qui ne bouleverse pas une discographie pléthorique dans cette œuvre (double album CKD 440). FC
Florian Uhlig plus Eusebius que Florestan

Florian Uhlig (né en 1974) poursuit l’édifice de son monument à Schumann chez Hänssler Classic avec ce nouveau jalon – le huitième de l’intégrale en cours. Le pianiste allemand se fait Eusebius plutôt que Florestan. Le Carnaval s’en ressent. Quelque peu raide («Florestan», «Papillons», «Valse allemande») voire pesant («Arlequin»), le souffle – malgré le frémissement plutôt timide de la «Marche des Compagnons de David contre les Philistins» – convainc par sa cohérence opiniâtre et sa personnalité: le déroutant ballet de squelettes des «Lettres dansantes», la nudité désarmante, bouleversante même, d’«Eusebius»... Les Danses des compagnons de David présentent des qualités et des défauts tout à fait comparables: une individualité touchante, une ivresse trop vite étouffée. Un disque enrichi de compléments fort bien choisis, parmi lesquels quelques raretés absolues comme l’enivrante Fantasia sopra un tema di quatre suoni, partition fragmentaire de 1835 complétée par Joachim Draheim (CD 98.050). GdH
Aben Hamet attendra

L’an dernier, l’Atelier lyrique de Tourcoing a représenté Aben Hamet (1884) de Théodore Dubois dans une orchestration de Jean-Claude Malgoire et de Vincent Boyer. Un disque produit par cette maison d’opéra pas comme les autres témoigne de ce projet de réhabilitation inabouti à cause d’une mise en scène sommaire et d’une exécution perfectible. Malgré les carences de La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, cet enregistrement permet de se faire une idée de l’œuvre, à condition de s’accommoder d’une prise de son qui conserve les bruits de scène. Il y a des passages intéressants, par exemple, le trio entre Alfaïma, Zuléma et Aben Hamet au premier acte, l’air d’Aben Hamet au deuxième, l’air de Bianca au troisième, l’orage et la bataille au quatrième. Une reprise s’impose sans tarder mais de préférence dans l’orchestration originale et avec un meilleur orchestre. Cette version d’attente ne présente qu’un intérêt documentaire pour les inconditionnels de l’opéra français (Atelier lyrique de Tourcoing 2-134374). SF
Jommelli attendra

On découvre ces dernières années, au concert comme au disque, la considérable production de Niccolò Jommelli (1714-1774), compositeur immensément célèbre en son temps. Si le trois centième anniversaire de sa naissance n’a pas permis, à l’instar de celui de Carl Philipp Emanuel Bach, d’imposer un éclairage aussi éminent que celui de Rameau l’an passé, gageons que le temps saura lui rendre justice. Le présent disque ne répond malheureusement qu’imparfaitement à ce souhait, en raison notamment de son dévolu vers des œuvres assez mineures et une interprétation correcte sans plus. Le rare répertoire des cantates de chambre du maître italien, dont une douzaine a été composée très probablement avant 1753 et la période de Stuttgart, est ici défendu avec quatre cantates pour voix de soprano (Didone Abbandonata, E quando sara mai che alle mie pene, Partir conviene, addio! et La Gelosia), accompagnées de deux violons, alto et violoncelle, auxquels s’ajoute un clavecin en guise de basse continue. Des œuvres qui privilégient un usage virtuose de la voix soliste, malheureusement desservies par le timbre peu séduisant de Yetzabel Arias Fernández, aux variations de registre un rien forcées. L’accompagnement orchestral apparaît beaucoup trop sage, manquant de couleurs et de rebond rythmique pour apporter un réel soutien de caractère. Dommage, car l’édition soignée (élégante pochette cartonnée, textes des cantates et intéressant commentaire de Stefano Aresi – à chaque fois en français) laissait présager mieux. Jommelli attendra encore son heure (Pan Classics PC 10308). FC
Nielsen: trois intégrales pour un anniversaire
 
 
Trois grandes cités – Londres, New York, Stockholm – honorent Nielsen par une intégrale de ses Symphonies – et il n’est pas indifférent de relever que deux d’entre elles ont été réalisées en concert. La France reste, une fois de plus, en dehors du mouvement: alors que 2015 marque le cent cinquantième anniversaire de la naissance du compositeur danois, aucun de ces six jalons essentiels de l’histoire du genre dans la première moitié du siècle dernier n’est programmé dans les salles parisiennes. Toujours est-il que ces trois intégrales, parvenues à leur terme pour deux d’entre elles et à ses deux tiers pour la troisième, se révèlent très différentes, confirmant – en était-il besoin? – la richesse de cette musique et la passionnante variété des approches auxquelles elle peut donner lieu, d’autant qu’elle est portée ici par trois formations de grande qualité. Seules les préférences de l’auditeur permettront donc de départager ces versions.
LSO Live rassemble en un coffret l’intégrale précédemment parue en trois volumes successifs enregistrés en public entre octobre 2009 et décembre 2011 par Colin Davis et l’Orchestre symphonique de Londres (voir ici), dont il fut successivement principal guest conductor, le principal conductor et le president. Précédemment éditées dans des couplages ne respectant pas la chronologie, les Symphonies sont désormais présentées, toujours deux par deux, dans l’ordre de leur composition et sont complétées par un Blu-ray présentant le tout en «haute définition audio». Energique et dramatique, le chef anglais se montre aussi à l’aise dans la (relative) tradition des trois premières, dont il fait maintes fois ressortir une dimension quasi elgarienne, que dans la modernité des trois dernières, culminant sans doute dans une époustouflante Cinquième (coffret de trois SACD et un Blu-ray LSO0789).
Alan Gilbert et son Orchestre philharmonique de New York ont eux aussi achevé leur intégrale, publiée chez Dacapo: après les Deuxième «Les Quatre Tempéraments» et Troisième «Sinfonia espansiva», voici maintenant, toujours en concert, les Première et Troisième, d’une part, et les Cinquième et Sixième «Sinfonia semplice», d’autre part, enregistrées respectivement en mars et octobre 2014. Moins solennel et pesant que Davis, plus fin et acéré tout en ne le cédant en rien pour le souffle et le punch, le chef américain rend plus volontiers justice au caractère novateur des partitions et à leurs ambiguïtés, avec notamment une fantastique Sixième, déjà bien dans l’esprit de Chostakovitch. Un quatrième disque, comprenant les trois concertos (violon, flûte et clarinette), devrait prochainement paraître et sera regroupé avec les trois autres en un coffret: Gilbert aura été encore plus loin que Bernstein, l’un de ses prédécesseurs à New York, qui s’était fait en son temps l’un des plus éminents défenseurs de l’œuvre de Nielsen au disque (deux albums séparés 6.220624 et 6.220625).
La deuxième étape, toujours chez Bis, de l’intégrale de Sakari Oramo à la tête de l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm, dont il est le chefdirigent et le conseiller artistique depuis 2008, se place dans la parfaite continuité de la première, qui associait les Quatrième «L’Inextinguible» et Cinquième. Cette fois-ci dans les Première et Troisième, le geste conserve sa sûreté conquérante, la sonorité demeure somptueuse, servie par une splendide prise de son. Tout au plus pourra-t-on s’interroger sur ce Nielsen straussien, parfois peut-être trop ronflant ou pétaradant, mais il sera difficile de résister à son pouvoir de séduction (SACD BIS-2048). SC
Duo suisse, musique française

Se produisant ensemble depuis déjà longtemps, la violoniste Rachel Kolly d’Alba (née en 1981) et le pianiste Christian Chamorel (né en 1979) n’ont enregistré leur premier disque en duo qu’en 2013, sous le titre «Fin de siècle». Du très connu: la Sonate de Franck, le Concert de Chausson, avec le Quatuor Spektral, et en bis (comme au concert), le bref (moins de deux minutes) Interlude du Poème de l’Amour et de la Mer dans un arrangement pour violon et piano. Rien de contestable en termes de respiration, de dynamique et de tempi mais l’approche demeure ordinaire, en particulier dans la Sonate, qui manque d’émotion, de profondeur et de souffle pour nous faire chavirer – difficile de s’imposer parmi les excellentes versions qui se bousculent depuis des lustres. Les musiciens suisses affichent cependant d’authentiques tempéraments d’artiste et des moyens considérables. Avec la formation américaine, très compétente, ils ajoutent à la discographie une version aboutie du Concert: exécution maîtrisée, contrastée, évocatrice. Mieux qu’une carte de visite, ce disque suscite toutefois plus le respect que l’enthousiasme (Aparté AP102). SF
Quatre-vingt-dixième disque pour La Petite Bande!

Insatiable défricheur du répertoire baroque sur instruments d’époque, l’ensemble La Petite Bande en est déjà à son quatre-vingt-dixième enregistrement depuis son tout premier disque, dédié à Lully, en 1973! Avec cette nouvelle parution, consacrée à Telemann, il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources puisque les deux suites enregistrées ici attestent d’une indéniable influence française, notamment par la présence de nombreuses danses. La première, en la mineur, est d’une ampleur remarquable, de plus de trente minutes, comportant une Ouverture dramatique où la flûte à bec fait son entrée très tôt; Telemann se permet d’inclure cet instrument en un véritable concerto déguisé, marque de son apport italianisant, où Bart Coen laisse éclater toute sa virtuosité. On le retrouve ensuite dans une œuvre appelée «concerto» mais qui constitue davantage une œuvre de chambre avec ses trois instruments soutenus par l’inévitable basse continue. Plus mélodique, ce Concerto en sol pour flûte à bec, hautbois et violon annonce déjà l’éclat des Musiques de table plus tardives. Retour ensuite à l’influence française, dans la seconde suite (en sol) ici gravée, autour de l’un de ses instruments de prédilection, la viole de gambe, tenue par Sigiswald Kuijken. Le disque se conclut logiquement avec un Concerto en la mineur qui réunit les deux instruments solistes mis en avant dans ce disque. On retiendra surtout la superbe captation sonore, au plus près des instruments, en une légère résonnance très à propos pour éviter toute sécheresse dans ce répertoire. La Petite Bande, toujours en forme, prouve une fois encore sa capacité à faire ressortir tous les timbres de cette musique très riche (Accent ACC 24288). FC
Ludovic Morlot, un Français à Seattle

 
S’il a rompu, fin 2014, de façon prématurée son contrat de cinq ans avec La Monnaie, Ludovic Morlot (né en 1973), après avoir été assistant à Boston entre 2004 et 2007, a en revanche pris ses marques à l’Orchestre symphonique de Seattle, formation typiquement américaine par sa fiabilité et son professionnalisme: en 2011, soixante ans après le très bref mandat de Manuel Rosenthal, il est devenu le deuxième Français à occuper le poste de directeur musical, succédant ainsi à Gerard Schwarz, en fonctions depuis 1985. Une série de parutions récentes permet d’en juger, car comme bon nombre d’orchestres, celui de la ville principale de l’Etat du Washington est devenu son propre éditeur. Comme souvent de par le monde, on demande aux chefs français de faire partager leur prédisposition présumée pour la musique de leur pays: il n’est donc pas surprenant que trois des cinq volumes parus à ce jour soient intégralement consacrés à ce répertoire. Le tout premier, enregistré entre septembre et novembre 2012, fait entendre, par ordre chronologique, trois œuvres distinctes de près d’un demi-siècle au sein de la précieuse production de Dutilleux: la Première Symphonie, Tout un monde lointain (avec un Xavier Phillips au-dessus de tout soupçon, comme à l’accoutumée) et The Shadows of Time, autant de versions d’une grande honnêteté mais paraissant plus soigneusement travaillées que portées par une inspiration forte (SSM1001). Moins homogène par son programme, le deuxième volume, trop peu investi et manquant de punch, ne parvient jamais à convaincre, que ce soit dans le Ravel «ibérique» (Alborada del gracioso, Pavane pour une infante défunte, Rapsodie espagnole) ou dans la Troisième Symphonie de Saint-Saëns (avec l’organiste Joseph Adam, assez mal mis en valeur par la prise de son), alors même qu’il s’agit ici de captations de concerts donnés en juin et septembre 2013 (SSM1002). Le florilège fauréen, réalisé entre octobre 2011 et mai 2013, s’impose plus nettement: les rares et délicieux Masques et Bergamasques; la Fantaisie pour flûte (dans une orchestration de Yoav Talmi) avec l’excellent Demarre McGill, alors soliste de l’orchestre (il a rejoint Dallas depuis lors); une capiteuse Suite de Pelléas et Mélisande; les célèbres Berceuse (avec Alexander Velinzon, le tout nouveau concertmaster) et Elégie (avec Efe Baltacýgil, lui aussi fraîchement arrivé comme premier violoncelle solo); l’humour tendre de Dolly (dans l’orchestration de Rabaud); enfin, la Pavane, langoureuse à souhait mais souffrant du français pour le moins exotique de la Seattle Symphony Chorale (SSM1004). SC
Stéphane Denève, un Français à Stuttgart
 
A l’instar de Ludovic Morlot, Stéphane Denève (né en 1971) a accompli jusqu’à présent une grande partie de sa carrière à l’étranger – son site est d’ailleurs exclusivement en anglais, hormis des biographies officielles... en allemand et en espagnol – et est lui aussi fréquemment sollicité pour diriger la musique française. Music director de l’Orchestre national royal d’Ecosse (2005-2012), avec lequel il a notamment enregistré une intégrale Roussel de référence, il est désormais premier chef invité à Philadelphie (depuis 2014) et Chefdirigent de l’Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart (depuis 2011). Avec cette formation pas nécessairement aussi rompue au répertoire français que sa sœur de Baden-Baden et Fribourg, il a déjà réalisé en 2012 un remarquable programme Poulenc. Voici maintenant, toujours chez Hänssler Classic, deux volumes consacrés à Ravel, parus à quelques mois d’intervalle et enregistrés en studio entre octobre 2012 et juillet 2014. Si cette intégrale symphonique est nettement préférable à celle réalisée récemment à Lyon par Leonard Slatkin, les piliers de la discographie – Rosenthal, Martinon et Boulez, par exemple – ne sont pas pour autant menacés. Certes, le programme est exhaustif – incluant même la «Fanfare» persifleuse écrite pour le ballet collectif L’Eventail de Jeanne – et le travail orchestral se révèle de toute beauté, mais ce Ravel haut en couleur, au phrasé volontiers exagéré, gêne un peu par son caractère plus explicite et descriptif qu’allusif. Cette approche ne disconvient cependant pas nécessairement à certaines narrations – le ballet intégral de Ma mère l’Oye apparaît ainsi particulièrement réussi – et la rare «ouverture de féerie» Shéhérazade retrouve un lustre et un intérêt incontestables (deux disques séparés CD 93.305 et CD 93.325). SC
Jean-Luc Tingaud, un Français à Dublin
 
Certes, à la différence de Ludovic Morlot ou Stéphane Denève, Jean-Luc Tingaud (né en 1969) s’est avant tout fait connaître en France, où il dirige depuis près de vingt ans l’Orchestre-atelier OstinatO, et n’exerce pas (encore) de fonctions permanentes à l’étranger. Mais comme eux, il est sollicité pour interpréter le répertoire français hors de nos frontières et c’est avec la même formation – l’Orchestre symphonique national de la Radio-télévision irlandaise, dont le principal conductor est Alan Buribayev – qu’il a enregistré chez Naxos deux albums à seulement quatre mois d’intervalle.
Le premier est consacré au trop rare – à tous les sens du terme – Dukas, regroupant l’essentiel – sinon l’intégrale – de son œuvre symphonique. Dans une brève conductor’s note complétant la notice (en anglais), le chef indique que faute – aussi surprenant que cela puisse paraître – d’édition définitive de ces partitions, il s’est efforcé autant que possible de remonter à la source en consultant manuscrits et premières éditions. C’est la même probité qui habite sa direction, équilibrée mais pas ennuyeuse, d’une parfaite clarté de pensée, aérée et aérienne, alerte et élancée dans la Symphonie, qu’on place pourtant d’ordinaire plus volontiers dans une certaine tradition franckiste, mais qui respire ici un classicisme serein et juvénile, comme issu de la Symphonie en ut de Bizet. Plus courants au disque comme au concert, ce qui laisse place à davantage de concurrence, L’Apprenti sorcier et La Péri bénéficient d’une réalisation solide qui ne révèle nullement incompatible avec la musicalité et l’inspiration (8.573296).
Le travail est tout aussi remarquable dans le second album, intégralement consacré à Bizet: non pas à ses pages les plus célèbres – Suites de L’Arlésienne et de Carmen, Symphonie en ut – mais à des œuvres – à l’exception sans doute de la délicieuse Petite Suite – fort peu connues et, il est vrai, pas toutes aussi abouties. Les curieux partiront ainsi à la découverte de trois ouvertures de caractère fort différent: furtif parfum rossinien de l’Ouverture en la mineur (1855) d’un Bizet âgé de dix-sept ans; lointains échos verdiens et berlioziens dans la Marche funèbre (1869), prélude de La Coupe du roi de Thulé (opéra écrit pour un concours et dont il ne reste que des fragments); Patrie (1873), véritable poème symphonique lisztien, partagé entre pompe et sincérité. Mais c’est Roma (1868/1871) – Bizet avait séjourné à la villa Médicis quelques années plus tôt, où il avait commencé à écrire l’œuvre – qui tient une place centrale dans ce programme: de la (première) Symphonie en ut, elle n’a hérité que de la tonalité et de la dénomination de symphonie, car sa visée évocatrice, son style plus franchement romantique et hélas aussi son inspiration trop souvent convenue la distinguent nettement en termes de réussite comme de concision. Enfin, si cinq pièces des Jeux d’enfants (1871) pour piano à quatre mains ont été orchestrées et regroupées dans la Petite Suite, une sixième pièce (en fait orchestrée la première), «Les Quatre Coins», est demeurée isolée mais figure sur ce disque, qui s’attache décidément à donner une vue aussi exhaustive que possible de la production orchestrale de Bizet (8.573344). SC
Tchaïkovski: le match Ecosse-Angleterre
 
L’Ensemble à cordes de l’Orchestre symphonique de Londres et l’Ensemble écossais viennent d’enregistrer la Sérénade pour cordes de Tchaïkovski. Dirigée par Roman Simovic, attentif à l’articulation, à la tonalité et à la dynamique, la formation anglaise en livre une interprétation rigoureuse, souple et aérée. Les tempi et l’impulsion ne suscitent pas de reproche, sauf au début du premier mouvement, languissant (une minute de plus que dans la version concurrente), les cordes, splendides, se montrant irréprochables (LSO Live LSO0752). La formation écossaise en propose une version plus dans l’esprit de la musique de chambre (il n’y a que dix-huit musiciens); la sonorité laisse, par conséquent, une impression de plus grande transparence. Jonathan Morton obtient de cet ensemble une exécution acérée, alerte, élégante mais aussi fine et nuancée, presque trop délicate, par moments (Linn Records CKD 472). La balance penche donc en faveur de cette séduisante version mais pour cette confrontation, les deux formations ont placé la barre haut. Les compléments rendent ces deux disques recommandables. Les cordes londoniennes proposent une lecture méticuleuse et captivante du Divertimento de Bartók tandis que les Ecossais expriment de magnifique façon l’ambiguïté et la profondeur du Deuxième Quatuor de Chostakovitch arrangé par leur chef. SF
Wendy Warner, un second choix pour Haydn

Au sein du répertoire dévolu au violoncelle, les deux Concertos de Haydn font figure de passage obligé pour tout soliste. Il est donc difficile pour Wendy Warner (née en 1972), vainqueur du concours Rostropovitch de 1990, de renouveler l’approche de ces deux chefs-d’œuvre dont les lettres de noblesse ont été conférées par des noms aussi prestigieux que Rostropovich, Casals, Monighetti, Coin ou Queyras. Et pourtant, force est de constater que, sans remettre en cause les références existantes, la violoncelliste américaine ne démérite pas. Si sa vision du premier mouvement du Premier Concerto se caractérise surtout par une certaine affectation, les deux autres mouvements, et surtout le dernier, bénéficient d’une belle présence et s’avèrent finalement assez bien enlevés. On regrettera surtout ici l’orchestre, d’un soutien très discret à la limite de l’effacement, qui ne brille guère aux côtés de la soliste. Dans le Second Concerto, en dépit d’un jeu très propre, elle manque de caractérisation et s’avère assez poussive dans le premier mouvement. Quant au troisième mouvement, s’il est bien fait «plastiquement» parlant, il ne charme guère à l’inverse, par exemple, de Rostropovich, insurpassable à nos yeux dans cette page. Le principal intérêt musicologique de ce disque réside donc dans la présence du Concerto en ut majeur du Tchèque Josef Myslivecek (1737-1781), dont on connaît surtout quelques symphonies (enregistrées notamment par les London Mozart Players dans un disque paru chez Chandos). Toujours accompagnée par une sage Camerata Chicago dirigée par son fondateur, Drostan Hall, Wendy Warner joue honnêtement un concerto qui ne brille guère par son inventivité ou son rythme, le mouvement lent étant assez ennuyeux et le troisième mouvement possédant quelques affinités avec le premier mouvement du Premier Concerto de Haydn (notamment dans l’entrée en scène du violoncelle). En fin de compte, un disque de second choix mais qui ne dépare pas la discographie de Wendy Warner (Cedille Records CDR 900000 142). SGa
Mayr desservi par les voix

Franz Hauk fait partager depuis plusieurs années sa passion pour le compositeur bavarois Simon Mayr (1763-1845), dont la musique reste largement méconnue bien qu’il ait composé quelque soixante-dix opéras et plus de six cents œuvres sacrées tout au long de sa carrière! Son principal fait de gloire est d’avoir été le professeur de Donizetti pendant pas moins de neuf ans, après l’avoir repéré dans sa ville de Bergame. Avec ce onzième disque consacré à Mayr chez Naxos, Hauk contribue à sortir de l’oubli ce compositeur intensément prolifique, qui a passé l’essentiel de sa carrière en Italie. On retrouve précisément ici le premier enregistrement mondial de son premier oratorio, Jacob a Labano fugiens (Jacob fuyant Laban), destiné à l’hôpital des Mendicati de Venise, tout juste un an après son arrivée en 1790. Mayr étudie alors auprès de Ferdinando Bertoni, maître de chapelle de la Basilique Saint-Marc – rencontrant également son contemporain Piccinni au cours de cette période. On perçoit aisément dans l’œuvre la marque du style galant, rehaussée d’une belle imagination mélodique. Elle ne comporte que des voix solistes féminines, quatre sopranos et une mezzo, en une alternance de récitatifs et d’airs bien fastidieuse à la longue. Les rares interventions du chœur, tout comme la modestie de l’accompagnement orchestral, n’aident guère à animer l’ensemble. Mais c’est surtout l’insuffisance des solistes qui déçoit dans ce disque, les interprètes luttant constamment avec une justesse aléatoire. Dommage, car la direction toute en vivacité rythmique de Hauk éclaire souvent cette œuvre (Naxos 8.573237). FC
Barto et Eschenbach s’égarent dans Brahms

Le début du Premier Concerto pour piano de Brahms ne se passe pas trop mal mais les choses se gâtent dès que Tzimon Barto intervient sur la pointe des pieds pour poursuivre ensuite sur des tempi d’une lenteur exaspérante. Le pianiste et l’Orchestre symphonique allemand de Berlin dirigé par Christoph Eschenbach conservent cette option et malmènent la dynamique, tantôt diluée, tantôt appuyée. A cause de ces manières, l’œuvre s’amollit et perd de sa substance. Il faut de la patience pour supporter ensuite le traitement que les exécutants infligent au Second Concerto – l’introduction, misère. Les Ballades constituent un ratage de moindre ampleur mais cette version affectée et artificielle a au moins le mérite de susciter le désir de réentendre celle d’Arturo Benedetti Michelangeli. Barto et Eschenbach s’égarent (double album Capriccio C5210). SF
La rédaction de ConcertoNet
|