|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de février
02/15/2014
Les chroniques du mois
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Hannu Lintu dirige Enesco Hannu Lintu dirige Enesco
 Le Quatuor (avec piano) Mariani Le Quatuor (avec piano) Mariani
  Oui ! Oui !
Les Grandes Etoiles du XXe siècle par Gérard Mannoni
«Between Worlds» avec Avi Avital
Jonathan Nott dirige la Huitième de Mahler
Jonathan Nott dirige la Sixième de Mahler
Günter Wand dirige Brahms et Bruckner
Le Quatuor Matangi interprète Haydn
Le Quatuor Modigliani interprète Haydn
Marc Mauillon chante Poulenc
Verdi-Wagner. Imaginaire de l’opéra et identités nationales de Timothée Picard
Le Duo Pestova/Meyer interprète Cage
Eugène Onéguine à Covent Garden (2012)
Yuri Favorin interprète Liszt
Entretiens avec Eliane Radigue de Bernard Girard
Valery Gergiev dirige Prokofiev
Julia Fischer interprète Sarasate
Jan Lisiecki interprète Chopin
Filomena Moretti interprète Rodrigo
Daishin Kashimoto et Eric Le Sage interprètent Fauré
Cinq œuvres d’Helena Tulve
Paul Badura-Skoda interprète Mozart
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Carlo Maria Giulini dirige Schumann et Brahms
L’ensemble vocal Mélismes(s) interprète Fauré et Franck
Aurèle Marthan interprète Ravel
Frieder Bernius dirige Burgmüller
Tianwa Yang interprète Sarasate
Milos Karadaglic interprète Rodrigo
Œuvres concertantes anglaises par Tasmin Little
Hermann Bäumer dirige Westerhoff
L’Ensemble Hilliard interprète Pisano, Arcadelt et Marsh
Lawrence Renes dirige Wagner
Martin Helmchen interprète Mozart
Pas la peine
Jaap van Zweden dirige Mahler
Le Duo Invencia interprète Schmitt
Francesco La Vecchia dirige Clementi
Le Trouvère à Covent Garden (2002)
Marc Minkowski dirige Dietsch et Wagner
Denis Matsuev interprète Tchaïkovski
Natasha Paremski interprète Tchaïkovski et Rachmaninov
Le Trio Storioni interprète Beethoven
Tianwa Yang et Markus Hadulla interprètent Sarasate
Lukas Geniusas interprète Chopin
Le projet «Il Pergolese»
Howard Griffiths dirige Spohr
Hermann Bäumer dirige Gernsheim
Antony Hermus dirige Klughardt
Ronald Brautigam interprète Mozart
Hélas !
Le Duo Eckerle interprète Schumann
L’entretien du mois

Avi Avital
Le match du mois
 
Sixième de Mahler: Jonathan Nott vs. Jaap van Zweden
En bref
Quand Poulenc rencontre Eluard
Trois parcours parmi les Concertos pour piano de Mozart
Un violon outre-Manche
La redécouverte de Westerhoff
Yuri Favorin, un nom à retenir
Etudes de Chopin: Lisiecki vs Geniusas
ECM New Series pour échapper à la morosité ambiante
Fin de l’intégrale Fauré par Eric Le Sage
Tchaïkovski: Matsuev vs. Paremski
Verdi-Wagner: match nul
Ring symphonique: «Wo ist Brünnhilde?»
La guitare de Rodrigo, en solo et en concerto
Vaisseau fantôme: Dietsch sombre, Wagner échoue
Schumann, Schmitt, Cage: deux pianos ou quatre mains
Un Eugène Onéguine recommandable
Gergiev revient à Prokofiev
Eliane Radigue, femme libre et opiniâtre
Les Quatuors Matangi et Modigliani se confrontent dans Haydn
La sensibilité et la sincérité d’Aurèle Marthan
Burgmüller, trop tôt disparu
La sobre ferveur de Fauré et Franck
Sarasate à l’honneur
Pour l’Azucena d’Yvonne Naef
Clementi: décevantes symphonies chez Naxos
Un Beethoven dispensable
Symphonistes allemands oubliés: Spohr, Gernsheim, Klughardt
Quand Poulenc rencontre Eluard

Marc Mauillon (né en 1980) convainc quasiment sans réserve dans l’intégrale des mélodies de Poulenc sur des poèmes d’Eluard. Le timbre reste affaire de goût et la voix vibre peu mais le baryton, excellent styliste, soigne la prononciation, peaufine le phrasé, varie l’intonation. Guillaume Coppola (né en 1979) assure au piano un accompagnement vif, précis, spirituel. Les fans de Poulenc se régaleront (Eloquentia EL 1343). SF
Trois parcours parmi les Concertos pour piano de Mozart

 
Trois pianistes de différentes générations poursuivent, chacun à son rythme, leur parcours parmi les Concertos pour piano de Mozart.
Pour le cinquième album de son intégrale commencée voici plus de quatre ans chez Bis, Ronald Brautigam (né en 1954) réunit les Vingtième et Vingt-septième. De bonne facture, le pianoforte (réalisé par Paul McNulty d’après un Walter du début du XIXe) n’est pas écrasé par le petit effectif (quatorze cordes) de l’Académie de Cologne, que son directeur musical, Michael Alexander Willens, conduit sans routine. Mais si la dramatisation du K. 466 peut encore excuser une certaine raideur, celle-ci apparaît beaucoup moins opportune dans l’ultime K. 595, dont le Larghetto est expédié dans un tempo pour le moins surprenant (Bis-2014). Martin Helmchen (né en 1982) avance à un rythme beaucoup plus modéré puisque ce deuxième volume, associant deux œuvres dans la même tonalité de si bémol, suit de six ans le premier, également paru chez PentaTone Classics. Après la sécheresse de son aîné néerlandais, il apporte, dans le Vingt-septième, un réconfort bienvenu, de même que l’Orchestre de chambre des Pays-Bas avec son premier violon et directeur artistique, Gordan Nikolitch (par ailleurs dynamique leader du Symphonique de Londres), parfaitement au diapason de son soliste. Mais comme souvent, s’il est difficile de reprocher quoi que ce soit au pianiste allemand, son goût quasi irréprochable confine à la prudence et à la tiédeur, voire à l’atonie, même dans le frais Quinzième (PTC 5186 508). Dirigeant depuis son clavier un Orchestre de chambre de Prague plus engagé que raffiné, Paul Badura-Skoda (né en 1927) en est parvenu à son septième volume chez Transart (voir par ailleurs ici). La familiarité du pianiste autrichien avec ce répertoire n’est plus à démontrer – le premier de ses nombreux enregistrements (dont un déjà pour Transart) du Vingt-quatrième (pour lequel il joue ici de nouvelles cadences écrites en 2008) remonte à... 1951 (Westminster) et il a supervisé une édition du Vingt-cinquième. Naturel de la respiration et du phrasé, variété de l’expression, présence: l’octogénaire, malgré des doigts un peu moins fiables, surpasse sans peine ses cadets, le K. 503 apparaissant encore plus réussi que le K. 491 (TR176). SC
Un violon outre-Manche

La talentueuse Tasmin Little (née en 1965) propose une sélection d’œuvres anglaises assez brèves composées dans un esprit encore romantique entre 1888 et 1914. Elle les fait précéder, pour une durée égale, du Concerto pour violon bien plus tardif (1937-1942) d’Ernest John Moeran. D’ascendance en partie irlandaise, il tira son inspiration de lieux chers en Irlande, de leur histoire et, en particulier dans le Rondo central plein de sève, des modes et styles des traditions musicales. Finement orchestré, rhapsodique jusque dans le prélude lent du Finale, expressif et personnel, le Concerto se place bien au-delà d’une simple évocation bucolique bien que la violoniste anglaise et le Philharmonique de la BBC (Manchester) sous la direction de Sir Andrew Davis semblent y rechercher un certain idéal pastoral comme ils le font pour le célèbre Envol de l’alouette de Vaughan Williams (donnant son titre à l’album) mais qui en perd la force exaltée de ses essors. On peut préférer Hugh Bean et Sir Adrian Boult (EMI) ou la version plus récente de Sarah Chang et Bernard Haitink (EMI), comme, pour le Concerto, Lydia Mordkovitch et Vernon Handley (Chandos). L’archet romantique de Little réussit à l’élégante Légende de Delius et aux trois délicieuses petites pièces un rien salonardes d’Elgar, composées avant 1900. De l’école encore germanique également, Un chant de la nuit de Holst (1905) ne fut créé qu’en 1984 contre la volonté de sa fille Imogen mais la partition ne manque ni de corps ni de caractère ni d’attraits et l’interprétation en est assez convaincante. Toutefois, l’idée directrice semble être de doter l’ensemble du programme d’une certaine tonalité de couleur malgré la différence de caractère des partitions. Si on peut contester jusqu’à un certain point la vision, la prestation se tient et l’écoute en est agréable (Chandos CHAN 10796). CL
La redécouverte de Westerhoff

Malheureux Christian Wilhelm Westerhoff (1763-1806), depuis longtemps tombé dans l’oubli. Issu d’une famille de musiciens, il a été employé comme violoniste et contrebassiste à la chapelle de la cour de Burgsteinfurt (Westphalie) avant de passer, à partir de 1795, au service de la cour de la princesse Juliane von Schaumburg-Lippe, à Bückeburg (Basse-Saxe). Voici un disque qui ressuscite ce compositeur à travers trois œuvres de style classique fort intéressantes. La plus belle est certainement ce Concerto pour clarinette en si bémol majeur (1788) qui rappelle à bien des égards ce que pouvaient composer, pour le même instrument et à la même époque, un Anton Hoffmeister ou un Franz Krommer. L’entrée en matière est très belle mais c’est surtout le troisième mouvement, un thème faisant ensuite l’objet de plusieurs variations, qui, par ses sonorités hongroises ou bohémiennes, s’avère de toute beauté. Le clarinettiste Sebastian Manz est de bout en bout excellent et pleinement convaincu par ce qu’il interprète. Les concertos pour clarinette et basson ne sont pas légion et, hormis Carl Stamitz, Johann Friedrich Schubert et Peter von Winter, on n’en connaît guère à cette époque du XVIIIe siècle finissant. Voici donc qu’il nous faut compter avec Westerhoff qui livre là un Concerto (1790) agréable à écouter mais, avouons-le, sans grande imagination, les solistes (Manz à la clarinette, Albrecht Holder au basson) alternant nonchalamment leurs interventions avec celles de l’orchestre. Quant à la Symphonie en mi bémol majeur (1796), avec ses quatre mouvements, elle est également de facture classique (on pense là aussi aux réalisations de Krommer, Vanhal ou Herschel) mais quel beau morceau tout de même! L’Orchestre symphonique d’Osnabruck, dirigé avec verve par Hermann Bäumer (né en 1965), Generalmusikdirektor depuis 2003, sonne de la plus belle manière et conclut ainsi un disque, enregistré en mai 2010, hautement recommandable pour tous les amateurs de ce répertoire (cpo 777 598-2). SGa
Yuri Favorin, un nom à retenir

Quatrième prix au concours Reine Elisabeth en 2010, Yuri Favorin (né en 1986) excelle dans les Harmonies poétiques et religieuses de Liszt. Le pianiste, qui cultive une magnifique sonorité sur toute l’étendue de la dynamique, développe finement chacune de ces pièces, même les moins inspirées. Il manifeste une évidente affinité pour cette musique qu’il restitue avec imagination et justesse: impressionnants de maîtrise instrumentale, «Bénédiction de Dieu dans la solitude» et «Funérailles» révèlent un artiste d’une intelligence supérieure à suivre désormais de près (Muso MU006). SF
Etudes de Chopin: Lisiecki vs Geniusas
 
Deux jeunes pianistes laissent au disque leur interprétation des deux cahiers d’Etudes de Chopin.
Sous les ors d’une étiquette de prestige (qui lui offre une prise de son superlative), Jan Lisiecki (né en 1995) aborde des pièces qu’il a éprouvées sur scène. La diversité des climats bute quelque peu sur l’absence de violence et de rage. Déployant une virtuosité comme refoulée, ce toucher rempli de douceur et de nuances tranquilles n’est pourtant pas sans émouvoir. Le cantabile est même souvent poignant – à l’image de la tristesse qui inonde le mi bémol mineur de la Sixième Etude. Un piano aux beaux fruits – qu’on a envie de laisser mûrir encore (Deutsche Grammophon 4791039).
Deuxième prix du Concours de Varsovie en 2010, Lukas Geniusas (né en 1990) livre quant à lui un Chopin patient et subtil. Trop subtil parfois... au point que ses Etudes en paraissent plutôt fades – sentiment renforcé par le choix de tempos trop lents. Le contrecoup d’un toucher carré qui soigne l’articulation mais manque de rondeur comme de personnalité. Aucune faute de goût, mais une impression d’ensemble laborieuse et somnolente (Dux 0834). GdH
ECM New Series pour échapper à la morosité ambiante

 
ECM New Series n’a pas son pareil pour concevoir, le plus souvent avec des musiciens attitrés fidèles à sa ligne éditoriale, des objets musicaux non identifiés, aux marges de la musique dite «classique» – et parfois même au-delà –, dont le caractère et le mérite communs sont d’étonner l’oreille par des ambiances offrant d’excellents remèdes à la morosité ambiante.
Ainsi du «projet» «Il Pergolese», commandé par le festival Pergolesi Spontini de Jesi à une équipe pluridisciplinaire (jazz et «classique») et internationale: le pianiste et compositeur français François Couturier(né en 1950), la chanteuse et compositrice italienne Maria Pia De Vito (née en 1960), la violoncelliste allemande Anja Lechner (née en 1961) et le percussionniste italien Michele Rabbia (né en 1965), également crédité de samples et autres effets électroniques. Plus proches du jazz que du baroque, arrangements et improvisations (vocaux ou instrumentaux) se succèdent durant une heure: près d’un siècle après Pulcinella de Stravinski – on reconnaîtra d’ailleurs ici quelques-uns des morceaux de Pergolèse qu’il a lui-même utilisés – l’hommage au compositeur de La Servante maîtresse crée un univers sonore inattendu, mais toujours dans le confort de timbres fondus et d’une douce réverbération (481 0427).
Autre quatuor, mais purement – à tous les sens du terme – vocal, en revanche, que celui de l’Ensemble Hilliard, qui fête son quarantième anniversaire (et entame ce qu’il a annoncé comme étant sa dernière année d’activité) avec «Il cor tristo». Le titre de l’album est celui d’une œuvre (2008) commandée à Roger Marsh (né en 1949). Mettant en musique deux chants de L’Enfer de Dante, le compositeur anglais se démarque assez peu du style de la Renaissance, mais l’attention de l’auditeur est captée par une expression volontiers grinçante et théâtrale. Découpées en trois parties, ces 25 minutes alternent presque sans solution de continuité stylistique avec une proportion comparable de chants du XVIe sur des poèmes de Pétrarque, six venus d’Italie avec Bernardo Pisano et trois de l’école franco-flamande avec Jacques Arcadelt (481 0637).
Après des études avec Erkki-Sven Tüür, dont elle est, à ce jour, la seule élève, Helena Tulve (née en 1972) a travaillé à Paris dans la classe de Jacques Charpentier, puis s’est intéressée au chant grégorien. Formée dans ces horizons très variés, auxquels s’ajoute un intérêt pour le courant spectral et les traditions nationales, l’Estonienne syncrétise ces influences pour le moins hétérogènes en un langage original et personnel, dont les consonances ou notes repères ne sont jamais prétexte à la facilité, en même temps que typiquement balte par sa manière organique de se développer, sa fluidité temporelle, sa dimension cosmique ou son recours aux instruments rares. Six ans après un premier album («Lijnen»), elle revient chez l’éditeur munichois avec une anthologie de cinq œuvres enregistrées en 2009 et 2010, de durée comparable (11 à 14 minutes) et partageant une thématique spirituelle, voire métaphysique. Reyah hadas ´ala (2005), pour ensembles vocal (masculin) et instrumental, juxtapose de façon lancinante le traitement grégorien du texte («Le parfum du myrte s’élève») du poète juif yéménite Shalom Shabazi (1619-1720) et une utilisation novatrice des instruments anciens. Il y a du Crumb dans l’effectif et le propos de silences / larmes (2006): sur un discret fond tintinnabulant de verres accordés et de carillon éolien, le hautbois s’enroule autour de la soprano, qui chante ou murmure un poème de mère Immaculata Astre (née en 1951), supérieure de l’abbaye bénédictine de Notre-Dame du Pesquié (Ariège). Arboles lloran por lluvia (2006) donne son titre à l’album: comme en écho, la soprano et le contre-ténor se partagent le texte («Les arbres réclament la pluie») en ladin (langue du nord-est de l’Italie), finement accompagnés par un chœur d’hommes, une nyckelharpa (sorte de vielle suédoise) et des blocs à papier de verre. De texture nettement plus dense mais d’atmosphère pas moins rayonnante, les grandes vagues d’Extinction des choses vues (2007) pour orchestre témoignent de la fréquentation des cours d’été de Ligeti. Dans L’Equinoxe de l’âme (2008), la soprano, la triple harpe et le quatuor à cordes exacerbent le propos du mystique persan Sohrawardî (1155-1191), dans une traduction française qu’une diction fort peu soignée rend hélas quasiment inutile. Voici donc une excellente introduction aux grands espaces de Tulve, servie par les créateurs de ses œuvres, à commencer par la soprano et harpiste Arianna Savall (née en 1972) et le chef de chœur Jaan-Eik Tulve (né en 1967), directeur artistique de l’ensemble Vox Clamantis (476 4500). SC
Fin de l’intégrale Fauré par Eric Le Sage

Le voici enfin, ce dernier volume de l’intégrale de la musique de chambre avec piano de Fauré par Eric Le Sage et ses amis (lire la chronique du précédent volume). Les Sonates pour violon et piano bénéficient d’une interprétation nette, engagée, rigoureuse. Le jeu de Daishin Kashimoto accuse de temps en temps une légère raideur dans l’articulation mais le violoniste développe une sonorité suffisamment séduisante, quoique un peu mate, tandis que son partenaire livre une fois de plus une prestation haut de gamme. Quelques courtes pièces (Berceuse, Andante, Morceau de lecture, Romance), délicieusement jouées, mettent à terme à ce beau voyage en terres fauréennes (Alpha 604). SF
Tchaïkovski: Matsuev vs. Paremski
 
Après Rachmaninov et Chostakovitch, Denis Matsuev (né en 1975) en vient à Tchaïkovski, toujours sous l’étiquette Mariinsky (où l’on trouve déjà le Premier Concerto avec son cadet Daniil Trifonov). Dans ces enregistrements réalisés en mars et avril 2013, on admire, comme dans les deux précédents albums, une technique puissante et solide, un jeu varié et spectaculaire, mais tout cela n’apporte pas grand-chose de nouveau, d’utile et, surtout, de cohérent au Premier Concerto, où les versions de référence ne manquent évidemment pas. La verve et l’engagement du pianiste russe ne sont pas de trop pour soutenir l’intérêt dans le mal aimé Deuxième Concerto (dans la version révisée par le compositeur, et non pas celle abrégée par Siloti), qui trouve également un défenseur convaincant en Valery Gergiev, à la tête de son Orchestre du Mariinsky, mais suscitent les mêmes regrets que ceux de sa prestation parisienne en janvier 2011 dans la même œuvre (SACD MAR0548).
Sous sa propre marque, le Royal Philharmonic Orchestra met en vedette Natasha Paremski (née en 1987) dans le Premier de Tchaïkovski, hélas lesté de fioritures et facilités malvenues. Egalement enregistrée en studio en décembre 2012, la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov que, alors âgée de 15 ans seulement, elle avait déjà précédemment gravée (Bel Air Music) convient mieux au tempérament extérieur de la pianiste moscovite naturalisée américaine. Sous la houlette parfois un peu molle de Fabien Gabel, directeur musical du Symphonique de Québec depuis 2012, l’orchestre ne se montre pas réellement à son avantage (RPO SP 044). SC
Verdi-Wagner: match nul

Dans Verdi-Wagner. Imaginaire de l’opéra et identités nationales, Timothée Picard (né en 1975), co-auteur d’un Dictionnaire encyclopédique Wagner chez le même éditeur, résout brillamment une démonstration complexe: comment la personne et l’œuvre de Verdi et de Wagner fécondent au fil du temps les concepts d’«italianité» et de «germanité» et représentent les sphères méditerranéenne et germanique du Vieux continent dans l’imaginaire collectif. Ce spécialiste des relations entre littérature, musique et histoire des idées parsème son texte, dense et érudit, de multiples références romanesques, philosophiques, cinématographiques et historiques en retenant jusqu’aux plus faits les plus récents, telles la prise de parole politique de Riccardo Muti lors d’une représentation de Nabucco à Rome en 2011, dont il a exceptionnellement bissé le «Va pensiero», et l’inauguration controversée de la saison 2012-2013 de la Scala avec Lohengrin. L’auteur s’attarde sur les lieux communs qui existent bien avant le XIXe siècle et à cause desquels les deux compositeurs figurent au centre d’incessantes confrontations. Selon lui, aucune personnalité musicale équivalente en France ne se détache aussi nettement, même Debussy. L’essayiste évoque également quelques grands chanteurs, chefs d’orchestre et metteurs en scène fréquemment associés à Verdi et Wagner. Une contribution originale au double bicentenaire de 2013 (Actes Sud, 336 pages, 22,80 euros). SF
Ring symphonique: «Wo ist Brünnhilde?»

Pas d’une seule traite mais presque. En 65 minutes (quasi ininterrompues), ce nouvel enregistrement de l’arrangement de Henk de Vlieger (qu’on a pu entendre par exemple à Hong Kong) propose un voyage purement symphonique à travers les thèmes les plus marquants de la Tétralogie wagnérienne. L’absence de chanteurs est un principe qu’il faudra donc admettre avant d’acquérir ce disque, où l’expérimenté Orchestre royal de Suède se révèle assez irréprochable. Le côté patchwork (ou miniature) de l’ensemble ne fait évidemment pas de cette «orchestral adventure based on Richard Wagner» une expérience indispensable, mais cet arrangement a minima – très respectueux de la partition bien qu’il relève davantage de la couture que de la composition – s’écoute agréablement sous la baguette fluide et sobre de Lawrence Renes (SACD Bis Bis-2052). GdH
La guitare de Rodrigo, en solo et en concerto
 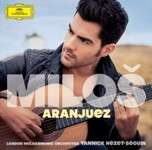
Une réédition et une nouveauté mettent en lumière divers aspects, souvent peu connus, de l’important catalogue que Joaquín Rodrigo (1901-1999), bien que pianiste de formation, n’en a pas moins légué à la guitare.
Transart reprend l’album que Filomena Moretti (née en 1973) avait gravé en juin 1998 pour Stradivarius et que le compositeur, destinataire d’une copie pour son quatre-vingt-dix-septième anniversaire, avait alors salué en termes élogieux. Couvrant plus de soixante ans d’activité créatrice, le programme réunit des pages originales, en recueil – le triptyque A travers la campagne espagnole (1938-1956), Trois petites pièces (1963) et Deux petites fantaisies (1987) – ou isolées – Sarabande lointaine (1926), Sur la terre de Jerez (1960), Invocation et Danse (1961) et Oiseaux de printemps (1972) – ainsi que des adaptations par Pepe Romero de pièces originellement destinées au piano – Pastorale (1926), hommage au vihueliste Luis Milán, et L’Album de Cecilia (1948). Faisant fi du néoclassicisme roué, de la naïveté ensoleillée et du folklorisme facile de ces partitions, la guitariste italienne les illustre avec une musicalité, un sens de la couleur et une intensité incontestables. Souhaitons donc que ce disque, alors déjà présenté comme un «volume 1» des œuvres complètes pour guitare seule, ne demeurera pas isolé et que l’intégrale sera cette fois-ci menée à son terme (TR177).
Dans un album intitulé «Aranjuez» et où seul son seul prénom apparaît sur la couverture, Milos Karadaglic (né en 1983) a notamment choisi une pièce solo, Invocation et Danse, qui suscite inévitablement la comparaison avec son aînée italienne... qui était alors plus jeune que lui: moins habité, moins riche de climats, le guitariste monténégrin, plus propre et consensuel, confère moins d’urgence, d’inquiétude et de drame à ce beau diptyque. Mais cet in memoriam Falla s’inscrit dans un programme cohérent – l’arrangement par Takemitsu de Michelle de Lennon et McCartney (seulement disponible, comme le Grand Solo de Sor, dans la version téléchargeable de l’album), doit donc être considéré comme une sorte de bis – et bien conçu, incluant deux pages de Falla, son Hommage pour Le Tombeau de Claude Debussy, en écho à celui de Rodrigo, et la transcription par Michael Lewin de la «Danse du meunier» du Tricorne. L’essentiel est cependant consacré aux deux principales pages concertantes de Rodrigo, le Concerto d’Aranjuez et la Fantaisie pour un gentilhomme, finement accompagnées par le Philharmonique de Londres et son principal guest conductor (depuis 2008), Yannick Nézet-Séguin (Mercury Classics/Deutsche Grammophon 481 0652). SC
Vaisseau fantôme: Dietsch sombre, Wagner échoue

Le paradoxe de cette publication – qui met en parallèle l’exhumation du Vaisseau fantôme ou Le Maudit des mers (créé à l’Opéra de Paris le 9 novembre 1842) de Pierre-Louis Dietsch (1808-1865) et Der Fliegende Holländer (1841) de Richard Wagner (1813-1883) – est qu’elle confirme tant l’anachronisme des formations jouant sur instruments «d’époque» dans le répertoire wagnérien que les raisons pour lesquelles la partition de Dietsch est tombé dans l’oubli. La banalité de l’écriture musicale, le ridicule de l’orchestration, la naïveté confondante de la conduite dramatique condamnent l’œuvre de Dietsch à sommeiller dans les profondeurs des livres d’histoire. Même Marc Minkowski (dans un livret érudit pourtant enthousiaste) reconnaît que «pareil méli-mélo d’influences, de réminiscences, de similitudes devrait interdire au Vaisseau fantôme toute prétention théâtrale». Face à l’échec de cette réhabilitation (qui ne tient nullement aux interprètes – franchement exemplaires), la supériorité du Hollandais wagnérien (qui échoue en Ecosse, dans la version originale parisienne enregistrée ici) saute aux oreilles. Mais l’effectif des Musiciens du Louvre-Grenoble est si peu en adéquation avec l’ambition de l’œuvre que la sécheresse de l’accompagnement n’est jamais compensée par la précision et la finesse obtenue du resserrement du format instrumental. Le manque de densité comme de dynamisme qui naît de ce désépaississement banalise une partition qui s’ancre dans son époque et ne regarde plus vers l’avenir. La distribution est méritante, dominée par le Hollandais d’Evgeny Nikitin (qui s’impose sans forcer, notamment dans la beauté solennelle de son duo avec sa promise) et le Donald de Mika Kares (belle intonation, un peu juste en graves). On est, en revanche, déçu par la Senta saisissante mais inutilement emphatique d’Ingela Brimberg, le Georg anonyme et laborieux d’Eric Cutler et les interventions trop timides du Chœur de chambre philharmonique estonien. L’ensemble n’est pas vraiment au niveau de l’œuvre (coffret de quatre disques Naïve V5349). GdH
Schumann, Schmitt, Cage: deux pianos ou quatre mains

 
Dans le domaine de la musique pour deux claviers ou quatre mains, de récentes parutions donnent l’occasion d’évoquer, au fil de l’histoire de la musique, les intégrales en cours consacrées, avec des fortunes diverses, à trois compositeurs fort différents.
Naxos prévoit de consacrer sept disques à la réduction pour piano à quatre mains de l’intégralité de l’œuvre symphonique de Schumann et d’une sélection de sa musique instrumentale. Comme le premier volume, le deuxième se concentre sur la musique de chambre, comprenant principalement le «premier enregistrement mondial» de l’arrangement des deux premiers des trois Quatuors de l’Opus 41 (1842), réalisé en 1852 par Otto Dresel (1826-1890). Même si le talent de cet élève de Hiller et Mendelssohn n’est pas en cause et si son travail a été «revu» par le compositeur, faire oublier les cordes constituait sans doute une tâche insurmontable. Et comme le Duo Eckerle demeure le plus souvent laborieux et terne, bien trop en deçà du texte, quand il n’évoque pas fâcheusement les Liebesliederwalzer de Brahms. Conçues à l’origine pour un instrument à clavier, les Etudes pour le piano à pédalier: Six Pièces en forme de canon (1845), arrangées en 1888 – trois ans avant la version de Debussy pour deux pianos – par Theodor Kirchner (1823-1903), un proche de Schumann qui devint semble-t-il l’amant de Clara dans les années 1860, soulèvent moins de problèmes, mais l’interprétation du duo constitué en 2006 par Mariko et Volker Eckerle reste peu stimulante (8.559726).
Grand Piano parvient à la conclusion de sa série consacrée la musique pour deux pianos ou quatre mains de Florent Schmitt et confiée au Duo Invencia. Ce quatrième volume réunit des œuvres (pour quatre mains) écrites entre 1907 et 1912: les aphoristiques Trois Pièces récréatives, le diptyque Lied et Scherzo (originellement pour double quintette à vents avec cor soliste), les six courtes Humoresques (dont deux furent ensuite orchestrées) et, surtout, Une semaine du petit elfe Ferme-l’œil ou Les Songes de Hialmar, recueil qui doit une notoriété –relative mais justifiée – à l’orchestration qu’en réalisa le compositeur, avant d’en faire un ballet. Comme dans le premier volume, le duo résidant en Virginie et créé en 2003 par l’Américano-Arménien Andrey Kasparov (né en 1966) et l’Ukrainienne Oksana Lutsyshyn (née en 1964) manque malheureusement de conviction pour défendre cette musique certes pas aussi essentielle que le Psaume XLVII ou La Tragédie de Salomé mais dont le charme et la poésie sont apparentés à Fauré ou Ravel (GP624).
Naxos entreprend dans sa collection «American Classics» un cycle consacré aux œuvres pour deux claviers de John Cage et confié au Duo Pestova/Meyer. Le premier volume se révèle passionnant à plus d’un titre, associant des œuvres témoignant de l’évolution du style du compositeur. Destiné au duo Gold/Fizdale, A Book of Music (1944) pour deux pianos préparés consiste en un diptyque aussi développé (près de 35 minutes) que fascinant: s’il revendique une visée expressive et, de façon encore plus surprenante, une inspiration mozartienne, son travail tantôt ludique, tantôt spectaculaire, tantôt vindicatif sur les rythmes et les répétitions évoque les recherches menées à la même époque par Messiaen ou Blacher, tandis que son minimalisme hypnotique annonce aussi bien Ligeti que les «répétitifs» américains. Les cinq très brefs mouvements de la Suite pour piano jouet (1948), apparemment la première partition de musique «savante» jamais écrite pour l’instrument, traduisent une raréfaction goguenarde du matériau, n’excédant pas neuf touches et se restreignant même à cinq dans les mouvements extrêmes. Dans la Musique pour pianos jouets amplifiés (1960), Cage explore les concepts de work in progress et d’aléatoire pour installer une atmosphère doucement poétique et hors du temps qui n’est pas sans évoquer Crumb et que des bruitages variés (gazouillis, boîte à meuh, toux...) ne parviennent pas à perturber. Une réussite prometteuse à l’actif du duo formé en 2003 à Amsterdam par la Canado-Néozélandaise (résidant en Grande-Bretagne) Xenia Pestova (née en 1979) et le Luxembourgeois Pascal Meyer (né en 1979), qui avait déjà à son actif chez le même éditeur le mythique Mantra de Stockhausen (8.572878). SC
Un Eugène Onéguine recommandable

Mettant en scène Eugène Onéguine à Covent Garden en 2013, Kaspar Holten exploite le principe du souvenir en recourant à des doublures qui interprètent Onéguine et Tatiana jeunes. La scène de la lettre et le duel revêtent par ce biais une force dramatique incontestable. Mia Steensgaard a conçu pour cette production de 2013 des décors magnifiques (intérieurs bourgeois, nature en arrière-plan) tandis que Robin Ticciati sert le propos avec clarté, tact et sensibilité – ce chef fera de plus en plus parler de lui. La distribution n’appelle aucune réserve: Tatiana splendide de Krassimira Stoyanova, Eugène plus meurtri que cynique de l’excellent Simon Keenlyside, Olga touchante d’Elena Maximova, Lensky idéal de Pavol Breslik, Grémine de grande classe de Peter Rose, truculent Monsieur Triquet de Christophe Mortagne, nourrice exemplaire de Kathleen Wilkinson. Pour une critique en anglais, cliquer ici (Opus Arte OA 1120 D ou Blu-ray OA BD7132 D). SF
Gergiev revient à Prokofiev

Possédant déjà à son actif notamment une intégrale des Symphonies avec le Symphonique de Londres (Decca) et des Concertos pour piano avec l’alors dénommé Orchestre du Kirov et Alexander Toradze (Philips), Valery Gergiev revient à Prokofiev avec son Orchestre du Mariinsky pour un album associant deux des «tubes» du compositeur russe. Captée en avril 2012 à Moscou (au Conservatoire, où elle fut créée le 13 janvier 1945), la Cinquième Symphonie confirme avec éclat les affinités du chef avec ce répertoire: sa direction dramatique, tour à tour incisive et lyrique, va toujours de l’avant, sans temps morts, droit à l’essentiel, galvanisant l’orchestre tout en soignant les détails, la clarté des lignes et la variété des climats. Egalement enregistré en concert (en juin et octobre 2012 à Saint-Pétersbourg), le Troisième Concerto ne revêt toutefois pas le même intérêt, avec une association parfois brouillonne entre l’orchestre et le soliste, un Denis Matsuev diaboliquement efficace mais dont l’adrénaline virtuose et le survoltage ludique cèdent le pas, ici ou là, à d’inutiles afféteries (Mariinsky MAR0549). SC
Eliane Radigue, femme libre et opiniâtre

Après Tom Johnson, Bernard Girard publie ses Entretiens avec Eliane Radigue. La compositrice (née en 1932) retrace son parcours, évoque ses rencontres avec de nombreux plasticiens et musiciens d’avant-garde (à Paris, Nice, New York), la technologie sur laquelle repose sa musique, la spiritualité orientale qui alimente son œuvre. Elle s’affranchit rapidement de l’esthétique de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, avec lesquels elle a travaillé dans les années 1950, pour développer un langage personnel, recherche incessante sur le son et l’espace. Eliane Radigue, qui, depuis une dizaine d’années, conçoit désormais des pièces pour instruments acoustiques, témoigne de sa volonté de s’émanciper en tant que femme dans un courant aussi confidentiel. Le philosophe, spécialiste de la musique contemporaine, complète cet entretien des plus intéressants en échangeant quelques propos éclairants avec deux interprètes de sa musique, Carol Robinson et Emmanuel Holterbach. L’ouvrage comporte en annexe une bibliographie, une discographie, une filmographie ainsi qu’une liste d’œuvres mais une synthèse chronologique, même succincte, des principales étapes de l’existence d’Eliane Radigue aurait également été utile. Le portrait que Bernard Girard dresse en préambule de cette femme libre et opiniâtre compense toutefois cette lacune (Aedam Musicae AEM-131, 144 pages, 16 euros). SF
Les Quatuors Matangi et Modigliani se confrontent dans Haydn
 
Deux formations appartenant à la même génération, constituées respectivement en 1999 et 2003, dédient leur plus récent album à Haydn, figure obligée du répertoire pour quatuor à cordes.
Si le compositeur était déjà au programme de l’un de ses précédents disques, c’est le premier que le Quatuor Matangi – qui a emprunté son nom à une déesse indienne dotée de quatre bras et d’un luth enchanteur – lui consacre intégralement. Intitulé «Haydn’s Nature» et illustré par une photo de couverture à la Caspar David Friedrich, il tombe un peu naïvement dans le panneau des sous-titres pittoresques que les éditeurs ont volontiers conférés aux œuvres de Haydn: se succèdent donc ici, dans une dramaturgie antinomique de la chronologie, le «Lever de soleil» (Opus 76 n° 4), «La Grenouille» (Opus 50 n° 6) et «L’Oiseau» (Opus 33 n° 3). Mais il est évidemment tout à fait loisible à l’auditeur de faire abstraction de ce parti pris et de goûter une interprétation instrumentalement remarquable, sans doute inspirée par un souci de vérité historique, parfois un peu trop recherchée dans les phrasés et sonorités mais non dépourvue pour autant d’élan et rendant justice à l’inventivité constante de cette musique – l’alacrité du Finale de l’Opus 33 n° 2 est irrésistible (Challenge Classics CC72592).
Le Quatuor Modigliani réserve son sixième album chez Mirare, comme le premier, cinq ans plus tôt, à Haydn, avec également trois quatuors tirés chacun d’un recueil différent: l’Opus 50 n° 1, l’Opus 76 n° 1 et l’avant-dernier achevé, l’Opus 77 n° 1. La réussite n’est peut-être pas aussi fulgurante qu’en 2008: plus de prudence et de mesure, d’exigence et de retenue, moins de spontanéité – au moment où les Ysaÿe tirent leur révérence, c’est comme si les Modigliani, qui, à leurs débuts, étudièrent avec leurs prestigieux aînés, voulaient prendre leur succession. Cela étant, au-delà de quelques coquetteries inattendues, ce Haydn ne se complaît nullement dans le sérieux ou la tristesse, comme en témoigne par exemple le Vivace conclusif de l’Opus 50 n° 1 (MIR 231). SC
La sensibilité et la sincérité d’Aurèle Marthan

Aurèle Marthan (né en 1986) enregistre une carte de visite consacrée à Ravel sur – ce n’est pas courant – un Fazioli: à peine 50 minutes de musique, une notice réduite à une biographie du pianiste mais des interprétations sensibles et presque sans faiblesse. Jeux d’eau imprègne modérément la mémoire et lui échappe encore un peu, la mélodie de Pavane pour une infante défunte ne se déploie pas si souplement que cela mais la Sonatine, parfois précipitée, surtout au début, lui tombe naturellement sous les doigts. Les Miroirs sont dans l’ensemble plutôt réussis: «Noctuelles» volubiles, «Oiseaux tristes» raffinés, «Une barque sur l’océan» prudemment chaloupée, «Alborada del gracioso» gravé à la pointe sèche, «Vallée des cloches» émouvante. De bon augure pour la suite (Polymnie POL 127 397). SF
Burgmüller, trop tôt disparu

De la même génération que Mendelssohn, Chopin, Schumann et Liszt, Norbert Burgmüller (1810-1836), au terme d’une existence dont le triste record de brièveté n’est guère battu que par Arriaga, Hyacinthe Jadin, Lekeu ou Pergolèse, laisse toutefois une œuvre quantitativement appréciable: deux Symphonies (la Seconde restée inachevée quoique partiellement orchestrée par Schumann), quatre Quatuors, une Sonate et plusieurs pièces pour piano ainsi que des lieder. Après avoir enregistré les Symphonies du compositeur allemand à l’occasion du bicentenaire de sa naissance, Frieder Bernius (né en 1947) et la Hofkapelle de Stuttgart (sur instruments anciens), qu’il a fondée en 2002, achèvent l’intégrale de son œuvre symphonique avec ce second album. Une bonne moitié en est consacrée à son unique Concerto pour piano (1829): exactement contemporain du Second de Chopin et précédant d’un an le Premier de Mendelssohn, cet Opus 1 ne peut sans doute songer à concurrencer l’un ou l’autre. Assez développé (33 minutes), il se révèle en effet un peu trop bavard, avec une tendance agaçante à répéter les même phrases, et les doigts du pianofortiste Tobias Koch (né en 1968) sont parfois sollicités sans réelle nécessité, mais cette musique a ses audaces et son fa dièse mineur possède une indéniable dimension romantique, même si le style reste sans doute plus proche encore de Spohr (l’un de ses maîtres) et Weber que de Mendelssohn ou Schumann. En complément, l’Ouverture en fa mineur (1825) est certes remarquable sous la plume d’un adolescent de 15 ans, mais c’est l’âge auquel Mendelssohn venait d’écrire son miraculeux Octuor, autrement plus inspiré, tandis que les quatre courts Entractes (1828) possèdent quelque chose du charme de Weber – le Deuxième évoque d’ailleurs assez clairement celui de la Première Symphonie de son aîné – ou de Schubert (Carus 83.297). SC
La sobre ferveur de Fauré et Franck

Dirigé par son fondateur Gildas Pungier, l’ensemble vocal Mélisme(s) chante les Sept paroles du Christ sur la croix (1859) de Franck dans une adaptation pour piano et harmonium. Grâce à l’acoustique, heureusement peu réverbérante, de l’Opéra de Rennes, l’œuvre parait nettoyée comme un vieux sou. Ductile, transparent et harmonieux, le chœur attire davantage l’attention que les solistes, le piano et l’harmonium se montrant, quant à eux, trop discrets. Quelques brèves pages de moindre intérêt de Franck et de Fauré complètent ce disque artisanal que les athées neurasthéniques s’abstiendront toutefois d’écouter (Skarbo DSK2143). SF
Sarasate à l’honneur

 
Pablo de Sarasate (1844-1908), l’un des plus grands virtuoses de son temps, créateur de bon nombre d’œuvres célèbres à commencer par la Symphonie espagnole de Lalo et le Troisième Concerto de Saint-Saëns, a exclusivement écrit pour le violon: à la différence, par exemple, de son contemporain Wieniawski, il n’a pas laissé de concerto mais a de nombreuses pièces de petites dimensions, parmi lesquelles quelques unes ont conservé une place au répertoire et font toujours la joie du public. Ce sont essentiellement celles qu’a choisies Julia Fischer (née en 1983) pour un programme essentiellement ibérique: les quatre cahiers de Danses espagnoles (soit au total huit pièces), le Caprice basque, la Jota aragonaise, la Sérénade andalouse et Le Chant du rossignol, soit les Opus 21 à 29, écrits entre 1878 et 1885, à l’exception de l’Opus 25, la Fantaisie de concert sur «Carmen», au prétexte qu’elle «nécessite un orchestre»: quitte à conclure sur l’une des deux pages les plus célèbres de Sarasate, pourquoi avoir opté pour les Airs bohémiens, qui ne requièrent ni plus ni moins l’orchestre et rompent l’unité géographique de l’album? Mais c’est bien la seule réserve qu’inspirent ces près de 70 minutes de grand violon, sagement accompagné par la pianiste allemande d’origine ukrainienne Milana Chernyavska (née en 1968): alors qu’en général, on enregistre Sarasate à 21 ans et Bach plus tard, la violoniste allemande attend la trentaine pour ce faire et se croit d’ailleurs obligée de justifier longuement ce choix dans la notice, qui, du coup, ne présente ni le compositeur, ni les œuvres (Decca 478 5950).
Démontrant qu’il n’y a pas que des pianistes en Chine, Tianwa Yang (née en 1987) publie coup sur coup chez Naxos les quatrièmes et derniers volumes de deux intégrales Sarasate parallèles, celle de ses œuvres avec orchestre et celle de ses œuvres avec piano. Elle achève son parcours concertant avec un florilège assez typique de l’inspiration du compositeur: paraphrases – sur Le Freischütz (1874) et Don Giovanni (vers 1905), moins réussies que celle sur Carmen – et cartes postales, ibériques – Jota de San Fermín (1894), saint patron de la Navarre, Jota de Pamplona (1904), ville natale de Sarasate – ou non – le créateur de la Fantaisie écossaise de Bruch a aussi laissé des Airs écossais (1892). Mais il se révèle sans doute à son meilleur dans les pièces de genre comme Introduction et Tarantelle (1899) et L’Esprit follet (1904) et Le Rêve (1908). L’essentiel du dernier volume de l’œuvre avec piano, quant à lui, est dédié à des arrangements à la Kreisler – trois Valses et deux Nocturnes de Chopin mais aussi de pièces de Bach (Air de la Troisième Suite), de Haendel (Largo de Xerxès) et de violonistes français du XVIIIe (Guignon, Leclair, Mondonville, Senaillé) – et une paraphrase – Souvenirs de «Faust» (1863), à ne pas confondre avec la Fantaisie sur «Faust», postérieure de onze ans. Mais ce disque au minutage très généreux prend fin sur 18 minutes d’une œuvre qui n’est liée à Sarasate que par l’édition qu’il en réalisa pour Schott, La Fée d’amour (en français dans le texte), «morceau caractéristique de concert pour un violon principal et orchestre ou piano» (1854) de Joachim Raff. Moins avantagée par la prise de son, la violoniste chinoise ne manque pas d’abattage et ne le cède presque pas à son aînée allemande du point de vue instrumental, ne serait-ce de légers problèmes de justesse et une sonorité moins séduisante, mais elle ne possède pas tout à fait la même personnalité et la même finesse. Si elle est bien secondée par l’ Orchestre symphonique de Navarre (fondé par Sarasate en 1879) et son ancien directeur musical (2002-2006) devenu chef honoraire, Ernest Martínez Izquierdo, l’accompagnement de Markus Hadulla paraît en revanche assez neutre (8.572276 et 8.572709). SC
Pour l’Azucena d’Yvonne Naef

Inutile de s’attarder sur ce Trouvère enregistré en 2002 dans la tiède mise en scène d’Elijah Moshinsky. Les spectateurs de Covent Garden en ont eu pour leur argent mais il n’y a pas de quoi bouleverser la vidéographie. Carlo Rizzi dirige honnêtement et la distribution produit de l’effet: Yvonne Naef impressionne en Azucena, José Cura chante et joue Manrico du mieux qu’il peut, Dmitri Hvorostovsky (comte de Luna), gâté par la nature, a décidément tout pour lui mais la Leonora de Veronica Villaroel marque peu les esprits. Notice indigente et sous-titres uniquement en anglais (Opus Arte OA MO6010D). SF
Clementi: décevantes symphonies chez Naxos

Quelques mois après la parution chez Naxos du premier volume consacré à l’œuvre symphonique de Muzio Clementi (1752-1832), le second présente les mêmes caractéristiques, à commencer par son programme: deux de ses quatre Symphonies parvenues jusqu’à nous (elles ne furent pas publiées de son vivant, bien que compositeur fût lui-même éditeur à Londres) – la Troisième «Le Grand National», traversée par des citations de l’hymne britannique, et la Quatrième – ainsi qu’une Ouverture – en ut majeur, de près d’un quart d’heure (en réalité le premier mouvement d’une autre symphonie dont le reste a été perdu) –, ces trois œuvres ayant été éditées par Pietro Spada dans les années 1970. Comme dans le premier volume aussi, l’Orchestre symphonique de Rome et son directeur musical, Francesco La Vecchia, pourtant tout à fait remarquables dans leurs albums consacrés aux compositeurs italiens postérieurs, de Sgambati à Ghedini en passant par Mancinelli, Casella et Petrassi, se montrent en revanche beaucoup trop sérieux et massifs, alors que cette musique encore fortement tributaire de Haydn, quoique sans doute postérieure de deux à trois décennies aux Londoniennes, ne demande qu’à pétiller davantage. L’ancienne intégrale de Claudio Scimone avec le Philharmonia (Erato) demeure donc préférable (8.573112). SC
Un Beethoven dispensable

Fondé en 1995, le Trio Storioni interprète sur instruments «d’époque» le Triple Concerto et le Septième Trio «A l’Archiduc» de Beethoven: sonorité quelconque, exécutions sans saveur bien que rigoureuses. La tension se relâche de temps en temps, la dynamique manque de tonus mais, malgré un début trop modéré, le Trio convainc davantage que le Concerto. Dirigé par son chef principal, Jan Willem de Vriend, l’Orchestre symphonique des Pays-Bas n’attire pas attention. Que les musiciens enregistrent plutôt des œuvres hors des sentiers battus (Challenge Classics CC2579). SF
Symphonistes allemands oubliés: Spohr, Gernsheim, Klughardt

 
Trois symphonistes allemands du XIXe, plus ou moins oubliés: c’est – forcément – chez cpo. Renommé pour ses opéras et encore présent au répertoire grâce à son Huitième Concerto pour violon «In modo di scena cantante» et à son Nonette, Louis Spohr (1784-1859) a écrit près de trois cents œuvres dont dix Symphonies numérotées (la dernière inachevée), traversant près d’un demi-siècle depuis l’époque de la Septième de Beethoven à celle de la Faust-Symphonie de Liszt. A la tête de la Philharmonie de la Radio NDR (Hanovre), Howard Griffiths (né en 1950), qui a déjà dirigé chez le même éditeur Danzi, Pleyel, Ries, Vanhal, Wilms, Wranitzky mais aussi Saygun, Schoeck et Tansman, est parvenu au quatrième des cinq volumes de son intégrale de ces Symphonies complétée par une sélection d’Ouvertures: comme Howard Shelley en 2012 chez Hyperion, il conclura avec les Septième et Neuvième. En attendant, voici la Quatrième «La Consécration des sons» (1832), fondée sur un poème éponyme de Carl Pfeiffer (1803-1831): bien que sous-titrée «peinture sonore (Tongemälde) caractéristique dans la forme d’une symphonie», elle s’écarte, à la différence de la Cinquième, du schéma classique, pour mieux suivre le déroulement du texte. Entre musique à programme et poème symphonique, l’inspiration romantique, fortement imprégnée par la nature, trouve une traduction musicale assez sage, plus proche de Mendelssohn ou de l’esthétique Biedermeier que de la Symphonie fantastique. Plus traditionnelle de structure et de facture, la Cinquième (1837) témoigne de davantage d’élan et d’ampleur. Le programme est complété par la brève Ouverture «Le Matelot» (1838) pour la pièce éponyme de Karl Birnbaum (1803-1865), non dépourvue de vivacité et de charme (777 745-2).
C’est avec un élève de Spohr, Louis Liebe (1819-1900), que Friedrich Gernsheim (1839-1916) se forma dans sa ville natale de Worms. Pianiste, il étudia ensuite à Leipzig avec Moscheles (mais aussi F. David) puis séjourna à Paris entre 1855 et 1860. Directeur musical de la Philharmonie de Rotterdam (1874-1890), il se fixa ensuite à Berlin, où il passa les quinze dernières années de sa vie. Son activité d’enseignement ne l’a pas empêché de nourrir un abondant catalogue chambriste, concertant mais aussi orchestral. Le très moyen Orchestre d’Etat de Mayence et Hermann Bäumer (né en 1965), Generalmusikdirektor depuis 2011, publient ce qui sera sans doute le premier des deux volumes d’une intégrale des quatre Symphonies, l’enregistrement réalisé voici une dizaine d’années par Siegfried Köhler et la Philharmonie d’Etat de Rhénanie-Palatinat (Arte Nova) n’étant plus disponible. Ami de Brahms et de Bruch, Gernsheim se révèle plus proche du second, du moins dans le romantisme confortable et bien tempéré des deux mouvements extrêmes de la Première (1875). Les mouvements centraux, quant à eux, portent peut-être encore la marque du dernier Schubert et, surtout, de Beethoven, évoquant respectivement, dans la même tonalité de si bémol et de mi bémol, les mouvements correspondants de la Neuvième et de la Troisième «Héroïque»: un an avant la Première de Brahms, qui fut qualifiée de «Dixième de Beethoven», l’enjeu demeurait toujours de savoir comment se dégager de cette figure écrasante. Extérieurement, la Troisième «Miriam» (1887), de dimensions un peu plus modestes (35 minutes) mais à l’effectif enrichi d’une harpe, rappelle davantage Brahms, mais la texture contrapuntique, les tournures harmoniques, la subtilité rythmique et le travail sur le matériau thématique apparaissent toutefois nettement moins élaborés. Si l’on peut de nouveau ici penser à Bruch, c’est cependant sans son génie mélodique et le temps paraît souvent bien long, hormis dans un bref Scherzo mendelssohnien (777 758-2).
Né à Köthen, August Klughardt (1847-1902) mena conjointement une carrière de compositeur et de chef: après avoir exercé des responsabilités à Neustrelitz (Mecklembourg), il fut de 1882 à sa mort directeur de la musique à la cour du duché d’Anhalt (Dessau). Remettant à l’honneur les trois dernières de ces cinq Symphonies numérotées, la Philharmonie anhaltoise de Dessau se souvient de son Generalmusikdirektor avec son lointain successeur, le Néerlandais Antony Hermus (né en 1973), qui exerce ces fonctions depuis 2009. Succédant au précédent enregistrement des Troisième et Quatrième, la Cinquième (1897), transcription (et transposition d’ut dièse à ut) d’un Sextuor à cordes écrit cinq ans plus tôt (et perdu), déroule ses cinq mouvements avec solidité et application, sans dévier de chemins assez prévisibles et, bien que Klughardt ait travaillé avec Liszt à Weimar et qu’il ait dirigé le Ring en 1893, l’influence de Brahms apparaît bien plus déterminante. En complément, l’ouverture de concert Au printemps, qui date de sa période weimaroise (1869-1873), donne de Klughardt une meilleure image que l’Ouverture de fête (1898), pour le centenaire du théâtre de la cour (et d’après une œuvre écrite vingt ans plus tôt pour une cérémonie de mariage), encore plus sérieuse et germanique que l’Ouverture pour une fête académique de Brahms – c’est dire (777 693-2). SC
La rédaction de ConcertoNet
|