|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité d’août
08/15/2020
Au sommaire :
Les chroniques du mois
En bref
ConcertoNet a également reçu
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 «Vienne 1900» autour d’Eric Le Sage «Vienne 1900» autour d’Eric Le Sage
 Le Trio Il Furibondo interprète Reger Le Trio Il Furibondo interprète Reger
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Œuvres de Nono et Sciarrino Œuvres de Nono et Sciarrino
 Lettres inédites de Poulenc Lettres inédites de Poulenc
 Masaaki Suzuki dirige Bach Masaaki Suzuki dirige Bach
 Ophélie Gaillard interprète Vivaldi Ophélie Gaillard interprète Vivaldi
  Oui ! Oui !
Reinbert de Leeuw dirige Mahler
Pierre-Dominique Ponnelle dirige Tchaïkovski
Symphonies de Beethoven transcrites par Liszt
La Dixième Symphonie – Hommage à Beethoven d’Henry
Herbert Blomstedt dirige Mahler
Aurelia Visovan interprète Hummel
Herbert Blomstedt dirige Schubert
Stefan Gottfried dirige Schubert
Paavo Järvi dirige Schmidt
Julian Prégardien chante Schubert/Zender
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Luis de Pablo de Jean-Noël von der Weid
Lionel Meunier dirige Bach et Händel
Le Chant des bêtes de Jean-François Lattarico
Osmo Vänskä dirige Mahler
Giancarlo Guerrero dirige Rouse
Mariss Jansons dirige Mahler
Gabriel Feltz dirige Mahler
Roger Norrington dirige Mahler
Vladimir Jurowski dirige Mahler
Robert Trevino dirige Bruch
Gianandrea Noseda dirige Berlioz et Borodine
Philippe Jordan dirige Berlioz
Dmitri Liss dirige Berlioz et Andriessen
Jean-François Heisser transcrit Berlioz
Giancarlo Guerrero dirige Kernis
Carlos Miguel Prieto dirige Falla
Lawrence Foster dirige Schubert
René Jacobs dirige Schubert
Edward Gardner dirige Schubert
Kevin John Edusei dirige Schubert
Maxim Emelyanychev dirige Schubert
L’ensemble l’Amoroso interprète Schubert
Rosemary Standley chante Schubert
Le Quatuor Van Kuijk interprète Mozart
Mark Minkowski dirige Mozart
Pas la peine
Gustav Mahler de Joseph-André Metten
Tomás Netopil dirige Mahler
Adám Fischer dirige Mahler
Josef Krips dirige Mahler
Andrew Davis dirige Berlioz
Heinz Holliger dirige Schubert
Philippe Jordan dirige Brahms
Hélas!
John Storgårds dirige Mahler
En bref
Mahler en concert
Mahler en studio
Falla un peu sage
Symphonistes oubliés: Bruch
Symphonistes oubliés: Schmidt
Symphonistes américains: Rouse
Symphonistes américains: Kernis
Symphonies de Beethoven dans tous leurs états
Symphonies de Schubert: l’ancien et les modernes
Schubert hors des sentiers battus
Tchaïkovski shakespearien
Hummel compositeur et arrangeur
Les animaux à l’opéra
La Fantastique en public... et à deux pianos
Mahler en concert
 
 
 
 

Parmi les parutions récentes de symphonies de Mahler, bon nombre consistent en des captations de concerts, parmi lesquelles quatre rééditions.
Un peu dans l’ombre de son frère Iván, Adám Fischer n’en est pas moins lui aussi un mahlérien convaincu, au point d’avoir créé un Festival Mahler à Kassel, où il était alors Generalmusikdirektor, un siècle après le compositeur, qui occupa ces fonctions entre 1883 et 1885, au moment où il commença à écrire sa Première Symphonie: l’œuvre était précisément au programme, le 8 juillet 1989, du deuxième des trois concerts de la première édition de cette manifestation, qui, sur un rythme biennal, n’alla pas au-delà de 1995. L’interprétation du chef hongrois, qui dirige une formation ad hoc de musiciens d’orchestres des deux Allemagne, d’Autriche, de Hongrie et des Pays-Bas, ne manque ni de saveur ni de générosité mais souffre de limites instrumentales et de l’acoustique de hall de gare de la salle municipale de Kassel (SACD Ars Produktion ARS 38 259).
Dans cette même Première, la version de Mariss Jansons avec son Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, enregistrée les 1er et 2 mars 2007, n’était jusqu’alors accessible qu’au travers d’une biographie audio du compositeur et c’est donc la première fois qu’elle est publiée séparément. Comme toujours, la réalisation du chef letton et de ses musiciens est superbe, mais on pourra regretter un manque de caractère et une tendance assez marquée à faire joli et à se concentrer sur de petits effets agogiques (ralentissements ou accélérations) un peu complaisants (BR-Klassik 900179).
On le retrouve dans une Troisième d’août 2001 (mais éditée seulement en 2019), son dernier enregistrement avec l’Orchestre philharmonique d’Oslo, dont il fut le directeur musical de 1979 à 2002. Les qualités coutumières de Jansons, dont la direction ferme se refuse ici toute facilité, sont au rendez-vous: soin apporté à la réalisation, respect de la partition, maîtrise des équilibres instrumentaux. Toutefois, malgré ses encouragements de la voix nettement perceptibles, l’ensemble demeure très mesuré, trop sage et dépourvu d’aspérités. Cela dit, côté vocal, la mezzo Randi Stene se montre tout à fait convaincante, de même que le Chœur philharmonique d’Oslo et la Maîtrise de la Radio norvégienne (album de deux disques Simax Classics PSC1272).
La Deuxième captée le 12 mars 2013 marquait la fin du mandat de près de dix ans Gabriel Feltz à la tête de l’Orchestre philharmonique de Stuttgart, durant lequel il a dirigé et enregistré bon nombre de symphonies de Mahler. Avec un sens dramatique aiguisé, il a le mérite d’aller droit à l’essentiel, sans s’encombrer de raffinements excessifs, avec des renforts vocaux de premier plan, tant la mezzo Tanja Ariane Baumgartner dans «Urlicht» que la soprano Chen Reiss et le Chœur philharmonique tchèque de Brno (album de deux disques Dreyer Gaido DGCD21116).
Dans une Quatrième du 20 janvier 1957 issue de l’inépuisable collection de radiodiffusions par la BBC constituée par Richard Itter, Josef Krips apparaît étonnamment pataud tandis que l’Orchestre symphonique de Londres, dont il avait été le principal conductor de 1950 à 1954, se montre sous un bien mauvais jour. Un naufrage que même Suzanne Danco, inhabituellement ampoulée, ne parvient pas à sauver (Cameo Classics CC 9112).
Dans sa collection «19th Century Classics» – pourquoi pas, si l’on considère comme au musée d’Orsay que le XIXe peut se prolonger jusqu’en 1914... – SWR Music réédite les deux premiers des cinq volumes réalisés pour Hänssler par Roger Norrington avec feu l’Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart (regrettablement fusionné depuis avec son cousin de Baden-Baden et Fribourg), dont il fut l’avant-dernier Chefdirigent de 1998 à 2011. La Quatrième (septembre 2005), chiche en vibrato mais généreuse en portamento, bénéficie de textures allégées et de tempi allants. Même si chaque détail a sans nul doute été minutieusement réfléchi et documenté, le chef anglais va bien au-delà d’une approche purement musicologique, fait preuve de caractère, surprend, exagère aussi, au point qu’on se trouve parfois à la limite de la caricature. La soprano Anu Komsi est parfaitement en phase et joue le jeu (SWR19524CD). On ne s’ennuie pas davantage dans une Cinquième (janvier 2006) cursive et pittoresque, où Norrington met en valeur le caractère contrapuntique de l’écriture et démontre que l’Adagietto peut très bien «fonctionner» en moins de 9 minutes (SWR19517CD).
Brucknérien reconnu, Herbert Blomstedt se lance à l’assaut de la Neuvième en juin 2018 avec l’Orchestre symphonique de Bamberg, dont il est chef honoraire depuis 2006 – une formation dont tous les pupitres font ici étalage de leur splendeur. D’une grande hauteur de vue, sans excès ni démesure, respirant même une certaine sérénité, cette Neuvième ne s’abandonne pas aux excès postromantiques. On est sans doute habitué à un Andante comodo initial plus passionné, à un Im Tempo eines gemächlichen Ländlers plus vif, à un Rondo. Burleske plus mordant, mais l’intensité ne faiblit pas un instant, jusqu’à l’Adagio final, magnifiquement... brucknérien (album de deux disques Accentus Music ACC30477).
Enfin, il ne faut pas oublier Le Chant de la terre, auquel le compositeur a accordé explicitement le sous-titre de «symphonie». En octobre 2018, Vladimir Jurowski et l’Orchestre radio-symphonique de Berlin, dont il est le Chefdirigent et directeur artistique depuis 2017, en donnent, sans forcer le trait, une version fidèle et de très bonne facture où Sarah Connolly s’impose par son aisance vocale et sa sobriété expressive, tandis que le vaillant Robert Dean Smith peine quand même parfois à lutter contre l’orchestre (Pentatone PTC 5186 760). SC
Mahler en studio
 
 
 

Mahler encore, mais cette fois-ci en studio, également pour plusieurs publications de ces derniers mois.
Osmo Vänskä et l’Orchestre du Minnesota, dont il est le directeur musical depuis 2003, poursuivent avec les Première (mars 2018), Deuxième (juin 2017), Quatrième (juin 2018) et Septième (novembre 2018) un cycle entamé en 2017 avec les Cinquième et Sixième: des interprétations très finement ouvragées, grâce à un superbe travail d’orchestre et une façon de scruter la partition à la loupe, qualités dont on sait que les revers sont le manque de naturel, l’impression que tout est soigneusement apprêté et léché, la tendance à la démonstration et au narcissisme. Cela dit, Mahler c’est de l’orchestre, et les amateurs ne seront pas déçus, particulièrement dans la Septième, tandis que les partenaires – la mezzo Sasha Cooke, la soprano Ruby Hughes et Chorale du Minnesota dans la Deuxième, la soprano Carolyn Sampson dans la Quatrième – sont aussi de haut niveau (SACD Bis BIS-2346, BIS-2296, BIS-2356 et BIS-2386).
Après la Neuvième, Tomás Netopil et l’Orchestre philharmonique d’Essen, où il est Generalmusikdirektor depuis 2013, en viennent en mai 2019 à la Sixième, dans la ville même où elle fut créée le 27 mai 1906. Voici encore une formation de très bon niveau et une interprétation non dépourvue de qualités, à laquelle on pourra seulement reprocher de manquer parfois de tension et d’incandescence, notamment dans un Andante moderato assez froid, et de s’abandonner un peu trop au stop and go. A noter, pour les mahléromanes: reprise dans le premier mouvement, Scherzo en deuxième position et deux coups de marteau dans le finale (album de deux disques Oehms Classics OC 1716).
Parmi les arrangements réalisés par la «Société d’exécutions musicales privées» fondée après la Première Guerre mondiale par Schönberg, figure celui de la Quatrième Symphonie par l’un de ses anciens élèves, Erwin Stein. Dans le même esprit, Michelle Castelletti (née en 1974) a adapté la Dixième pour un effectif similaire (flûte/piccolo, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, percussion, harpe, harmonium/piano et quintette à cordes, éventuellement à plusieurs pupitres, soit quatorze cordes pour le présent enregistrement). Mais pour cette symphonie, à ce travail d’adaptation s’ajoute nécessairement celui de la réalisation et même de l’achèvement de la partition, puisque Mahler ne put mener à bien que les premier et troisième mouvements: à cette fin, la compositrice et chef d’orchestre maltaise s’est plongée dans l’ensemble des sources publiées et manuscrites. Dans cette Dixième déjà très controversée et assez problématique, elle introduit donc aussi sa propre subjectivité – par exemple le recours à des percussions jamais utilisées par Mahler ou le choix de maintenir ce que d’autres éditeurs tiennent pour des erreurs de plume. Défendu par l’Orchestre de chambre de Laponie et John Storgårds , qui en est le directeur artistique depuis 1996, le résultat est consternant de laideur, à commencer par des glissandi invraisemblablement vertigineux, qui, dès le sublime Adagio, évoquent davantage Dix que Klimt, tel un carnaval ou un cirque grotesque et criard, comme si Mahler préfigurait ici Hindemith (SACD Bis BIS-2376).
Pour Le Chant de la terre, plutôt que de recourir à l’arrangement de chambre commencé en 1921 par Schönberg et achevé en 1983 par Rainer Riehn, qui a connu quelque succès ces dernières années, Reinbert de Leeuw (1938-2020) a préféré réaliser le sien en 2010, pour un effectif à peine plus large (quinze musiciens jouant de dix-neuf instruments, sans compter les percussions). «L’Adieu» conclusif n’en est que plus bouleversant quand on sait que le compositeur, pianiste et chef néerlandais est décédé le 14 février dernier, quelques jours après avoir terminé cet enregistrement. Et quel travail magnifique! Sans renoncer à toute puissance orchestrale, il joue aussi sur des sonorités arachnéennes, bien dans l’air du temps, celui de Trois Poésies de la lyrique japonaise de Stravinski ou des Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé de Ravel. Il est vrai que l’ensemble bruxellois Het Collectief, déjà associé à de Leeuw pour un très bel album Janácek, confirme son excellence. Si Yves Saelens n’est pas toujours à l’aise, la voix posée et la retenue expressive de Lucile Richardot s’accordent bien à ce qui fait figure de testament de Reinbert de Leeuw (Alpha 633). SC
Falla un peu sage

Bien belle idée que de rendre hommage aux plus beaux chefs-d’œuvre pour orchestre de Manuel de Falla (1876-1946), tout de grâce et d’esprit: le soutien et l’admiration réciproques de Debussy et Ravel furent sans doute une des clés de l’éclosion de ce talent ibérique, qui explique son heureux maintien au répertoire de nos jours. On peut fait confiance au chef mexicain Carlos Miguel Prieto (né en 1965) pour donner du style à ces pièces délicieuses, même s’il reste limité par le niveau de l’Orchestre des Amériques. Créée en 2002 par un groupe privé, cette formation regroupe des jeunes musiciens de haut niveau, âgés entre 18 et 30 ans et recrutés dans plus de vingt-cinq pays. C’est donc l’occasion pour ces jeunes pousses de s’essayer à la discipline de l’orchestre, avant un recrutement dans une formation plus connue. On perçoit d’emblée les qualités individuelles, surtout parmi les solistes, même si l’ensemble reste trop souvent prudent. C’est surtout le cas dans le ballet Le Tricorne (1919), où l’on trouvera des versions concurrentes autrement plus enlevées et dynamiques, notamment les gravures historiques d’Ernest Ansermet. Le disque vaut toutefois pour la belle version des Nuits dans les jardins d’Espagne (1916), où le piano souverain de Jorge Federico Osorio (né en 1951) domine l’orchestre (Linn Records CKD 825). FC
Symphonistes oubliés: Bruch

Max Bruch, dont le 2 octobre prochain marquera le centenaire de la mort, ne doit pas être cantonné à son éternel – à tous les sens du terme – Premier Concerto pour violon (et peut-être à quelques pièces pour clarinette et alto). Décidément, comme avec Saint-Saëns, né trois ans plus tôt et disparu un an plus tard, il faut aller au-delà de rares pages demeurées au répertoire et, surtout, du cliché d’académisme accolé au nom du compositeur allemand, dont la solidité du métier compenserait une inspiration en berne, alors qu’il y a toujours chez eux une haute exigence, un refus de la facilité et une noblesse dans l’expression. C’est ce que confirme cette anthologie orchestrale, centrée sur les trois Symphonies (1868, 1870 et 1882), toutes portées par un vrai souffle, la Deuxième peut-être plus encore que les deux autres. On peut bien sûr penser à Schumann ou, dans la même génération, à Brahms, mais Bruch possède une vraie personnalité, indéniablement romantique, dans le sentiment comme dans l’élan. Robert Trevino (né en 1984), directeur musical de l’Orchestre symphonique d’Euskadi et chef principal de l’Orchestre symphonique de Malmö, défie audacieusement l’insurpassable intégrale réalisée dans les années 1980 à Leipzig par Kurt Masur (Philips): de fait, l’Orchestre symphonique de Bamberg paraît plus massif et touffu, et la direction, plus généreuse que nuancée, ne veille pas toujours à alléger le propos. Mais on lui accordera d’avoir rétabli l’Intermezzo (Andante con moto), édité en 2016 seulement, qui se trouvait originellement en deuxième position de la Première Symphonie et de proposer des compléments intéressants: le Prélude du premier acte de l’opéra La Lorelei (1863), le Prélude, la Marche funèbre et un Entracte de l’opéra Hermione (1872) ainsi que le Prélude de l’oratorio Ulysse (1872) – autant de pages démontrant que bien des intéressantes découvertes restent encore à faire (album de deux disques CPO 555 252-2) SC
Symphonistes oubliés: Schmidt

Même si Kirill Petrenko l’a récemment remis au répertoire du Philharmonique de Berlin, Franz Schmidt (1874-1939) n’encombre ni les programmes de concert, ni les rayons des discothèques. Elève de Bruckner et Fuchs, excellent pianiste, il fut violoncelle solo de l’Opéra de Vienne de 1896 à 1914 et laisse notamment quatre symphonies de belles proportions (environ trois quarts d’heure chacune). Dès la Première (1899), prix de la Société des amis de la musique, la générosité mélodique, le caractère autrichien et la richesse contrapuntique s’imposent. Encore plus raffinée et grandiose à la fois, la Deuxième (1913), dédiée à Franz Schalk, déploie de façon radieuse et conquérante un orchestre straussien, notamment pour un gigantesque deuxième mouvement à variations, qui tient tout à la fois lieu de mouvement lent et de scherzo. La Troisième (1928), dédiée au Philharmonique de Vienne, revient à un effectif plus modeste, identique à celui des deux dernières symphonies de Schubert: elle fait partie de ces 513 (!) œuvres conçues pour un concours de composition organisé à l’occasion du centenaire de sa mort par la Société des amis de la musique et la compagnie Columbia, consistant à écrire «dans l’esprit romantique par lequel vit la musique de Schubert, en particulier sa Symphonie "Inachevée"». Derrière la Sixième d’Atterberg, Schmidt obtint le deuxième prix et si son style évolue vers un chromatisme parfois assez sinueux, le scherzo n’en conserve pas moins quelque chose de brucknérien. L’ultime Quatrième (1933), dédiée à Oswald Kabasta qui en dirigea la création, peut être considérée comme le chef-d’œuvre de Schmidt, magnifique construction d’un seul tenant mais, avant tout, bouleversant requiem à la mémoire de sa fille Emma, décédée à l’âge de 30 ans, en même temps que derniers feux d’une Autriche postromantique qui s’apprêtait à basculer dans la tragédie. Après l’intégrale de son père Neeme et l’oratorio Le Livre des sept sceaux par son frère Kristjan (tous deux chez Chandos), Paavo Järvi propose sa propre intégrale (enregistrée entre mars 2013 et avril 2018), qui vient s’ajouter à celles de Vassily Sinaisky (Naxos) et, surtout, de L’udovit Rajter (Opus), qui fut l’un des disciples du compositeur. On n’a pas toujours connu l’ancien directeur musical de l’Orchestre de Paris aussi expansif, car ici, brillant et puissant plus qu’onctueux, il lâche assez largement la bride à l’Orchestre symphonique de la Radio hessoise (Francfort), dont il est désormais le chef honoraire après en avoir été le Chefdirigent de 2006 à 2013. En complément, on trouvera également l’Intermezzo de l’opéra Notre-Dame (1904) (coffret de trois disques Deutsche Grammophon 4838336). SC
Symphonistes américains: Rouse
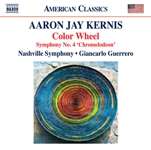
Défendues par l’Orchestre symphonique de Nashville et le Costaricien Giancarlo Guerrero, son directeur musical depuis 2009, deux symphonies de compositeurs détenteurs du prix Pulitzer (respectivement 1993 et 1998) paraissent au même moment dans la série «American Classics» de Naxos: deux compositeurs qu’on peut qualifier de symphonistes à en juger par le nombre d’œuvres auxquelles ils ont donné ce nom. L’occasion de vérifier si être un «symphoniste américain» signifie nécessairement ne pas froisser les oreilles des mécènes et du public, ressources principales des institutions musicales.
La Cinquième Symphonie (2015) restera comme l’ultime de Christopher Rouse (1949-2019), intégrant bon nombre d’allusions à la Cinquième... de Beethoven, qui a décidé de la vocation du compositeur lorsqu’il l’entendit pour la première fois à l’âge de six ans. D’un seul tenant et d’une durée d’une demi-heure, elle s’inscrit par son néoclassicisme motorique, son académisme froid et un peu ironique dans l’esprit des années 1940 ou 1950 – on pense parfois à Hindemith ou, pour rester aux Etats-Unis, à William Schuman. Hormis le moment central, sombre et lyrique (mais interrompu à deux reprises par un scherzo un peu goguenard), l’écriture est volontiers virtuose, animée par une énergie qui peut même se faire violente. En deux parties enchaînées (elles-mêmes subdivisées), le Concerto pour orchestre (2008), conformément à la loi du genre, s’attache «essentiellement à accorder à chaque musicien une chance de briller». Ce seul plaisir d’écrire pour l’orchestre suscite une demi-heure de musique assez changeante et décousue. Enfin, Supplica (2013) pour cuivres, harpe et cordes, de nature plus explicitement tonale, évoque l’Adagio de Barber et la Fantaisie sur un thème de Tallis de Vaughan Williams (Naxos 8.559852). SC
Symphonistes américains: Kernis

Aaron Jay Kernis (né en 1960) en est parvenu quant à lui à sa Quatrième Symphonie «Chromelodeon» (2018). Pour lui, une symphonie, selon la célèbre formule de Mahler, peut contenir un univers entier mais il explique toutefois ne s’être inspiré ici que d’«éléments musicaux». Le titre rappelle l’un de ces instruments microtonaux inventés par Harry Partch mais c’est une fausse piste, puisque le compositeur, reprenant l’étymologie des trois mots composant ce néologisme, affirme qu’il s’agit simplement pour lui d’écrire «une musique chromatique, colorée, mélodique, interprétée par un orchestre». Si le premier mouvement («Out of Silence»), de caractère méditatif, est inspiré des écrits sur le silence du moine bouddhiste Thích Nhất Hạnh et de John Cage, il n’emprunte en rien le style de ce dernier. Le deuxième consiste en des variations sur «Lascia ch’io pianga» de Haendel et le finale, «Fanfare Chromelodia», conclut brièvement sur une note plus dynamique sinon positive. En complément, il est encore question de couleur avec Color Wheel (2001): une «roue de couleur» qui doit son titre à la volonté d’opposer des couleurs primaires – Kernis, comme Messiaen, associe des couleurs à certaines harmonies – et la ronde extatique des derviches. Créée sous la direction de Wolfgang Sawallisch pour l’inauguration de Verizon Hall et le centenaire de l’Orchestre de Philadelphie, ville natale de Kernis, la pièce a la virtuosité d’un concerto pour orchestre portant des influences très diverses (Messiaen, Britten, Dutilleux, Bernstein) et dégageant une énergie plus positive que la symphonie (Naxos 8.559838). SC
Symphonies de Beethoven dans tous leurs états
 
Les symphonies de Beethoven n’ont pas fini d’inspirer non seulement les interprètes mais aussi les compositeurs, dont elles marquent le style, voire pour certains l’œuvre même: au-delà de simples arrangements tel celui de Hummel (voir par ailleurs ici), la manière dont Liszt ou Pierre Henry se saisissent de ce corpus tient au moins autant de la (re)création que de l’adaptation.
Entre 1837 et 1865, Liszt transcrit les neuf symphonies: à l’époque, la transcription constitue certes, faute d’autres moyens de diffusion, un moyen de faire connaître la musique orchestrale, mais le niveau technique exigé en l’espèce est tel que ce travail n’était manifestement pas destiné aux musiciens amateurs, même d’excellent niveau, et qu’il est resté longtemps méconnu. Ainsi, seuls des excentriques ou francs-tireurs comme Gould, Katsaris ou Biret s’étaient intéressés à quelques-unes des symphonies lorsque Jacques Drillon conçut le projet d’en confier l’intégrale à cinq pianistes français alors âgés de 30 à 45 ans, renforcés par un grand aîné autrichien de près de 60 ans: Georges Pludermacher pour la Troisième «Héroïque» (septembre 1985), Jean-Louis Haguenauer pour les deux premières (novembre 1985), Michel Dalberto pour la Sixième «Pastorale» (février 1986), Alain Planès pour les Quatrième et Huitième (mars et juin 1986), Paul Badura-Skoda pour la Cinquième (décembre 1986), Jean-Claude Pennetier pour la Septième (mai 1987), Planès et Pludermacher concluant à deux pianos avec la Neuvième (juin 1987). Il faut se replacer dans le contexte de l’époque pour mesurer le caractère pionnier de cette entreprise, avant même que Konstantin Scherbakov (Naxos), Leslie Howard (Hyperion) et encore moins Yury Martynov sur instruments d’époque (Zig-Zag Territoires) n’aient gravé chacun leur intégrale. Mais pas loin de trente-cinq ans plus tard, la réédition de ces enregistrements ne déçoit pas. Certes, la lenteur du tempo pose parfois problème – plus de 38 minutes pour la Deuxième, 47 minutes pour la Septième – mais on peut aussi y voir une invitation à prendre le temps de découvrir tout ce que la transcription révèle du texte. En outre, Badura-Skoda est à la peine, mais se rachète magnifiquement dans la Sonate D. 958 de Schubert enregistrée en public à Gaveau en octobre 1978 (dont on ne voit pas trop ce qu’elle vient faire là sinon que comme la Cinquième, elle est également en ut mineur). En revanche, les Troisième, Quatrième, Sixième, Huitième et Neuvième constituent de superbes réussites, qui plus est dans des prises de son voluptueuses (coffret de six disques Harmonia mundi HMX 2931192.98).
Pierre Henry (1927-2017) se souvenait avoir «travaillé la réduction pour piano des Symphonies par Liszt. Quand on exécute ça, on a l’impression d’entendre Beethoven improviser. Dans cette réduction, j’ai trouvé tout de suite les points de repère pour la Dixième.» Pas les esquisses d’une improbable Dixième dont des tentatives de reconstitution ont été proposées, mais La Dixième Symphonie – Hommage à Beethoven, un atelier de collage électroacoustique étonnant mais aussi un tantinet mégalomane, dont il a donné plusieurs versions successives (1979, 1988 et 1998). Fallait-il présumer «le désir fantasmé de Pierre Henry d’une exécution instrumentale de son œuvre» (Maxime Barthélemy) et même tenter de le réaliser? En tout cas, le travail de reconstitution, dont la création a été donnée en novembre 2019 à la Cité de la musique, est impressionnant. Dans une sorte d’expérience à la Stockhausen – mais la comparaison s’arrête là – il ne nécessite pas moins de trois ensembles orchestraux, dirigés par Pascal Rophé, Bruno Mantovani et Marzena Diakun (avec l’Orchestre philharmonique de Radio France et l’Orchestre du Conservatoire de Paris) mais aussi le ténor Benoît Rameau, le Chœur de Radio France et le jeune chœur de paris. En huit mouvements portant de simples indications de tempo, sauf les deux derniers («Comme une fantaisie» et «Finale», avec ténor et chœur, bien sûr), l’œuvre dure une heure et quart et se veut un «parcours onirique, logique et respectueux de ce que ces symphonies comportent et suggèrent» (Henry). Entre taquinerie et admiration, motifs ou cellules plus ou moins courts sont exploités d’une infinité de manières: répétitions en boucle, parfois de manière obsessionnelle, échos, superpositions, coq-à-l’âne, très habiles superpositions tonales et rythmiques, polytonalité, le tout faisant entendre ici ou là Sibelius ou Ives. Si elle fait souvent sourire, cette Dixième n’en place pas moins l’auditeur en position inconfortable, celle d’un jeu où il ne peut s’empêcher d’essayer d’identifier des passages parfois extrêmement brefs, mais aussi celle où il poursuit spontanément les citations alors qu’Henry l’emmène ailleurs, soit vers la répétition de ce passage soit au contraire une autre symphonie. Dommage que le Finale déçoive par son abus des longues citations in extenso (des Troisième, Septième et Neuvième). A noter que le disque inclut une «version 3D sonore au casque à télécharger» (Alpha 630). SC
Symphonies de Schubert: l’ancien et les modernes

 
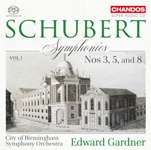 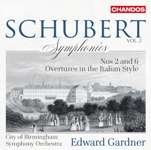
 
 
Marquées par une nette césure entre les six premières (1813-1818), œuvres de «jeunesse» dont certaines peinent à trouver leur place au répertoire, et les deux dernières (1822 et 1826), qui font en revanche partie des incontournables du genre, les symphonies de Schubert n’en bénéficient pas moins d’un vif regain d’intérêt au disque depuis une dizaine d’années, au point que parmi les parutions récentes, bon nombre s’inscrivent dans le cadre d’une intégrale.
Par ordre chronologique, il faut d’abord évoquer la réédition d’une intégrale originellement publiée chez Eterna (puis Berlin Classics), celle gravée entre février 1978 et mai 1981 par Herbert Blomstedt avec la Staatskapelle de Dresde, dont il était alors le Chefdirigent. La prise de son est saturée et réverbérée, la modération du tempo surprend par endroits (introductions, menuets), mais les mouvements rapides laissent placent à la vivacité, à la jeunesse et à la fraîcheur, les mouvements lents et la partie centrale des menuets et scherzos au lyrisme et à la suavité. Une variété de ton bienvenue, car sans vaine ambition d’unifier ce corpus au fond assez disparate, il n’aborde pas toutes les symphonies sous le même prisme: aucune routine, de ce fait, comme dans la Huitième «Inachevée», tout à fait engagée et inspirée. Bref, en creux, tout ce qui, à un titre ou à un autre, manquera le plus souvent aux versions récentes (cf. infra). En complément, toujours à Dresde, Willy Boskowsky ne se situe pas tout à fait au même niveau en mars 1977 dans l’intégralité de la musique de scène pour Rosamonde (avec les deux ouvertures que Schubert lui destina successivement, celles d’Alfonso et Estrella et de La Harpe enchantée), mais il faut signaler la présence bienfaisante d’Ileana Cotrubas en soliste et du Chœur de la Radio de Leipzig (coffret de cinq disques Brilliant Classics 96044).
Lawrence Foster et le Philharmonique de Copenhague abordent les trois premières symphonies sans anicroche mais sans charme particulier, avec davantage de conviction dans les Deuxième et Troisième. S’y ajoutent des pages plus tardives: l’Ouverture dans le style italien en ré ainsi que les trois entractes et les deux musiques de ballet de Rosamonde (album de deux SACD Pentatone PTC 5186 655).
Chez le même éditeur René Jacobs et son B’Rock Orchestra, après les Première et Sixième, consacrent le deuxième volume de leur intégrale aux Deuxième et Troisième. Comme on pouvait s’y attendre, les reprises complètes sont observées dans les menuets, les musiciens ornementent çà ou là et les choses ne traînent pas en longueur (l’Allegretto de la Troisième est plié en moins de 3 minutes). Les initiales géantes du chef flamand sur la couverture ne trompent pas: non seulement il signe une notice (en anglais et en allemand) très riche et très développée mais une forte personnalité marque ces interprétations très dynamiques, animées par l’envie de s’amuser et de faire des surprises, jusqu’à la bizarrerie. Même la façon de faire sonner les instruments «anciens», certes rugueux et râpeux à l’occasion, étonne, car l’effet d’ensemble est parfois celui d’un grand orchestre symphonique (alors que l’effectif de cordes est limité à vingt-sept ou vingt-huit), tandis que le recours au portamento intrigue à maintes reprises. Mais tout cela semble plus anecdotique et provocateur que profond et il y a lieu de s’interroger sur le sort qui sera réservé, le moment venu, aux deux dernières symphonies (SACD Pentatone PTC 5186 759).
Au fil des deux premiers volumes d’une intégrale, Edward Gardner emmène l’Orchestre symphonique de la ville de Birmingham dans les Deuxième, Troisième, Cinquième, Sixième, Huitième et les deux Ouvertures dans le style italien. L’orchestre est agile et performant, l’interprétation ne manque pas de rebond, mais paraît un peu trop recherchée dans sa manière d’accentuer les contrastes (tempos, dynamiques), de pousser les tempi à la limite de la précipitation – difficile, cela dit, de résister par exemple au Presto vivace final de la Troisième. Dans cet ensemble d’intérêt inégal ressort une excellente Cinquième, légère et naturelle, tandis qu’à force de retenue et de sobriété, il y a une forme de démission dans l’Inachevée (SACD Chandos CHSA 5234 et CHSA 5245).
Kevin John Edusei et l’Orchestre symphonique de Munich, dont il est le Chefdirigent depuis 2014, donnent une agréable Troisième, qui permet néanmoins de mesurer les limites instrumentales de la formation bavaroise. La curiosité se porte évidemment sur la Septième, entièrement écrite mais dont Schubert n’a mené à bien qu’un tiers seulement de l’orchestration, pour l’effectif le plus fourni de toutes ses symphonies (quatre cors, trois trombones), car elle ne figure généralement au disque que dans certaines intégrales, comme celle de Marriner (voir ici), qui, comme le chef allemand, avait choisi la réalisation de Brian Newbould (1983). Il n’est pas aisé de convaincre dans cette œuvre de transition, hésitant entre le passé récent et les innovations à venir, dont l’inachèvement atteste sans doute notamment l’insatisfaction du compositeur, mais les musiciens s’y emploient au maximum, faisant notamment bien apparaître les germes des symphonies suivantes (Solo Musica SM 339).
Après les Première, Cinquième et Neuvième, l’intégrale de Heinz Holliger et de l’Orchestre de chambre de Bâle en vient, pour son troisième volume, aux Quatrième et Sixième, précédées de l’Ouverture dans le style italien en ré. La rectitude de la direction confine parfois à la raideur, avec une Quatrième manquant de tension tandis que le tempo subit d’étranges coups d’accordéon dans l’Allegro moderato final de la Sixième (Sony 19075814412).
Même si, selon une numérotation assez fâcheuse propre à engendrer la confusion, l’album de Stefan Gottfried et du Concentus Musicus de Vienne, dont il est le directeur artistique depuis 2016, annonce une version achevée de la «Septième», il s’agit d’achever l’Inachevée, donc bien la Huitième (puisque véritable Septième il y a, cf. supra). Après avoir proposé une version du finale de la Neuvième de Bruckner, Benjamin-Gunnar Cohrs et Nicola Samale ont réalisé en 2015 le Scherzo de l’Inachevée, presque entièrement esquissé et très partiellement orchestré par Schubert (voir ici). C’est ce qu’avait déjà fait Newbould, proposant lui aussi en guise de finale, pour obtenir une symphonie en quatre mouvements de plus de 40 minutes, le Premier Entracte de Rosamonde, dans la même tonalité de si mineur. Intitulé fort logiquement «(Un)Finished», ce premier album de l’ensemble viennois depuis la disparition de son fondateur, Nikolaus Harnoncourt (1929-2016), a conservé quelque chose – et même davantage – de son intransigeance, de sa vigueur, de son volontarisme et de son goût pour la prise de risque. Pour beaucoup, l’Inachevée, comme la Neuvième de Bruckner, s’achèvera à tout jamais sur le mi majeur apaisé de son mouvement lent, mais il faut reconnaître que les deux derniers mouvements, qui ne sont d’ailleurs pas sans parentés thématiques, pourraient parvenir à persuader l’auditeur du contraire. En introduction, le baryton-basse autrichien Florian Boesch chante avec application sept lieder des années 1817-1828 dans les orchestrations diaphanes de Webern ou plus en rondeur de Brahms (Aparté AP189).
Enfin, Maxim Emelyanychev, principal conductor de l’Orchestre de chambre d’Ecosse depuis 2019, s’attaque à la «grande» Neuvième, ultime symphonie, la Dixième étant demeurée à l’état d’esquisses (toutefois elles aussi réalisées et enregistrées à plusieurs reprises). Malgré sa réputation plutôt iconoclaste, le chef russe fait ici montre d’une relative prudence, évitant toute lourdeur et travaillant dans un esprit volontiers chambriste. Il insuffle l’énergie et l’élan nécessaires pour venir à bout de cette heure de musique, mais le phrasé pèche trop souvent par sa raideur, notamment dans l’Andante con moto (Linn Records CKD 619). SC
Schubert hors des sentiers battus

 
Trois parutions récentes ouvrent, chacune à sa manière, des perspectives originales sur l’univers de Schubert.
Le violiste Guido Balestracci et son ensemble l’Amoroso proposent «Une schubertiade avec arpeggione». Bonne idée, car si les violoncellistes (et les altistes) ont heureusement permis à la Sonate «Arpeggione» (1824) de s’installer solidement au répertoire, c’est l’occasion ici, en compagnie de Maude Gratton au pianoforte, d’entendre pour une fois l’instrument (également dénommé «guitare à archet», «guitare-violoncelle», «guitare d’amour», «guitare à genou» ou «guitare sentimentale») auquel elle était destinée et qui venait d’apparaître l’année précédente: un hybride, à six cordes, comme la guitare, mais tenu verticalement et joué avec un archet, comme un violoncelle (ou une viole de gambe). Au centre de cette heure de musique, l’œuvre, l’une des très rares du répertoire écrit à l’époque pour l’arpeggione, est entourée de divers arrangements et transcriptions, réalisés par Eric Bellocq (qui tient la guitare et l’archiluth), comme Vincenz Schuster, créateur de la sonate, le faisait lui-même en son temps: une version pour arpeggione, guitare tierce et archiluth de la Première Sonatine pour violon et piano; cinq lieder, soit trois chantés par la soprano Caroline Pelon et deux purement instrumentaux, sans arpeggione mais avec la guitare tierce de Massimo Moscardo; la chanson traditionnelle d’origine ukrainienne Schöne Minka (dans un arrangement inspiré, excusez du peu, par Schuster, Diabelli, Hummel et Beethoven); en clin d’œil final, la valse Le Printemps de Pauline Viardot (d’après cinq des Danses allemandes et Ecossaises de Schubert) sur des paroles immortelles de Louis Pomey («Filles, garçons, honneur de nos hameaux,/Venez danser au son de nos pipeaux»). On peine à retrouver la «beauté du son, qui dans le registre aigu ressemble à celui du hautbois et dans le grave à celui du cor de basset» qu’exagérait sans doute un peu la Wiener allgemeine musikalische Zeitung en 1823, mais l’association avec les autres instruments, à commencer par le Broadwood de 1822, fonctionne bien et Balestracci nimbe toutes ces partitions du doux lyrisme un rien fragile et sentimental qu’on associait alors à l’arpeggione (Ricercar 409).
En 1993, le compositeur et chef d’orchestre Hans Zender (1936-2019) a réalisé une «interprétation composée» du Voyage d’hiver, remplaçant le piano par un orchestre de chambre assez fourni (six cordes, neuf bois, trois cuivres, accordéon, harpe, guitare et quatre percussionnistes), d’où émergent les sonorités d’instruments inattendus (saxophone, accordéon, percussions) mais aussi de modes de jeu non conventionnels. L’essentiel de sa démarche réside toutefois dans la réécriture de la partition, commentée, déformée et complétée (préludes, interludes, postludes), sans coupures ni même véritable occultation (au contraire de la musique de Mahler dans la Sinfonia de Berio). Malgré le risque considérable inhérent à une telle entreprise, cette vision contrastée, souvent expressionniste et grinçante, du cycle schubertien n’a pas eu de mal à s’imposer. Le ténor Julian Prégardien marche sur les pas de Hans Peter Blochwitz (RCA) et, surtout, de son père, Christoph Prégardien (Kairos). Entre sidération et violence hallucinée, son registre expressif est quelque peu limité, mais bien soutenu par les musiciens de la Philharmonie allemande de la Radio (sarroise) de Sarrebruck et Kaiserslautern dirigés par Robert Reimer, il peut faire valoir une voix très sûre et une diction impeccable (Alpha 425).
Dans «Schubert in Love», Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty, qui, à ses débuts, a fait ses classes lyriques avec Sylvie Sullé, s’associe à l’Ensemble Contraste, ici en formation alto, violoncelle, contrebasse, guitare, piano et percussion auxquels se joint la trompette d’Airelle Besson, pour donner dix des lieder les plus célèbres, dont trois partagés avec Sandrine Piau, dans des arrangements très soignés de Johan Farjot entre classique, jazz et musiques du monde. Pourquoi pas, tant l’inspiration de Schubert évoque souvent la tradition populaire? Un tiers de l’album est purement instrumental – des transcriptions pour violoncelle et piano de l’Impromptu en sol bémol et pour alto et guitare du Moment musical en fa mineur, une adaptation de l’Ave Maria, de brèves improvisations sur la Sonate «Arpeggione» et la Symphonie «Inachevée» – mais la partie vocale, qui ne se laisse pas envahir par les affects, est tenue avec soin, dans les limites d’un tel exercice et même si l’allemand est moyennement idiomatique (Alpha 418). SC
Tchaïkovski shakespearien

De 1992 à 1997, Pierre-Dominique Ponnelle (né en 1957), chef d’orchestre et compositeur franco-allemand, dirige l’Orchestre philharmonique d’Etat de Minsk, d’abord en tant que chef principal invité, ensuite en tant que chef principal. Sous sa direction, l’orchestre enregistre trois disques sous l’étiquette Musicaphon, deux consacrés à Tchaïkovski et le troisième à Chostakovitch et à Mahler. Ils sont de nouveau disponibles aujourd’hui. Ce retour sur de grands classiques à la discographie fournie ne manque pas d’intérêt étant donné la ferveur engagée des musiciens et la qualité de la direction du jeune chef, dont certains traits remettent en mémoire le style de Karajan auprès de qui il avait parachevé ses études de direction à Berlin et à Salzbourg. En 1993, Ponnelle et son orchestre gravent les trois ouvertures de Tchaïkovski qui reviennent sur trois drames de Shakespeare: La Tempête (1873), Roméo et Juliette (dans la version définitive de 1880) et Hamlet (1888). Leur prestation bénéficie d’un travail tout à fait remarquable sur la richesse sonore de ces trois partitions chargées d’émotion, et sur les climats intenses qui en relèvent. Unis et enthousiastes, ils respectent pleinement la beauté, l’à-propos, la poésie, la sensualité et la violence des trois œuvres (la violence parfois un peu à l’excès), et les interventions solistes sont tout à fait appréciables. Cela reste l’un des rares enregistrements à programmer les trois ouvertures ensemble (M 56951). CL
Hummel compositeur et arrangeur

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) n’est guère plus connu aujourd’hui que pour son Concerto pour trompette ou peut-être aussi son Quintette avec piano. D’où l’excellente surprise que réserve la Troisième (1807) – chronologiquement la cinquième – de ses neuf sonates pour piano, œuvre de très bonne facture qui n’a rien à envier aux premières sonates de Schubert, presque contemporaines, et dont les trois mouvements (les deux derniers enchaînés) dissimulent en réalité une structure assez libre. Dans un fa mineur clairement romantique mais avec la liberté d’un Carl Philipp Emanuel Bach, Hummel, l’un des plus grands virtuoses de son temps, conclut avec une fugue... sur le thème du finale de la Symphonie «Jupiter» de Mozart. Sur un pianoforte de Conrad Graf (1835), Aurelia Visovan (née en 1990), qui a remporté en 2019 le premier prix du Concours Musica Antiqua de Bruges, impose avec une belle évidence la nécessité d’aller écouter les huit autres sonates, dont la dernière est postérieure à l’Opus 111 de Beethoven. Le présent album rend hommage au compositeur mais aussi à l’élève de Mozart et à l’ami de Beethoven, dont il a respectivement arrangé sept concertos pour piano et les sept premières symphonies pour flûte, violon, violoncelle et piano. Ainsi du Vingt-quatrième Concerto et de la Première Symphonie donnés ici par la pianiste roumaine avec la flûtiste française Anna Besson (née en 1988), cofondatrice du quatuor Nevermind, la violoniste italo-néerlandaise Cecilia Bernardini (née en 1984), leader du Dunedin Consort, et son époux le violoncelliste néerlandais Marcus van den Munckhof (né en 1988). Des arrangements subtils et agréables, qui évitent l’écueil de la musique de chambre – notamment dans le concerto, qui laisse la part belle au «soliste» – et qui confirment le talent d’un musicien à redécouvrir (Ricercar 417). SC
Les animaux à l’opéra

Professeur agrégé d’italien et enseignant à l’université Lyon 3, Jean-François Lattarico est bien connu depuis plusieurs années par les spécialistes de musique baroque, en tant que traducteur, notamment des ouvrages revisités par Leonardo García Alarcón (voir ici), auteur de notices de disques (voir ici et ici) ou encore critique musical pour différents médias. Son dernier ouvrage, Le Chant des bêtes. Essai sur l’animalité à l’opéra, nous régale de sa plume aussi alerte que savante, agrémentée de nombreuses références de niveau universitaire ou d’index complets en fin d’ouvrage. Fruit de recherches approfondies sur le sujet, la première partie de l’ouvrage s’attache à analyser la place de l’animal à l’opéra, en parallèle avec l’évolution des présupposés philosophiques au fil des époques. Entre allégories monstrueuses, visées poétiques ou métaphores des sentiments humains, l’animal est rare en tant que personnage à part entière, avant de trouver un rôle plus parodique et comique au XIXe siècle. Jean-François Lattarico poursuit une étude essentiellement littéraire, oubliant parfois l’analyse musicale, lacune qu’il comble ensuite lorsqu’il regroupe les opéras par type d’animaux, en plusieurs chapitres. Vient ainsi le temps d’une place détaillée aux nombreux ouvrages lyriques où figurent les animaux, à la manière d’un dictionnaire. Aussi érudit que ludique (Classiques Garnier, 392 pages, 48 euros). CN
La Fantastique en public... et à deux pianos

 
 
Quatre versions captées en concert (ou presque) de la Symphonie fantastique de Berlioz sont récemment parues, mais elles ne bénéficient pas toutes de l’engagement et de la tension propres aux enregistrements publics. Egalement publié ces derniers mois, s’ajoute le défi toujours un peu fou de la transcription d’une œuvre dont la dimension orchestrale et instrumentale est si marquée.
En janvier 2014, Gianandrea Noseda et l’Orchestre philharmonique d’Israël, dont il est le premier chef invité depuis 2011 s’investissent avec fougue, truculence et rigueur à la fois mais souffrent d’une baisse de régime dans «Un bal» et la «Scène aux champs» ainsi que d’une prise de son un peu étouffée. En complément, le chef italien confirme sa prédilection et ses affinités pour le répertoire russe dans l’Ouverture du Prince Igor de Borodine (Helicon Classics HEL029673).
Enregistrée dans la foulée de concerts donnés en septembre 2018, la version d’Andrew Davis avec l’Orchestre symphonique de Toronto, dont il est le chef honoraire après en avoir été le directeur musical de 1975 à 1988, ne convainc pas: tiède, lisse, académique et sans élan, l’interprétation se situe aux antipodes des passions berlioziennes. Le chef anglais semble croire davantage à l’étrange Fantaisie sur la Tempête de Shakespeare pour chœur, piano à quatre mains et orchestre qui complète l’album (SACD Chandos CHSA 5239).
Cette Fantaisie est la dernière partie de Lélio, ou Le Retour à la vie, «monodrame lyrique», qui forme un diptyque avec la Fantastique. En novembre 2018, Philippe Jordan et l’Orchestre symphonique de Vienne donnent successivement les deux volets. Dans la symphonie, le chef suisse emporte cette confrontation avec finesse et nervosité à la fois, laissant s’exprimer un Berlioz fiévreux, tourmenté et versatile. Malheureusement, il se laisse parfois aussi aller à ses errements narcissiques coutumiers, qui entachent un travail par ailleurs remarquablement intéressant. Aussi passionnant que faible et composite, Lélio est ici exceptionnellement valorisé: Jean-Philippe Lafont récite avec élégance et conviction, Cyrille Dubois et Florian Sempey chantent fort bien, le Chœur du Singverein de Vienne retentit dans toute sa splendeur, le tout sous la direction frémissante et inspirée de Jordan (album de deux disques Wiener Symphoniker WS 020).
Après Chostakovitch et Victorova puis Tchaïkovski et Wagner, Dmitri Liss et la Philharmonie du Sud des Pays-Bas (Limbourg et Brabant-Septentrional), dont il est le chefdirigent depuis 2016, en viennent à Berlioz. Dans ce témoignage de concerts d’avril 2019, le chef russe semble rechercher un peu à contre-courant transparence et classicisme, déployant une vision dépourvue d’excès mais hélas aussi de flamme. Enregistré dix-huit mois plus tôt, Miroir de peine (1923) est un court cycle de mélodies de Hendrik Andriessen (1892-1981) sur les mêmes textes (d’Henri Ghéon) que la partie centrale du triptyque Le Miroir de Jésus que Caplet, fervent catholique comme lui, écrivit la même année. Au-delà même du texte, l’influence française sur le compositeur néerlandais est perceptible: un tantinet archaïsante, conçue à l’origine pour voix et orgue puis orchestrée dix ans plus tard pour les seules cordes, la musique, sobre et dépouillée, n’en est pas moins émouvante, chantée par le mezzo Christianne Stotijn, dont l’articulation de la langue française n’est pas la première des qualités (Fuga Libera FUG 764).
La transcription pour piano de Liszt est bien connue mais, partant des réductions à quatre mains publiées par Charles Bannelier puis Otto Singer, Jean-François Heisser a souhaité en réaliser une pour deux pianos, dans une optique différente: mieux faire entendre des paramètres que la masse orchestrale ne valorise pas, comme l’harmonie, le contrepoint et la polyphonie. Avec Marie-Josèphe Jude, sur un superbe Pleyel «vis-à-vis» de 1928 du Musée de la musique à la Philharmonie de Paris, il privilégie effectivement ces dimensions par rapport à une vaine compétition en termes de puissance. Mais la musicalité des interprètes apporte aussi des satisfactions purement artistiques, esthétiques et sonores (Harmonia mundi HMM 902503). SC
ConcertoNet a également reçu
 Philippe Jordan: Brahms Philippe Jordan: Brahms
Au moment où il quitte l’Orchestre symphonique de Vienne, dont il était le Chefdirigent depuis 2014, le chef suisse présente une intégrale des Symphonies de Brahms réalisée en public fin septembre 2019 dans la salle dorée du Musikverein. Après une intégrale Beethoven plus intrigante qu’aboutie, il semble ici faire sien le fameux mot de Mahler, dont il sera dès la rentrée un lointain successeur à la tête de l’Opéra de Vienne: «Tradition nicht anders [ist] als Schlamperei » («la tradition n’[est] pas autre chose que de la paresse»). Indéniablement, la démarche est saine et l’interprétation, si elle ne prend pas tout à rebours, remet tout à plat. Le parti pris est celui de l’allégement (on croit parfois entendre les cordes d’un orchestre sur instruments anciens), de la musique de chambre, de la transparence et de la polyphonie, mettant fortement en valeur les voix secondaires. Il est assurément intéressant de se débarrasser de l’image d’un Brahms lourd et massif et de jouer une carte plus viennoise que hambourgeoise, mais les coups de projecteur sur certains détails et les tics d’interprétation (jeu sur les nuances dynamiques, variations très subjectives du tempo) viennent brouiller le message et la portée de cette expérimentation, qui manque en outre parfois d’engagement (quatre téléchargements Wiener Symphoniker WS 021). SC
 Quatuor Van Kuijk: Mozart Quatuor Van Kuijk: Mozart
Après deux albums consacrés à quatre des quatuors dédiés à Haydn, les jeunes Français, en compagnie de l’altiste Adrien La Marca, en viennent aux deux plus célèbres quintettes à cordes, en ut et en sol mineur: une interprétation dont les mérites résident moins dans sa personnalité, ses aspérités et sa volonté d’interroger les partitions que dans ses qualités instrumentales, son classicisme aux contours nettement dessinés et la limpidité de son discours (Alpha 425). SC
 Marc Minkowski: Mozart Marc Minkowski: Mozart
Pour son entrée chez Pentatone, le chef français a choisi la Messe en ut mineur (inachevée) dans l’édition de Helmut Eder publiée en 1987 chez Bärenreiter. L’effectif est allégé, côté Musiciens du Louvre, avec vingt et une cordes, comme côté chœur, composé des quatre solistes renforcés par un «ripieno» de neuf chanteurs. L’ensemble ne manque pas de volume pour autant, sous une baguette énergique, modérément soucieuse de grâce ou de raffinement particuliers. Le chant d’Ana Maria Labin, Ambroisine Bré, Stanislas de Barbeyrac et Norman Patzke se révèle de bon niveau mais tout cela fait quand même un album bien court – moins de 50 minutes (PTC 5186 812). SC
La rédaction de ConcertoNet
|