|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de juillet
07/15/2016
Les chroniques du mois
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Christian Thielemann dirige Strauss Christian Thielemann dirige Strauss
 Okko Kamu dirige Sibelius Okko Kamu dirige Sibelius
 Neeme Järvi dirige Atterberg Neeme Järvi dirige Atterberg
 Cinq-Mars de Gounod Cinq-Mars de Gounod
 Le Quintette en la de Schmidt Le Quintette en la de Schmidt
 Passion selon saint Matthieu de Neumeier Passion selon saint Matthieu de Neumeier
 Une nuit à Venise à Mörbisch (2015) Une nuit à Venise à Mörbisch (2015)
  Oui ! Oui !
Le Roi Priam de Tippett à l’Opéra du Kent (1985)
Federico Guglielmo interprète l’Opus 9 de Vivaldi
Gustavo Núnez interprète Vivaldi
Le Duo Rùnya interprète R. Clarke
Le pianiste B. Forsberg
Vêpres au King’s College de Cambridge
Emmanuel Krivine dirige Strauss et Zemlinsky
John Wilson dirige Copland
Matthias Bamert dirige Dohnányi
Alexander Jiménez dirige Dohnányi
«American Classics»
Raphael Wallfisch interprète Clarke
Saül et David à Copenhague (2015)
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Federico Guglielmo interprète l’Opus 8 de Vivaldi
Rachel Barton Pine interprète Vivaldi
Mathieu Lussier dirige Vivaldi
Le chef d’orchestre Douglas Bostock
Fidelio à Zurich (2004)
Pas la peine
C. Davis dirige Mozart (1984)
En bref
Saül et David de Nielsen: pour la musique
Dohnányi: le symphoniste à l’honneur
L’Amérique, d’Ives à... Delerue
Un Fidelio pour Kaufmann et Harnoncourt
Rebecca Clarke: après l’alto, le violoncelle
Copland de retour
Le Philharmonique d’Argovie à l’heure anglaise
Saül et David de Nielsen: pour la musique
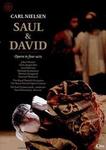
L’an dernier, le Théâtre royal danois a célébré le cent cinquantième anniversaire de la naissance de Nielsen avec une production de Saül et David (1902), premier de ses deux opéras. David Pountney actualise cet épisode biblique en le transposant dans le conflit proche-oriental. Sa mise en scène force souvent le trait, surtout dans la seconde partie – le suicide de Saül –, et ose même la parodie – une chorégraphie se moquant des assemblées de l’ONU. Soit, même si elle recourt à des moyens importants, ce n’est pas la scénographie qui nous intéresse ici, mais la musique, capiteuse, d’une grande puissance expressive, significative du langage du compositeur par sa rythmique, son harmonie et son orchestration. La direction vive et nette de l’excellent Michael Schønwandt à la tête d’un orchestre impeccable en exalte la beauté et la rutilance. L’ouvrage comporte également de splendides pages chorales, parfaitement assumées par les choristes. Valant surtout pour ses qualités collectives, la distribution souffre d’un léger déséquilibre en faveur de Johan Reuter, formidable en Saül, rôle écrasant dans lequel le baryton expose un timbre magnifique et une discipline vocale impeccable. Dans l’autre rôle-titre, Niels Jorgen Riis peine parfois dans les aigus et la voix, claire et légère, séduit modérément, mais le ténor accomplit une prestation honorable; le même constat vaut pour le Jonathan de Michael Kristensen. Ann Petersen dévoile en Michal son infaillible soprano de format wagnérien mais le personnage présente une importance moindre; Morten Staugaard crée parfaitement l’illusion de la vieillesse et de la déchéance en Samuel; saisissante Sorcière d’Endor, enfin, de Susanne Resmark qui ressemble à une gitane portée sur la boisson. Malgré ces réserves et l’absence de sous-titres en français, ce DVD permet de découvrir dans de très bonnes conditions un opéra rarement exporté au-delà des frontières danoises mais qui mérite d’être connu. Pour une critique en anglais, voir ici (Dacapo 2.110412). SF
Dohnányi: le symphoniste à l’honneur
 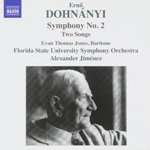
Ernö Dohnányi (1877-1960) fut, comme Kodály, un des grands organisateurs de la vie musicale de la Hongrie après la Première Guerre mondiale (à l’Académie Franz Liszt comme à la Société philharmonique de Budapest et à la Radio) et, comme Bartók, finit sa vie exil aux Etats-Unis, mais la postérité l’a nettement relégué dans l’ombre de ses deux cadets et compatriotes (qu’il n’en défendit pas moins ardemment). C’est sans doute que sa musique, qui ne s’inscrit pas dans le courant national – celle de Brahms (son premier mentor), le Hambourgeois venu dans la capitale de la double monarchie, sonne parfois bien plus «hongroise» –, ne se revendique pas comme aventureuse mais s’attache plutôt à perpétuer un généreux postromantisme. De fait, ne reste au répertoire que la Sérénade pour trio à cordes et, dans le domaine symphonique et concertant, même les Variations sur une chanson enfantine (1914) pour piano et orchestre, pourtant longtemps appréciées des musiciens et du public, ne se sont pas maintenues à l’affiche.
Oubli regrettable, comme le montre l’opportune réédition chez Chandos (dans la collection économique «Classic») d’une anthologie en cinq volumes réalisés successivement entre 1995 et 2004 par Matthias Bamert (né en 1942) à la tête du Philharmonique de la BBC. S’il ne s’agit pas d’une intégrale (il manque par exemple le Konzertstück pour violoncelle), le panorama n’en est pas moins large, à commencer bien sûr par les deux très vastes Symphonies (1901, 1945/1956), près d’une heure chacune, auxquelles s’ajoutent plusieurs partitions moins ambitieuses par leur durée: une fort intéressante Suite (1909) en quatre mouvements (et qui aurait tout aussi bien pu s’intituler «symphonie»), l’irrésistiblement pétillante Suite du Voile de Pierrette (1909), pour une pantomime d’après Schnitzler, les cinq Ruralia hungarica (1924), où la couleur magyare se fait plus présente qu’à l’accoutumée, les cinq spirituelles Minutes symphoniques (1933) et une Rhapsodie américaine (1953) d’une déroutante naïveté musicale et programmatique. Le volet concertant de ces enregistrements est également très riche: outre les Variations susmentionnées (sur Ah, vous dirai-je, maman), Howard Shelley interprète les deux Concertos (1898, 1947) de celui qui fut l’un des plus grands pianistes de son temps, James Ehnes ne donne hélas que le Second des Concertos pour violon (1950), où le soliste ressort avec éclat d’un orchestre dont sont exclus... les violons, mais le rare et délicat Concertino pour harpe (1952), avec Clifford Lantaff en soliste, a en revanche été retenu. Peu soucieux d’innover, voire d’affirmer une forte personnalité, Dohnányi donne l’impression de s’en remettre à un métier exceptionnel: au début comme au beau milieu du XXe siècle, il demeure à l’unisson post-brahmsien d’un Dvorák, d’un Elgar ou d’un Reger, sans toutefois se fermer à des influences lisztiennes, et straussiennes, voire brucknériennes ou mahlériennes. A l’image de Brahms ou de Reger, mais avec un systématisme moins prononcé que chez ce dernier, il manifeste d’ailleurs une prédilection pour des séries de variations soigneusement ouvragées (outre les Variations sur une chanson enfantine, le finale des deux Symphonies, le premier mouvement de la Suite et la quatrième des Minutes symphoniques adoptent cette forme), si possibles suivie d’une fugue magistrale. Bamert et son orchestre, servis par les formidables prises de son de l’éditeur anglais, s’illustrent avec bonheur dans ces pages certes pas essentielles ou géniales, mais toujours sincères et parfaitement écrites, souvent captivantes et plaisantes (coffret de cinq disques CHAN 10906(5) X).
C’est à l’Université d’Etat de Floride (Tallahassee) que Dohnányi, tout juste arrivé aux Etats-Unis, fut nommé en 1949 professeur de piano et compositeur en résidence. Quelques années plus tard, il y révisa sa Seconde Symphonie, écrite en 1944-1945 à Budapest puis en Autriche, où il avait fui l’occupation soviétique, pendant qu’en Allemagne deux de ses fils (dont le père du chef d’orchestre Christoph von Dohnányi et de l’homme politique Klaus von Dohnányi) étaient exécutés pour faits de résistance au régime nazi. Hormis une brève «Burla» parodique et grinçante, évoquant Mahler ou Chostakovitch, où les trombones se livrent à de grotesques glissandi – quoique stylistiquement bien loin du Concerto pour orchestre de Bartók –, on retrouve le goût du compositeur pour la tradition allemande, culminant dans le finale à variations (et fugue) sur le choral de Bach Komm, süsser Tod, komm, sel’ge Ruh!. Cette contribution nostalgique à un genre quelque peu passé de mode n’a pas grand-chose à envier, dans le même esprit et à la même époque, à la Symphonie en fa dièse de Korngold, lui aussi exilé austro-hongrois outre-Atlantique. Il est touchant qu’un récent enregistrement de cette Seconde Symphonie ait été confié à l’Orchestre de l’université pour laquelle Dohnányi a travaillé pendant plus de dix ans: l’implication des musiciens américains, sous la baguette d’Alexander Jiménez, «directeur des activités orchestrales», paraît d’ailleurs supérieure à celle du BBC Philharmonic, mais la qualité instrumentale se révèle en revanche assez nettement inférieure. Le programme est complété par la première au disque d’une œuvre inédite à ce jour, les deux lieder de l’Opus 22 (1912), «Dieu» et «Nostalgie du soleil» (seuls menés à bien dans ce cycle qui devait originellement être plus développé), sur des poèmes (en allemand) de Wilhelm Conrad Gomoll (1877-1951). Le baryton Evan Thomas Jones, par ailleurs ancien élève et désormais professeur assistant auprès de cette université, chante avec beaucoup de cœur ces pages plus germaniques que nature, dans la lignée de Wolf plus que de Strauss ou Mahler (Naxos 8.573008). SC
L’Amérique, d’Ives à... Delerue

On se méfie toujours un peu des compilations au titre quelque peu racoleur, tel ce disque «American Classics» qui regroupe des œuvres de Barber, Bernstein, Copland, Ives et... Georges Delerue (1925-1992). Les puristes pourront évidemment s’offusquer de la présence du compositeur français, bien connu pour ces nombreuses musiques de film, mais force est de constater que sa Nuit américaine (tirée du film éponyme de Truffaut en 1973) ouvre admirablement cette compilation consacrée au XXe siècle. Si les enregistrements proposés apparaissent très disparates, que ce soit au niveau des interprètes ou des dates de réalisation (1992 à 2015), le tout tient la route et offre un très beau panorama introductif à la musique américaine du siècle dernier. Malgré des cordes parfois un peu faibles, les connaisseurs y trouveront aussi leur compte avec une version étonnante pour trompette, clarinette, saxophone et piano de Quiet City (1940) de Copland, tandis que ce disque au minutage très généreux se conclut dans la modernité toujours aussi marquante d’Ives et son mystérieux The Unanswered Question (Indésens INDE078). FC
Un Fidelio pour Kaufmann et Harnoncourt

Ce Fidelio zurichois procure la même impression que ressortir une ancienne photo de classe: douze ans plus tard, Nikolaus Harnoncourt n’est plus de ce monde et Jonas Kaufmann compte parmi les chanteurs les plus réclamés. Sans doute est-ce pour eux qu’Arthaus Musik réédite cette captation, même si le ténor n’apparaît qu’après une heure et quart. La prestation du chanteur ravira ses fans et convaincra l’amateur d’art lyrique de sa supériorité, malgré les mérites de ses partenaires, en particulier de Camilla Nylund, fine et volontaire en Léonore, et de László Pólgár, d’une grande noblesse en Rocco. Acérée, précise et nuancée, la direction d’Harnoncourt, à la tête d’un orchestre aux timbres savoureux, épouse étroitement l’épopée et les sentiments des protagonistes. En revanche, la mise en scène malaisée à cerner d’un Jürgen Flimm peu inspiré par son sujet ne présente pas beaucoup d’intérêt: dans un décor simple et le plus souvent sombre, elle manque de consistance et tire la représentation en longueur, en dépit de la beauté de certaines scènes (DVD 109223 ou Blu-ray 109224). SF
Rebecca Clarke: après l’alto, le violoncelle

La musique de chambre de Rebecca Clarke (1886-1979) connaît un net regain d’intérêt et en particulier sa remarquable Sonate pour alto et piano pour laquelle, comme la plupart de ses pièces pour alto, son instrument, elle créa une version pour violoncelle, sans doute à l’intention de sa consœur May Muklé. Avec un professionnalisme de bon aloi, Raphael Wallfisch (né en 1953) et John York (né en 1949) consacrent le dernier d’une longue série d’enregistrements ensemble à la musique pour violoncelle et piano de Clarke dans son intégralité, y compris les partitions à l’origine pour alto qui embellissent le récent récital du Duo Rùnya. Tout en appréciant la richesse nuancée des timbres du violoncelle, on peut préférer la belle voix plus exaltée que les mêmes pièces imposent à l’alto, que ce soit pour la Sonate (1919), notamment sous l’archet d’Adrien La Marca, Passacaglia (1941) ou I’ll bid my heart be still, la pénultième composition de Clarke avant le silence qu’elle s’imposa à la suite de son mariage en 1944. Cantilène dans une même veine douloureuse, Epilogue (1921), directement écrit pour violoncelle et piano en contrepoint, explore les possibilités d’un motif de trois notes annoncé d’entrée. Le lyrisme passionné du violoncelle et l’impressionnisme mystique et animé du piano s’élèvent en équilibre parfait pour les quatre mouvements de Rhapsody, créée par May Muklé et Myra Hess en 1923. La compositrice ose de légers frottements harmoniques au cœur de strates polymodales aux textures luxuriantes. Le caractère rhapsodique vient de l’intensité de style et d’affect d’une pièce plutôt dramatique et douloureuse, sous-tendue en permanence d’un sentiment de point de rupture imminent. La surprise du programme vient de Dialogue with Rebecca Clarke (2007), d’abord pour alto et piano: John York établit un dialogue non dénué d’intérêt entre le violoncelle et le piano et entre ses propres thèmes et ceux de la Sonate qui le passionne (Lyrita SRCD.354). CL
Copland de retour

Peu de temps après la sortie du très beau disque consacré à Aaron Copland (1900-1990) par Andrew Litton chez Bis, voilà que Chandos lui emboîte le pas avec John Wilson (né en 1972) à la baguette. C’est là encore le Copland maître de l’orchestre et tout particulièrement du ballet – Billy the Kid, Rodéo, Appalachian Spring – qui nous régale de son ivresse des timbres et de l’éclat mélodique – ici admirablement ciselé par le geste félin de Wilson, connu pour avoir créé voilà plus de vingt ans un orchestre auquel il a donné son nom et qu’il consacre à la gloire de la musique de film. Cet amateur de jazz comme de musique légère, régulièrement invité aux BBC Proms de Londres, s’intéresse tout autant à un répertoire plus sérieux, telle son intégrale en cours consacrée à Vaughan Williams, lors de concerts londoniens avec l’Orchestre Philharmonia. C’est ici son tout premier enregistrement pour l’éditeur britannique alors que sa discographie, principalement dédiée à ses compatriotes , est déjà considérable – quarante enregistrements. Ce disque au minutage très généreux se montre encore une fois spectaculaire avec l’excellence des prises de son Chandos, aidé par le geste clair et rythmique de Wilson, évitant toute extraversion exotique dans El Salón México (1936), sans tomber pour autant dans la froideur. Aux passages sautillants et pleins d’allant succède le contraste d’une respiration bien assise dans les parties cuivrées, parfois un rien extérieure. Un beau disque qui complète bien celui de Litton, davantage intéressé par le brio orchestral (SACD CHSA 5164). FC
Le Philharmonique d’Argovie à l’heure anglaise

A la suite de sa «British Symphonic Collection», souvent à la tête de l’Orchestre symphonique de Munich, Douglas Bostock (né en 1955) propose un nouveau programme de musique de son pays natal avec le concours du Philharmonique d’Argovie, dont il est le chef principal depuis 2001. La programmation, assez inattendue, présente trois œuvres de compositeurs anglais parmi les plus renommés de leur temps. Froissart (1890) d’Elgar évoque les écrits de Jehan Froissart dans un élan épique richement orchestré. Une grave sonnerie de cors ouvre les climats ambigus de l’intrigante Cinquième Symphonie (1943) de Vaughan Williams, écrite en temps de guerre comme dans une folle espérance d’Arcadie. Pour la Suite japonaise (1915), ballet en six volets écrit pour le danseur Michio Ito, Holst, tire son matériau pentatonique d’authentiques airs japonais qu’Ito lui avait appris. C’est un élégant exercice de style orientalisant, finement rythmé et coloré à la verticalité des strates et au charme certain. D’un des derniers élèves d’Adrian Boult on pouvait espérer une prestation plus engagée sinon pénétrée d’un feu ardent mais, si les partitions sont respectées avec beaucoup d’exactitude, élan et engagement manquent à une interprétation peut-être un peu extérieure. Bostock reste fidèle à une vision stéréotypée de la musique d’Elgar – pompe et circonstance héroïques – qui déteint à l’occasion sur la manière d’interpréter la symphonie de Vaughan Williams, trahissant les quelques insuffisances de la phalange suisse. La Suite japonaise, peu souvent à l’affiche, garde le mérite d’une relative «nouveauté» et, malgré une direction encore un peu lourde, les musiciens semblent plus en phase... bien que l’on puisse encore préférer la vision tant vivifiante que poétique de Boult. L’enregistrement tire une partie de sa valeur de l’intérêt de ce programme insolite (SACD hybride Coviello Classics COV 91515). CL
La rédaction de ConcertoNet
|