|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de mars
03/15/2016
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Howard Shelley interprète Mendelssohn Howard Shelley interprète Mendelssohn
 Une biographie de Habeneck Une biographie de Habeneck
 Lisa Batiashvili interprète Bach Lisa Batiashvili interprète Bach
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
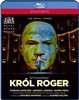 Le Roi Roger à Londres (2015) Le Roi Roger à Londres (2015)
 Klaus-Martin Bresgott dirige Distler Klaus-Martin Bresgott dirige Distler
 L’Ensemble Abchordis L’Ensemble Abchordis
 Œuvres de Marie Jaëll Œuvres de Marie Jaëll
  Oui ! Oui !
L’ensemble Les Cuivres Français
Denis Matsuev et Valery Gergiev
Michael Tilson Thomas dirige Stravinski
Linus Roth interprète Gernsheim
Fabio Biondi et Europa Galante
L’Ensemble 415 interprète Valentini
L’Ensemble 415 interprète Vivaldi
L’ensemble Gli Incogniti interprète Vivaldi
La saxophoniste Amy Dickson
Camilla Hoitenga interprète Saariaho
Le Freischütz à Dresde (2015)
Sergio Azzolini interprète Vivaldi
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Lise de la Salle interprète Rachmaninov
L’ensemble Le Concert étranger
Tasmin Little interprète trois concertos anglais
Le Quatuor Giardini interprète Fauré et Bonis
La Fille mal gardée à Londres (2015)
L’Oratorio de Noël de Neumeier à Hambourg (2014)
Andrew Davis dirige Bliss
Krzysztof Penderecki dirige ses Symphonies
Pas la peine
Sequeira Costa interprète Rachmaninov
Mariss Jansons dirige La Dame de pique
Zvi Emanuel-Marial chante Schubert
Stanislaw Kierner chante Schubert
Peter Schreier chante Schubert
Hélas !
Musique française autour du Chœur Luce del Canto
En bref
Azzolini: basson plein dans Vivaldi
Un Freischütz recommandable
Saariaho: un récital de la flûtiste Camilla Hoitenga
Un héros trop parfait pour Arthur Bliss
Penderecki par Penderecki: du grand symphonique
Soldes d’hiver: chanteurs à la peine dans Winterreise
Le morne théâtre de La Dame de pique de Jansons
Azzolini: basson plein dans Vivaldi

Vivaldi a composé trente-neuf concertos pour basson qui nous sont aujourd’hui parvenus: autant dire que, chez les compositeurs baroques, c’est certainement un de ceux qui a, de la manière la plus flagrante, donné ses lettres de noblesse au vénérable instrument. Dans le cadre de l’intégrale Vivaldi en cours chez Naïve, on avait déjà souligné l’extraordinaire adresse et maîtrise de Sergio Azzolini (né en 1967), qui signe donc là son quatrième volume avec toujours la même maestria. Témoignant d’une technique irréprochable (quels détachés dans les troisièmes mouvements des Concertos RV 469 et RV 491!), Azzolini ne met pourtant jamais en avant les aspects techniques de la partition, préférant insister sur la mélodie. Et comment résister au mélodieux Largo du Concerto RV 469 ou à la douce rêverie qui, après l’intervention liminaire de l’orgue, innerve le Largo du Concerto RV 491? Comment ne pas véritablement succomber à ce merveilleux Largo du Concerto RV 473, peut-être un des plus beaux moments de ce disque? Car, et c’est de nouveau un mérite d’Azzolini (épaulé cette fois-ci par L’Onda Armonica et non, comme pour ses trois précédents disques, par L’Aura Soave Cremona), le soliste se laisse porté par le naturel de la partition, laissant faire le jeu de la pulsation et des nuances (l’Allegro introductif du Concerto RV 498 ou la fin de l’Allegro du Concerto RV 492 qui se termine dans un indicible silence). Une nouvelle réussite, et de Sergio Azzolini et de l’Edition Vivaldi, qui nous fait toujours attendre les nouveaux volumes avec la même gourmandise (OP 30551). SGa
Un Freischütz recommandable

Alex Köhler inscrit l’action du Freischütz dans une ville bombardée, peut-être Dresde, où se tient la représentation: concept cohérent et fidèle à l’esprit de l’œuvre, direction d’acteur limpide et crédible mais décor trop sombre, un parti pris du reste assumé. C’est la fosse qui procure le plus de plaisir: Christian Thielemann dirige une Staatskapelle somptueuse et d’une constante justesse expressive – la perfection. Vocalement, c’est aussi de haut niveau. Parmi les hommes, outre l’Ermite remarquable d’Andres Bauer, il faut retenir le splendide Kaspar de Georg Zeppenfeld qui se démarque par la beauté du timbre, la perfection du chant et la pertinence de la caractérisation. Michael König incarne un beau Max, profond et sensible, en dépit d’une projection restreinte et d’une émission parfois resserrée. Les femmes se hissent à la hauteur, bien que Sara Jakubiak, Agathe toute de simplicité, ne dévoile pas l’instrument le plus séduisant: la soprano chante avec discipline mais la ligne accuse un manque de souplesse et de raffinement. L’Annchen fraiche et naturelle de Christina Landshamer nous séduit davantage grâce à sa voix, légère et savoureuse, et à son minois irrésistible. Les choristes se montrent impeccables dans les splendides pages que Weber leur a réservées (C major DVD 733108 ou Blu-ray 733204). SF
Saariaho: un récital de la flûtiste Camilla Hoitenga

Camilla Hoitenga (née en 1954) a souvent exploré les possibilités techniques et sonores de son instrument en collaboration avec Kaija Saariaho (née en 1952) et son récital de musique de chambre de la compositrice finlandaise, intitulé «Let the wind speak», met en valeur de manière créative les différents types de flûtes, seule, ou avec harpe ou violoncelle, ou avec voix au cœur d’un ensemble. Dolce tormento (2004) fait appel à la flûte piccolo, Laconisme de l’aile (1982) à la flûte classique, le magnifique Couleurs du vent (1998) à la flûte alto et Oi Kuu (1993), d’abord composé pour clarinette (1990), à la flûte basse. La flûte s’associe à la harpe d’Héloïse Dautry pour le sinueux Tocar (2010), à l’origine pour violon et piano, et au violoncelle pour Oi Kuu et pour le fascinant Miroirs(1997), œuvre ouverte à construire à partir de quarante-huit fragments prédéfinis. Camilla Hoitenga et Anssi Karttunen interprètent en premier la construction proposée par la compositrice mais agencent au cours du programme deux variantes possibles, jeu de miroirs et de faux reflets plutôt captivant. Saariaho puise souvent son inspiration dans la poésie, intégrant à l’occasion des phonèmes au souffle ou des citations à la partition: une «canzoniere» de Pétrarque à Dolce tormento, un extrait des Oiseaux de Saint-John Perse à Laconisme de l’aile. C’est un poème d’Ezra Pound qui inspira Sombre, destiné à la Chapelle Rothko. Entre ombre et lumière, le baryton Daniel Belcher et la flûte basse de Hoitenga prennent appui sur la harpe, la percussion et la contrebasse de l’ensemble Da Camera de Houston. Les principaux interprètes sont des familiers de l’écriture exploratrice de Saariaho qui allie le naturel du flux à une esthétique tout autant du son que de la note et leur prestation rend pleinement justice à l’audace harmonique et l’expressivité poétique de ces pièces formellement si finement construites (Ondine ODE 1276-2). CL
Un héros trop parfait pour Arthur Bliss

C’est peu dire que l’on connaît mal la musique anglaise du début du XXe siècle, peu jouée en dehors du Royaume-Uni. Hormis Holst et ses inévitables Planètes, combien de compositeurs oubliés à l’instar de ceux réunis dans deux disques récents édités par CPO (voir ici) et Naxos (voir ici)? Le programme passionnant du disque Naxos s’intéressait ainsi opportunément aux réminiscences de la Première Guerre mondiale, tout comme ce tout nouveau disque consacré à Morning Heroes, l’un des chefs-d’œuvre d’Arthur Bliss (1891-1975). Resté dans l’ombre de ses cadets Walton et Britten tout au long de sa prolifique carrière, l’ancien élève de Charles Villiers Stanford rendit ainsi hommage à son jeune frère, disparu lors de ce conflit meurtrier, en une sorte de requiem bercé de l’influence néoclassique de Ravel ou Stravinski. Cette œuvre composée en 1930 fait également penser à Honegger par la force éloquente issue de la présence mêlée du chœur et du récitant – sans posséder néanmoins le génie mélodique propre à ses illustres contemporains. On regrette aussi le geste trop sage d’Andrew Davis, incapable d’apporter davantage de contrastes à ces vagues superbes qui traversent chœur et orchestre en de maints endroits, préférant s’attacher à une vision apollinienne, probe mais sans émotion. C’est d’autant plus regrettable qu’on ne peut que saluer, une fois encore, la qualité de la prise de son, tout comme celle du Chœur et de l’Orchestre symphonique de la BBC – même si l’on est plus réservé en revanche concernant Samuel West, récitant peu à l’aise. En complément, L’Hymne à Apollon (1926) laisse entrevoir davantage de modernité dans le fin entrecroisement entre les mélodies et les ruptures de ton inattendues. Il est à noter qu’il s’agit du premier enregistrement mondial de la version originale de ce court poème symphonique commandé par rien moins que Pierre Monteux et l’Orchestre symphonique de Boston en 1926, avant une révision tardive de l’œuvre en 1965 (Chandos CHSA 5159). FC
Penderecki par Penderecki: du grand symphonique

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est cet adage que Krzysztof Penderecki (né en 1933) met en pratique avec ce coffret de l’intégrale de ses Symphonies, sorti chez Dux voilà trois ans, peu de temps après que son compatriote polonais Antoni Wit lui a soufflé la politesse chez Naxos. Ce coffret s’avère globalement de bon niveau pour ce qui est des œuvres purement orchestrales, et ce malgré la présence du méconnu et correct Orchestre polonais Sinfonia Iuventus (fondé en 2007 à Varsovie). On ne peut malheureusement pas en dire autant des deux dernières symphonies, composées pour solistes et chœur, dont les sopranos souffrent d’insuffisances techniques difficilement acceptables. On se concentrera donc sur les autres œuvres, particulièrement la toute Première Symphonie (1973), où le Polonais fait encore preuve de son statut d’avant-gardiste en des recherches de sonorités dérangeantes et insolites, empruntant à Varèse par endroits, se rapprochant de Schnittke en d’autres. Penderecki savait alors certainement que le choix même de composer une œuvre appelée «symphonie» était déjà une trahison pour l’ensemble de ses compagnons de l’avant-garde atonale. La Deuxième «Noël», composée en 1980, s’éloigne plus encore de toute référence «bruitiste» pour lorgner du côté de Mahler et des grands symphonistes de la première moitié du XXe siècle – un virage désormais sans retour, certes efficace et accessible au plus grand nombre, mais bien peu original. C’est davantage vers Chostakovitch que penche la belle Troisième Symphonie (1988-1995), à la rythmique nerveuse et aux scansions de cuivres marquantes dans l’Allegro initial, avant que l’Adagio ne raréfie le tissu orchestral pour évoquer de grandes étendues désolées et arides. Changement d’atmosphère avec la «Passacaille» du troisième mouvement, qui fait davantage penser à John Williams. Le film Shutter Island, avec Leonardo DiCaprio, ne s’y trompera en réutilisant ce mouvement réussi dans sa bande originale en 2010. A la méditative et apaisée Quatrième «Adagio» (1989) s’oppose une plus sombre Cinquième «Coréenne» (1991-1992) où plane encore l’influence de Chostakovitch. On ne trouve pas trace de Sixième Symphonie composée à ce jour, Penderecki ayant préféré donner à sa symphonie-oratorio «Les Sept Portes de Jérusalem» le chiffre symbolique de Septième (1997). Cette commande pour célébrer les 3000 ans de Jérusalem affiche toute sa boursoufflure dans le choix même de son orchestre pléthorique, accompagné des forces de cinq voix solistes, d’un récitant et de trois chœurs. A cette vaste fresque imposante et dramatique qui comporte aussi des moments plus intimistes et évocateurs, répond la sensible évocation de la nature de la dernière symphonie composée à ce jour, la Huitième «Lieder der Vergänglichkeit». Présentée en 2005 avec neuf mouvements, Penderecki l’a révisée en 2007 en lui ajoutant trois mouvements. C’est cette dernière version qui est ici enregistrée, contrairement à la version Wit (Naxos, 2008) qui permettait de découvrir l’œuvre initiale. Intéressante en son début par la richesse de l’écriture orchestrale qui met en avant les dialogues entre bois et percussions, cette ultime symphonie semble revenir aux recherches de sonorités du début des années 1970, tout en bénéficiant de l’inspiration des poèmes romantiques allemands sur lesquels elle s’appuie. Dommage que Penderecki ne s’essouffle peu à peu dans la seconde partie de l’œuvre, retombant dans les travers du grand symphonique façon musique de film. Une œuvre finalement à l’image des symphonies réunies dans ce coffret: intéressantes mais rarement originales, et surtout inégales (cinq disques 0947). FC
Soldes d’hiver: chanteurs à la peine dans Winterreise

 
Mauvaise pioche pour ces trois versions du Voyage d’hiver (1827) de Franz Schubert. Celle du contre-ténor israélien Zvi Emanuel-Marial (né en 1976) est investie – on ne peut nier la grande intensité mise dans l’interprétation– mais la technique assez brutale et le timbre pour le moins étranglé (notamment dans les forte) discréditent vite ce disque peu attachant. Une tendance lourde à habiter les notes dans leur longueur se révèle, du reste, vite monotone. De son côté, l’accompagnement pianistique de l’Australien Philip Mayers fait le choix heureux de la sobriété (Thorofon CTH2615). Le baryton polonais Stanislaw Kierner (né en 1980) met également de l’énergie à cheminer dans le voyage schubertien. Mais le résultat bute trop fréquemment sur une justesse approximative, une émission laborieuse et agressive et une interprétation fréquemment à bout de souffle. Là encore, un piano subtil (celui de Michal Rot) apporte du baume au cœur (Dux 1204). Enfin, le vétéran Peter Schreier (né en 1935) joue la carte de l’originalité, en présentant l’arrangement pour quatuor à cordes de Jens Josef (né en 1967) et en s’appuyant sur une formation (le Quatuor de Dresde) qui convainc de la pertinence d’une transcription exaltant le velours intimiste de la partition. Le ténor allemand n’est malheureusement plus que l’ombre du chanteur d’exception qu’il fut et ne parvient pas, dans cet enregistrement datant de mars 2005, à assumer techniquement des choix d’interprétation pourtant très justes. On passera donc rapidement sur une intonation désormais trop nasale, une difficulté évidente à stabiliser la ligne de chant et une projection souvent laborieuse. C'est l’hiver du Voyage (Profil Hänssler PH14051). GdH
Le morne théâtre de La Dame de pique de Jansons

Immense chef spécialisé dans le répertoire symphonique, comme le rappelait un tout récent coffret des concerts radiophoniques donnés ces vingt-cinq dernières années à Amsterdam (voir ici), Mariss Jansons s’est rarement aventuré sur le terrain de l’opéra, à l’exception notable de ses récents enregistrements de Lady Macbeth de Mtsensk (2006) et Eugène Onéguine (2012), tous captés en DVD par Opus Arte. Un retour à Tchaïkovski, compositeur de prédilection du chef letton, dont l’intégrale des Symphonies gravées avec l’Orchestre symphonique d’Oslo fit beaucoup, à la fin des années 1980, pour la réputation grandissante de Jansons. Il faudra cependant être un inconditionnel de l’actuel directeur musical de l’Orchestre du Concertgebouw (remplacé cette année par Daniele Gatti) pour apprécier dans La Dame de pique une battue si peu théâtrale, évacuant tout pathos et privilégiant la mise en place, la sobriété et les détails de l’orchestration. Une vision bien éloignée des grandes versions historiques (Samossoud, Melik-Pachaïev ou Khaïkine), flamboyantes et extraverties, sans parler des chanteurs d’un tout autre niveau. Non pas que le plateau vocal réuni soit indigne, loin de là. Mais comment se satisfaire du timbre fatigué d’Alexey Shishlyaev (Tomsky) ou du vibrato envahissant de Misha Didyk dans le rôle-titre? Le ténor ukrainien compense heureusement ce défaut par une incarnation vibrante, illustration de sa parfaite maîtrise d’un rôle joué à travers toutes les scènes européennes (voir par exemple, à Strasbourg l’an passé), et parfaitement épaulé par une lumineuse Tatiana Serjan, seule véritable entière satisfaction vocale du coffret. On notera également les beaux graves de la Polina d’Oksana Volkova, tandis que le Chœur et l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise offrent un écrin sonore luxueux à cette version de concert captée dans les conditions du direct (coffret de trois disques BR Klassik 900129). FC
La rédaction de ConcertoNet
|