|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de décembre
12/15/2015
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Andris Nelsons dirige Chostakovitch Andris Nelsons dirige Chostakovitch
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Mariana Flores chante Cavalli Mariana Flores chante Cavalli
 «Liaisons»: Sondheim au piano «Liaisons»: Sondheim au piano
 «Ludus Verbalis» par l’Ensemble Aedes «Ludus Verbalis» par l’Ensemble Aedes
 Le Trio Prospero interprète Honegger Le Trio Prospero interprète Honegger
 Konstantin Lifschitz interprète Bach Konstantin Lifschitz interprète Bach
  Oui ! Oui !
Hervé Niquet dirige La Toison d’or de Vogel
Ulrich Stötzel dirige Telemann
Deux symphonies de Kinsella
Sang viennois à Mörbisch (2007)
Neeme Järvi dirige Atterberg
Il signor Bruschino à Pesaro (2012)
Antony Hermus dirige Klughardt
Musique de chambre de Goetz
B. Haitink dirige Mahler (1982-1983)
Lars Vogt interprète Bach
Paul Daniel dirige Sibelius
Howard Griffiths dirige Hoffmeister
Le Consortium Classicum interprète Hoffmeister
Herculanum de F. David
Michael Schønwandt dirige Maskarade de Nielsen
Frank Strobel dirige Les Nibelungen de Huppertz
Gloriana à Londres (1984)
Rusalka à Londres (1986)
Alan Gilbert dirige Nielsen
Sakari Oramo dirige Nielsen
Hervé Niquet dirige Dukas
Olivier Chauzu interprète Dukas
Claire-Marie Le Guay interprète Haydn et Mozart
Musique du XXe siècle par Claire-Marie Le Guay
Guennadi Rojdestvenski dirige Schnittke
Les Quintettes avec piano de Gernsheim
Le Trio 1790 interprète Denninger
Federico Guglielmo interprète Vivaldi
Œuvres chorales et cantates de Dvorák
Laurence Equilbey dirige Orphée et Eurydice
Enregistrements publics de Mariss Jansons
Hommage à Rudolf Barshai
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Michael Scholl dirige Telemann
Chagall. La couleur des sons de Mikhaïl Rudy
Thomas Søndergård dirige Sibelius
La pianiste Natacha Kudritskaya
Herbert von Karajan dirige Strauss
Hartmut Haenchen dirige C. P. E. Bach
John Storgårds dirige Nielsen
«L’Oreille de Proust»
Anthologie Brigitte Engerer
Claire-Marie Le Guay interprète Liszt
Œuvres de Gouvy
Œuvres de Dubois
Les Femmes vengées de Philidor
Musique vocale sacrée de Rheinberger
Pas la peine
Davide Penitente à Salzbourg (2015)
Alexandre Tharaud interprète Bach
Karl Böhm dirige Beethoven
Riccardo Muti dirige Berlioz
Fabio Luisi dirige Berlioz
Le Trio Anditi de Cologne interprète Hänsel
Hélas !
Daniel Barenboim interprète Brahms
Douglas Bostock dirige Berlioz
En bref
Sesquicentenaires (1): Dukas
Sesquicentenaires (2): Nielsen
Félicien David de retour
Denninger, un contemporain de Haydn à l’honneur
Pennetier, guide fauréen
Schnittke: polystylistiquement vôtre
Les «Portraits» du Palazzetto Bru Zane (1): Gouvy
Les «Portraits» du Palazzetto Bru Zane (2): Dubois
Les délices comiques de Nielsen
Mariss Jansons: un quart de siècle à Amsterdam
Ryan Brown revient à Philidor
Rudolf Barshai, un musicien complet
Orphée de Gluck: encore une réussite pour Equilbey
Une Stravaganza de très bonne facture
La grande époque de l’English National Opera
Piano au féminin et en français: Engerer et Le Guay
Gernsheim dans les pas de Brahms
Les Nibelungen de G. Huppertz: du grand cinéma!
Rheinberger, l’autre favori de Louis II
Symphonies de C. P. E. Bach: en attendant mieux
Un premier violon trop étriqué pour les trios de Hänsel
Savoureux comme une madeleine
Une Impératrice sans chanteurs
Trois Fantastique pas fantastiques
Dvorák puissance huit chez Supraphon
L’entretien du mois

Natacha Kudritskaya
Les matchs du mois
  
Variations Goldberg: K. Lifschitz, A. Tharaud ou L. Vogt?
 
Deuxième Symphonie de Sibelius: P. Daniel ou T. Søndergård?
Sesquicentenaires (1): Dukas
 
Quoi de neuf pour le cent cinquantième anniversaire de la naissance de Paul Dukas? Deux disques. Pour tout autre compositeur, on s’exclamerait «Seulement deux disques!», mais s’agissant de Dukas, l’extrême concision de son catalogue confère à cette publication des Ediciones singulares un relief tout particulier. Constituant le cinquième volume de la «Collection Prix de Rome» du Palazzetto Bru Zane, après ceux consacrés à Debussy, Saint-Saëns, Charpentier (publiés chez Glossa) et Max d’Ollone (ES 1021), elle regroupe en effet, hormis les plus tardives ouverture Polyeucte (1891) et Villanelle pour cor et orchestre (1906), certaines des œuvres écrites en vue de cette compétition où Dukas, malgré quatre tentatives (1886-1889), ne parvint jamais à dépasser, comme Ravel quelques années plus tard, le second grand prix. C’était en 1888 pour sa cantate Velléda, à laquelle le jury préféra celle de Camille Erlanger: peut-être nous sera-t-il donné un jour d’entendre cette dernière mais celle de Dukas, qui, dans un langage fortement teinté de wagnérisme, allie métier et inspiration, est indéniablement réussie et remarquablement restituée par Hervé Niquet à la tête de l’Orchestre philharmonique de Bruxelles. L’année suivante, seul un «second deuxième prix» fut attribué (à Alix Fournier): illustrée ici par de meilleurs chanteurs, la cantate Sémélé, d’un intérêt pourtant encore supérieur sans davantage ménager les voix, resta donc comme la dernière tentative de Dukas. A l’image des précédents volumes de cette collection exemplaire, celui-ci est présenté sous forme d’un livre abondamment documenté. Il inclut en outre les quatre brefs chœurs (avec solistes), tout sauf insignifiants, écrits chaque année pour le concours d’essai – ceux de 1886 et 1887 devaient finalement couronner Savard et Charpentier – et une mélodie (avec orchestre) antérieure (1884), L’Ondine et le Pêcheur (ES 1021).
Peu mis en valeur au concert, l’œuvre pour piano est en revanche bien servi au disque. Il n’y en a pas moins lieu de se réjouir de la réédition de l’intégrale réalisée en 2007 chez Calliope par Olivier Chauzu (né en 1963), car elle n’a rien à envier à celles, tout à fait recommandables, enregistrées plus récemment par Hervé Billaut et Laurent Wagschal (voir ici). Chauzu, cultivant, comme Billaut, la profondeur et les teintes sombres, fait entendre tout ce que les deux plus vastes partitions – l’immense Sonate et Variations, Interlude et Finale sur un thème de Rameau – doivent à la tradition germanique (Beethoven, Schumann) et réserve la même attention aux climats et couleurs des deux pages plus brèves et plus tardives – le Prélude élégiaque et La plainte, au loin, du faune... (CAL1523). SC
Sesquicentenaires (2): Nielsen

 
Ce n’est évidemment pas en France que l’anniversaire de Carl Nielsen aura été remarqué: Paris a ainsi réussi l’exploit de ne programmer cette année aucune de ses six Symphonies – certes guère davantage à l’honneur, hélas, au cours des précédentes saisons. Heureusement, les éditeurs sont bien moins frileux, le panorama ci-dessous étant en outre enrichi par un enregistrement remarquable de son second opéra, Maskarade (voir ici).
Alan Gilbert (né en 1967) parachève ainsi chez Dacapo une remarquable intégrale des Symphonies réalisée en concert avec l’Orchestre philharmonique de New York (voir par ailleurs ici) avec un disque – à acquérir soit isolément, soit avec les Symphonies – regroupant les trois pages concertantes du compositeur. C’est Nikolaj Znaider (né en 1975) qui est le soliste du Concerto pour violon, tandis que les concertos pour instruments à vent mettent à l’honneur les solistes de la phalange new-yorkaise: le flûtiste canadien Robert Langevin, enregistré lui aussi en octobre 2012, et le nouveau clarinettiste solo, Anthony McGill (né en 1979), au cours d’un concert de janvier 2015. Le chef américain maintient fermement le cap de son Nielsen dégraissé et objectif, plus facilement en accord avec ses premiers pupitres qu’avec le violoniste danois, passablement extraverti – on se prend à rêver à ce que la rencontre avec un Kavakos ou un Zimmermann aurait pu donner (SACD 6.220556 ou coffret de quatre SACD 6.200003).
Sakari Oramo (né en 1965) et son Philharmonique royal de Stockholm mettent également le point final à leur intégrale (voir par ailleurs ici). Ce troisième volume n’apprend rien de neuf sur le remarquable travail du chef finlandais et de l’orchestre suédois, et c’est tant mieux, car le résultat est toujours aussi somptueux, brillant, spectaculaire, que ce soit dans une Deuxième «Les Quatre Tempéraments» aux sonorités wagnériennes ou dans une Sixième «Sinfonia semplice» témoignant d’un plaisir indéniable. Une vision partielle, peut-être, mais diablement séduisante, sans aucun doute, de l’œuvre de Nielsen (Bis SACD BIS-2128).
Entre 2012 et 2015, John Storgårds (né en 1963), en même temps qu’une honnête intégrale Sibelius parue l’an dernier avec le même Philharmonique de la BBC (Manchester), dont il est le principal guest conductor depuis 2012, a enregistré en studio les six Symphonies de Nielsen. Plus compact que Gilbert, plus massif que Davis, plus sombre qu’Oramo, le résultat offre des satisfactions d’ordre à la fois instrumental et interprétatif, mais il manque ce petit supplément qui rend recommandables sans réserve ces trois autres versions, si différentes soient-elles (trois disques Chandos CHAN 10859(3)). SC
Félicien David de retour

On ne soulignera jamais assez le remarquable travail éditorial mené par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, dont l’élégance des livres-disques se conjugue à la qualité des textes réunis. De ces projets familiers des habitués de l’Opéra de Versailles, c’est surtout l’homogénéité des distributions proposées qui convainc pleinement par son évidence et son à-propos – sans doute là l’un des grands atouts de ces productions. C’est le cas du dixième volume de cette collection «Opéra français», Herculanum (1859), l’unique grand opéra de Félicien David (1810-1876), présenté à Versailles l’an passé avec les mêmes interprètes que ceux réunis ici, à la différence près que Karine Deshayes – alors malade – est cette fois-ci en possession de tous ses moyens, imposant ses prises de risque en un rayonnement irrésistible de fraîcheur. Avec l’impériale Véronique Gens, toujours parfaite de diction et de conviction, ce sont précisément les femmes qui impressionnent par leur impact dramatique, tandis que les hommes se montrent à la hauteur, hormis un Nicolas Courjal peu stylé, plus à l’aise dans la déclamation que dans un chant au vibrato trop poussé. Si Hervé Niquet dirige à la serpe certains passages avec ses habituels tempi vifs, il dégraisse opportunément l’œuvre en allégeant les textures. Une initiative louable pour cet opéra un rien inégal, qui lorgne vers Verdi tout en proposant quelques finesses d’écriture dans l’orchestration, sans pencher pour autant dans l’orientalisme ou la musique descriptive à la manière de l’ode-symphonie Le Désert, enregistrée récemment de fort belle manière par Laurence Equilbey (livre et deux disques Ediciones singulares ES 1020). FC
Denninger, un contemporain de Haydn à l’honneur

S’intéressant exclusivement au vaste répertoire de la musique de chambre du XVIIIe siècle, le Trio 1790 s’est déjà illustré dans plusieurs disques consacrés aux fils Bach, ainsi qu’à Dussek ou Kozeluch, tout en achevant une intégrale des Trios de Haydn particulièrement remarquée. Place cette fois au méconnu Johann Nikolaus Denninger (1743-1813), qui occupa plusieurs postes de prestige pendant sa carrière, dont celui de responsable de la musique de la cour d’Ohringen (Bade-Wurtemberg). Les vingt ans passés à cette charge lui permettent de s’illustrer en différents domaines, particulièrement dans la musique de chambre. Il s’agit, semble-t-il, du tout premier disque consacré à Denninger, qui n’a pas encore fait l’objet d’un catalogue général de sa production. C’est ce qui explique pourquoi il n’a manifestement pas été possible de dater précisément les quatre œuvres gravées ici – les trois de l’Opus 4 et un trio en sol majeur. Pour autant, ces trios n’ont pas grand-chose à envier à leurs équivalents haydniens, partageant tous des qualités d’équilibre entre les différents instruments, même si le délicat et inspiré Cantabile de l’Opus 4 n° 2 nous fait regretter la rareté des mouvements lents (absents de deux de ces quatre trios). C’est surtout l’interprétation réjouissante de caractère et d’engagement, aux attaques sèches, qui convainc pleinement, et ce malgré une justesse limite dans l’aigu pour le premier violon d’Annette Wehnert. La nécessaire respiration n’en est pas pour autant oubliée en cette musique lumineuse et joyeuse, où la rythmique agile d’Harald Hoeren au pianoforte procure autant de plaisir que les sonorités profondes du superbe violoncelle d’Imola Gombos. Du beau travail! (cpo 777 926-2) FC
Pennetier, guide fauréen

Jean-Claude Pennetier poursuit patiemment chez Mirare son intégrale de la musique pour piano de Fauré, débutée en 2008. Enregistré en 2014, et comportant les Pièces brèves, Thème et Variations, les Quatrième, Cinquième et Sixième Barcarolles ainsi que les Sixième et Septième Nocturnes, le troisième volume révèle les qualités de clarté, de couleur et de dynamique tant admirées en nos colonnes il y a quelques années. Outre la précision du toucher, le modelé du phrasé et la sobriété de l’expression, on admire aussi la rigueur de la construction et la netteté de l’articulation. Paraissant parfois trop soucieux de bien faire, alors que la musique invite à plus de fantaisie, le pianiste s’impose en guide hautement recommandable pour s’aventurer sur ces terres fauréennes (MIR 275). SF
Schnittke: polystylistiquement vôtre

A l’heure des intégrales en tout genre, on rêverait pouvoir disposer d’un coffret consacré à Guennadi Rojdestvenski, regroupant tout particulièrement l’ensemble de ses nombreux enregistrements réalisés en studio pour Melodiya. Outre ses superbes Chostakovitch réédités en 2000, ses cycles Tchaïkovski et Sibelius (2010), puis Prokofiev (2014), ont été quasi unanimement salués comme des références. A quand le retour des symphonies de Bruckner, Glazounov ou Vaughan Williams? Autant de trésors qui dorment encore dans les archives de Melodiya qui choisit, en guise de consolation, de nous rendre la Première Symphonie d’Alfred Schnittke, l’un des plus beaux disques de Rojdestvenski. Créateur de l’œuvre en 1974, le grand chef natif de Moscou fut l’un des grands défenseurs de son génial compatriote, enregistrant notamment la totalité de ses Symphonies ou la cantate Faust (Melodiya, 2009). Il s’agit ici de la gravure réalisée en studio avec l’Orchestre symphonique de ministère de la culture de l’URSS en 1987, à ne pas confondre avec le live de 1988 publié par Chandos en 1994. On retrouve ici une œuvre majeure de la manière polystylistique qui fit beaucoup pour la renommée du compositeur, autour d’un incroyable assemblage d’éléments divers. Citant aussi bien Ives que Mahler et Beethoven, en passant par des emprunts au jazz en improvisations libres, des références au baroque, Schnittke étonne par ses contrastes inattendus, son orgie de sons et de couleurs variées, faisant souvent penser au Varèse de Déserts. Le geste cinglant et expressionniste de Rojdestvenski n’est pas pour rien dans la réussite globale de cet enregistrement, surprenant jusque dans son dernier mouvement – l’intervention de l’orgue apportant un surcroit de charge émotionnelle à cette œuvre que l’on pourrait qualifier de «post-apocalyptique». Un grand disque (MELCD1002321). FC
Les «Portraits» du Palazzetto Bru Zane (1): Gouvy

Année après année, la qualité, le sérieux, l’abondance et l’importance du travail accompli par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, fidèle à sa mission de redécouverte de pans entiers de la musique française du XIXe siècle, au sens (très) large (1780-1920), ne laissent pas d’impressionner. Au côté des collections «Prix de Rome» (voir ici) et «Opéra français» (voir ici), les «Portraits» proposent des monographies, sous la forme de livres publiés aux Ediciones singulares et incluant chacun trois disques qui permettent ainsi d’offrir un aperçu aussi varié que possible des musiciens ainsi mis à l’honneur (pour un compte rendu en anglais de ces parutions, voir par ailleurs sur notre site ici et ici).
C’est à Théodore Gouvy (1819-1898) qu’il revient d’inaugurer cette collection. On connaissait des «Beethoven français» (Onslow et Magnard), voici maintenant le «Mendelssohn français». Mais le titre du texte de présentation d’Alexandre Dratwicki est nécessairement réducteur – la musique de chambre porte d’ailleurs davantage la marque de Schubert – et, pouvant être entendu comme l’expression de mérites comparables, ne constitue pas forcément la meilleure façon de rendre service à un compositeur. Car si le Sarrois naturalisé français en 1851 possède d’attachantes qualités, nul ne songera à le placer au même rang que celui occupé par Mendelssohn. De fait, l’académique, le banal et le convenu l’emportent trop souvent sur la flamme et l’inspiration: tout n’est pas au niveau de la Sinfonietta (1885), dont le titre est bien plus modeste que le contenu (elle dure près d’une demi-heure) et qui, excellemment interprétée par l’Orchestre philharmonique royal de Liège et son directeur musical, Christian Arming, tient son rang aux côtés des premières symphonies de Saint-Saëns, sans audace mais sans relâchement non plus. La Fantaisie pastorale (1875) pour violon et orchestre paraît en revanche beaucoup plus anecdotique, malgré la passion qu’y met Tedi Papavrami. Ayant déjà à son actif une belle intégrale des Symphonies (Gouvy a eu le mérite d’illustrer abondamment le genre à une époque où il n’était guère en vogue en France), Jacques Mercier donne avec son Orchestre national de Lorraine deux «ouvertures de concert» – Jeanne d’Arc (1851) et Le Festival (1852) – et une «ouverture» Le Giaour (1878): le terme de «poème symphonique» est sans doute volontairement éludé, tant on sent une volonté délibérée de restreindre le caractère descriptif du propos, au risque ne pas captiver l’auditeur – et ce n’est pas la faute des interprètes. Emmanuelle Swiercz n’interprète que six des vingt Sérénades (1855), mais cela semble suffisant au vu de ces pages d’une fadeur idéale pour les jeunes filles de la bonne bourgeoisie. La musique de chambre n’offre pas de révélations fulgurantes: parmi les onze Quatuors (tous n’ayant pas été publiés et numérotés), le Quatrième (1873), par les archets anciens (et pas toujours parfaits) du Quatuor Cambini-Paris, et le Cinquième (1874), par l’impeccable Quatuor Parisii, témoignent d’une inspiration le plus souvent insensible à la facilité – dans un genre qui, lui non plus, n’avait pas la faveur du public français de l’époque – mais ne parviennent pas à se détacher de leurs puissants modèles (Beethoven, Schubert). Enfin, le Quatrième (1858) des cinq Trios avec piano, interprété par le Trio Arcadis, est peut-être l’œuvre dont le charme et la jeunesse font le plus penser à Mendelssohn (ES 1014). SC
Les «Portraits» du Palazzetto Bru Zane (2): Dubois

Les textes du premier volume de la collection «Portraits» du Palazzetto Bru Zane, consacré à Gouvy incluent six lettres de celui-ci à Théodore Dubois (1837-1924), auquel, précisément, s’intéresse le deuxième volume. Comme Gouvy, Dubois a ressenti sur le tard une certaine amertume face à l’incompréhension ou l’indifférence suscitées par sa musique, ainsi que l’a montré la publication récente de son Journal (voir ici). Et jusqu’à ces toutes dernières années, cet élève d’Ambroise Thomas, auquel il succéda à la tête du Conservatoire de Paris en 1896, n’était resté dans les mémoires que pour son Traité d’harmonie et pour avoir quitté ses fonctions en 1905, au moment du scandale provoqué par le cinquième (et dernier) échec de Ravel au Prix de Rome. Mais il a bénéficié depuis peu d’un certain retour en grâce, avec la publication de plusieurs enregistrements: l’opéra Aben Hamet, l’oratorio Le Paradis perdu, des œuvres concertantes, de la musique de chambre (voir ici et ici), des mélodies.
Deux de ses trois Symphonies constituent le cœur du présent volume. La Symphonie française (1908), créée à Bruxelles sous la direction d’Ysaÿe, comprend dans son finale une citation de La Marseillaise. De proportions un peu plus réduites, la Deuxième (1912) fut créée sous la direction de Pierné... et sous les quolibets d’un public (très averti) qui aurait ainsi exprimé son indignation en raison d’une parenté (involontaire) avec un motif de Massenet. Si ces œuvres s’inscrivent dans la lignée de Franck, elles paraissent autrement plus laborieuses, tant par la pauvreté des thèmes que par l’épaisseur de l’orchestration. Loin des réussites de d’Indy, Chausson, Dukas ou Magnard, elles n’échappent pas toujours, quoiqu’on dise, au pompiérisme, malgré toute la fougue que peuvent y mettre respectivement Les Siècles avec François-Xavier Roth et l’Orchestre philharmonique de Bruxelles sous la direction d’Hervé Niquet.
Un disque entier est consacré à quelques échantillons de son abondant catalogue de musique religieuse, tout à fait dans l’air (sulpicien) du temps – Gounod, auquel il succéda à l’Institut, ne les eût pas reniées – mais beaucoup plus inspirés que les symphonies: la vaste Messe pontificale (1862/1895) – accueillie avec bienveillance, dit-on, par Liszt – dans une instrumentation des frères Dratwicki (le manuscrit d’orchestre a été retrouvé depuis) et plusieurs pages chorales plus brèves – deux Ave Maria, un O salutaris, un Panis angelicus, un autre O salutaris (sur le thème du Larghetto de la Deuxième Symphonie de Beethoven) et un Ave verum –, les trois dernières avec d’excellentes interventions solistes de Marie Kalinine.
Enfin, la musique instrumentale réserve des satisfactions inégales, au-delà même de son anachronisme évident. Pâle évocation d’un romantisme à la Chopin, la Sonate pour piano (1908), quels que soient les mérites de Romain Descharmes, reste très en deçà, par exemple, de celle de Dukas, l’une des rares sonates françaises contemporaines. L’intimisme un peu suranné du Quatuor avec piano (1907) mieux venu, même si, encore une fois, on se situe plus près de Schumann que de Ravel, d’Indy ou même Fauré (ES 1018). SC
Les délices comiques de Nielsen
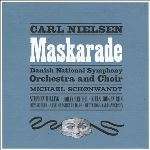
Maskarade, vous connaissez? Non, et pour cause, pourrait-on dire: le second et dernier opéra de Nielsen n’a pas encore été créé en France depuis sa première danoise en 1906. Reste donc le disque pour pallier cette négligence malheureuse, l’œuvre faisant partie des délices comiques aussi enjouées qu’exaltantes qui devraient figurer au répertoire hors du Danemark, à l’instar par exemple, du Manoir hanté de Moniuszko – un autre grand compositeur oublié en dehors de son pays natal. L’Ouverture débridée et joyeuse donne le ton d’emblée, Nielsen ayant délibérément allégé le tissu orchestral pour s’éloigner de l’influence de Wagner et retrouver l’allant mozartien, si cher au Danois en ce début de XXe siècle. Pour autant, les bois pétillants font penser à Humperdinck, tandis que la variété des climats rappelle Wolf-Ferrari et ses premiers succès comiques. Ce n’est pourtant pas Goldoni qui inspire Nielsen mais bien le grand dramaturge norvégien Ludvig Holberg, honoré par Grieg dans sa célèbre suite en 1884. Tous les quiproquos amoureux tournent autour d’un bal masqué, mascarade qui sert prétexte à une galerie de savoureuses caricatures et extraversions en tout genre, admirablement rendues par les interprètes de ces deux SACD. Il faut dire que la direction aussi stylée que théâtrale et colorée de Michael Schønwandt est un régal de chaque instant. Initiateur de cet enregistrement, le chef danois nous fait ainsi profiter de son geste généreux, fruit d’une admiration de longue date pour cette partition. A ses côtés, le Chœur national de la Radio danoise se montre impeccable, tous comme les chanteurs masculins qui privilégient eux aussi le jeu, se révélant de bons techniciens sans pour autant disposer de timbres particulièrement marquants. On citera par ailleurs la Magdelone d’Anne Margrethe Dahl, au léger vibrato mais d’une belle rondeur de timbre, complétant ce plateau vocal homogène. Un bel enregistrement (dont on pourra lire par ailleurs sur notre site ici le compte rendu en anglais) pour découvrir l’univers lyrique de Nielsen (coffret Dacapo 6220641-42). FC
Mariss Jansons: un quart de siècle à Amsterdam

Alors que Mariss Jansons (né en 1943), contraint de ménager sa santé, vient de quitter les fonctions de directeur musical qu’il exerçait depuis 2004 – parallèlement à un mandat identique auprès du Symphonique de la Radio bavaroise qu’il compte assumer jusqu’en 2021 – à l’Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, celui-ci lui rend un magnifique hommage, comme il l’avait précédemment fait avec quatre de ses prédécesseurs (Mengelberg, van Beinum, Haitink, Chailly), au travers de la parution d’une anthologie (en édition limitée) intitulée «Mariss Jansons Live, The Radio Recordings 1990-2014». Ce quart de siècle d’enregistrements publics – la première moitié de cette période étant toutefois significativement moins documentée que la seconde – illustre une relation à peine plus ancienne, le premier concert conjoint ne remontant qu’à 1988, année où la dénomination «royal» fut accolée au nom de l’orchestre. Le texte de présentation (en anglais et en néerlandais), s’il est par ailleurs très mal traduit en français, n’en montre pas moins de façon pertinente que durant toutes ces années, le chef letton a dirigé un répertoire très large qui, à la fois, a quasiment éludé la période classique, n’a pas insisté pas sur les points forts historiques de l’orchestre – Mahler, Bruckner – et s’est appliqué à résister à la tentation de conférer une place prépondérante aux compositeurs russes qui lui sont familiers, de Tchaïkovski à Chostakovitch.
C’est ce que confirment ces dix-sept heures et demie de captations effectuées par différentes radios à Amsterdam, bien sûr, mais aussi à Londres et à Berlin, tout au long desquelles la splendeur et le raffinement de l’orchestre néerlandais éclatent à chaque instant. De Beethoven à la musique de notre temps, les qualités du style de Jansons ressortent avec autant de constance que de netteté: transparence, clarté, allégement des textures, luxe dans le détail du texte – sans qu’il soit pour autant excessivement surligné –, sveltesse, refus du pathos. Si l’accord est sans doute aisé sur ce constat, on pourra néanmoins estimer que caractéristiques conviennent plus ou moins aux compositeurs et aux œuvres. Il s’impose ainsi sans réserve dans ces grosses machines que sa battue athlétique et élancée épargne de toute lourdeur: Till Eulenspiegel de Strauss (2008), Amériques de Varèse (2011), les Métamorphoses symphoniques de Hindemith (2007) et le Concerto pour orchestre de Lutoslawski (2005) sont ainsi totalement époustouflants. Se situent également à un très haut niveau, pour leur énergie et leur dynamisme, la Première Symphonie «Le Printemps» de Schumann (2008), vivante et vibrante, la Première Symphonie de Sibelius (2009), incandescente, la Deuxième Symphonie de Rachmaninov (2010), au postromantisme ravageur, de même que le charme exquis de l’idyllique Im Sommerwind de Webern (2008). Jansons sait aussi faire souffler l’esprit, tant sur une magnifique Symphonie de psaumes de Stravinski (2012), avec le Chœur de la Radio de Berlin, que sur un étincelant et rayonnant Hymne de Messiaen (2008), sur un Concerto pour orgue de Poulenc (2008) d’une formidable tension et sur Un survivant de Varsovie de Schönberg (2012) au sens dramatique affirmé. Sa précision et son enthousiasme font mouche dans ces partitions récentes où l’on ne l’attendait peut-être pas aussi à son avantage, comme les courtes et festives Dédicaces (2010) de Berio, l’explosif Festin pendant la peste de Goubaïdoulina (2011), le surprenant Moloch de Wagemans (2007) et les déroutants Mystères de L. Andriessen (2013).
L’excellence confine ici ou là à la routine – Ouverture d’Egmont et Cinquième Symphonie de Beethoven (2006/2008), Prélude et Mort d’Isolde de Wagner (2011), Mort et transfiguration de Strauss (2013), La Valse de Ravel (2007) – mais quelle routine! Jansons peut cependant décevoir quelque peu, parce que son apollinisme solaire peut tendre aussi bien vers l’hédonisme – un Tarass Bulba de Janácek (2010) trop lisse – ou même le maniérisme – une Symphonie fantastique de Berlioz (1990) qui en fait parfois des tonnes, une Troisième Symphonie de Bruckner (2008) appuyée et massive – que vers une pâleur excessive à force d’élégance et de sobriété – une Ouverture de La Pie voleuse de Rossini (2014) assez ordinaire, une Première Symphonie de Brahms (2005) guère moins appliquée qu’à Munich deux ans plus tard, une Sixième Symphonie «Pathétique» de Tchaïkovski (2004) incisive mais trop distante, une Quatrième Symphonie de Mahler (2014, en DVD bonus) alanguie et décevante, une Septième Symphonie de Mahler (2000) fine mais lente et comme démotivée, une Musique pour cordes, percussion et célesta et un Concerto pour orchestre de Bartók (2010/2003) insuffisamment affûtés, une Cinquième Symphonie de Prokofiev (2014) pas assez électrisante.
Enfin, l’accompagnateur n’apparaît que dans trois œuvres: des Chants et danses de la mort de Moussorgski (2010) idiomatiques (avec Ferruccio Furlanetto), un Capriccio de Stravinski (2011) à l’humour exceptionnel (avec Emanuel Ax) et un Second Concerto pour violon de Martinů (2010) où Frank Peter Zimmermann se révèle étonnamment doucereux. Désormais conductor emeritus, Jansons, un des très grands de la direction d’orchestre alors qu’Abbado et Maazel nous ont récemment quittés, sera remplacé par Daniele Gatti à partir de la saison prochaine: lorsque ce dernier, tôt ou tard, quittera Amsterdam, on peut se demander s’il laissera des témoignages aussi riches et stimulants (coffret de treize disques et un DVD RCO 15002). SC
Ryan Brown revient à Philidor
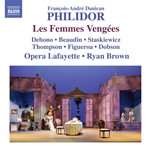
On ne se plaindra évidemment pas de voir fleurir les projets discographiques consacrés à des raretés du répertoire lyrique français, telles que la production présentée à Versailles en 2014 des Femmes vengées (1775), opéra comique du rare François-André Danican Philidor (1726-1795). On doit à Ryan Brown (né en 1958) et son ensemble américain Opera Lafayette de nombreuses redécouvertes chez Naxos, de Monsigny (Le Déserteur, Le Roi et le Fermier) ou Grétry (Le Magnifique) à Félicien David (et son opéra-comique Lalla Roukh). Il s’agit ici du second disque consacré à la veine comique de Philidor, après Sancho Pança en 2011, qui permet de retrouver un orchestre correct, dirigé de main de maître par Brown. Si l’on pourra regretter des cordes un peu sèches, la vivacité rythmique insufflée par le chef, tout autant que l’équilibre entre respiration et sens des couleurs, permettent de se régaler des dialogues entre instruments, il est vrai parfaitement mis en valeur par la prise de son. On sera malheureusement moins enthousiaste à l’égard du plateau vocal, souvent à la limite dans les difficultés techniques et passable quant à la prononciation du français. Les plus curieux pourront néanmoins se laisser tenter par la découverte cette œuvre délicieuse de Philidor, variée et lumineuse. A noter que contrairement à la production versaillaise de 2014, cet enregistrement ne comporte ni dialogues, ni récitatifs (8660353). FC
Rudolf Barshai, un musicien complet

Hormis peut-être son intégrale d’un excellent rapport qualité/prix des Symphonies de Chostakovitch réalisée à Cologne pour Brilliant Classics, on a un peu oublié Rudolf Barshai (1924-2010), alors qu’il fut loin d’être un inconnu en France – du temps où, la transcription anglaise des noms ne s’étant pas encore universellement imposée, il était d’ailleurs d’usage de l’appeler «Barchaï». A l’occasion des cinq ans de sa disparition, sa quatrième et dernière épouse, Elena (née Raskova), organiste et claveciniste, et l’éditeur ICA Classics lui rendent hommage au travers d’un coffret de vingt disques généreusement remplis (vingt-quatre heures trois quarts de musique) intitulé «A Tribute to Rudolf Barshai». La programmation en est pertinente, puisque ces enregistrements, réalisés en studio ou en public entre 1951 et 2004, parfois dans un son mono quelque peu précaire, sont inédits ou bien n’avaient pas été réédités depuis leur parution en 33 tours. Elle l’est d’autant plus qu’elle met en valeur les nombreuses facettes d’un musicien complet. L’altiste, d’abord, formé par le violoniste Lev Zeitlin [Tseitlin] et par Vadim Borissovski (l’altiste fondateur du Quatuor Beethoven): un instrument chaleureux et puissant, qui magnifie particulièrement des pages pour alto seul telles que la Deuxième Partita de Bach ou la Sonate opus 25 n° 1 de Hindemith. Le chambriste, entouré de partenaires exceptionnels, comme Kogan et Rostropovitch pour deux fantastiques trios à cordes de Beethoven, les mêmes avec Emil Gilels dans le Premier Quatuor avec piano de Fauré, ou bien Kogan, Elizaveta Gilels, Talalyan, Knushevitsky et Rostropovitch dans un Souvenir de Florence d’anthologie. Le cofondateur, en 1944, du Quatuor philharmonique de Moscou (l’ancêtre du Quatuor Borodine), avec sa première épouse Nina, Dubinsky et Rostropovitch (puis Berlinsky) – qu’on retrouve ici notamment dans le Quintette avec piano de Chostakovitch, en compagnie du compositeur – puis le cofondateur, en 1953, de l’éphémère Quatuor Tchaïkovski, avec Sitkovetsky (mort prématurément en 1958), Sharoev et Slobodkin – dans le Septième de Beethoven et deux quatuors de Chostakovitch. Le chef (formé par l’incontournable Ilya Musin), fondateur en 1955 de l’Orchestre de chambre de Moscou, qu’il dirigea jusqu’à son exil en Israël (1976), avant de prendre des fonctions dans le monde occidental, notamment comme principal conductor à Bournemouth de 1982 à 1988: les interprétations des compositeurs baroques (Albinoni, Vivaldi, Bach, Tartini), classiques (Boccherini, Haydn, Mozart), y compris des concertos avec Gilels, Kogan et Oïstrakh, et romantiques (Schubert, Dvorák, Mahler) ont plus ou moins bien vieilli et retenu l’attention, mais elles restent toujours sincères et le répertoire du XXe siècle lui réussit incontestablement – outre Bartók, Martinů et Stravinski, s’imposent une sidérante captation (1971) de la Quatorzième Symphonie de Chostakovitch (qu’il avait créée deux ans plus tôt) avec Zara Dolukhanova et Evgueni Nesterenko, et deux Anglais peut-être plus inattendus, Britten (Simple Symphony) et Tippett (Double Concerto, Danses rituelles). L’ami des compositeurs, Chostakovitch, bien sûr, mais aussi Revol Bounine [Bunin] (1924-1976), qui lui dédia son Concerto pour alto et dont on peut entendre ici aussi la Sonate pour alto et piano, dans un esprit assez voisin de celui de son maître Chostakovitch, ainsi qu’Alexandre Lokchine [Lokshin] (1920-1987), dont la musique évoque Berg, par exemple dans une Cinquième Symphonie «Shakespeare Sonnets» admirablement chantée par Thomas Allen (qui donne par ailleurs les Chants d’un compagnon errant de Mahler). L’arrangeur, enfin, célèbre par ses extensions pour orchestre à cordes de quatuors russes – ici le Premier de Tchaïkovski, le Second de Borodine et l’inévitable Huitième de Chostakovitch, hélas mal servis post mortem (2012) par l’ensemble à cordes de l’Orchestre symphonique national de Taiwan – mais également auteur d’une réalisation (2000) de la Dixième Symphonie de Mahler plus audacieuse et constructive que celle couramment jouée de Cooke, ne serait-ce que par son instrumentarium (guitare, xylophone, castagnettes...). Bref, un coffret varié et attachant, à l’image d’une riche personnalité (ICAB 5136). SC
Orphée de Gluck: encore une réussite pour Equilbey

En s’attaquant à Orfeo ed Euridice en sa version viennoise de 1762 (pour castrat et en trois actes), Laurence Equilbey revient à son répertoire de prédilection, le XVIIIe siècle, et ce tout juste quelques mois après une incursion réussie dans les univers singuliers de compositeurs aussi différents que Félicien David (Le Désert) et Bruno Mantovani. Si son Requiem de Mozart pouvait encore souffrir quelques reproches, notamment une battue un rien trop sèche, il n’en est rien ici. Au contraire, elle déploie un geste allant et toujours précis, d’une parfaite lisibilité, tout en s’appuyant sur un impeccable chœur de chambre accentus, tandis que Franco Fagioli s’impose nettement au-dessus du lot parmi les chanteurs. Ses qualités de rondeur et ses graves gorgés de soleil sont un régal de chaque instant. A ses côtés, Malin Hartelius (Euridice) fait valoir un beau timbre clair, dont la ligne de chant devient parfois instable dans l’aigu, au gré des difficultés techniques. A l’instar de Fagioli, son interprétation reste touchante grâce à un engagement constant, alors qu’Emmanuelle de Negri joue les partenaires de luxe en Amour, bien aidée par un timbre superbe et aérien (coffret de trois disques Archiv Produktion 4795315). FC
Une Stravaganza de très bonne facture

Après le succès européen remporté par son premier grand recueil de concertos (L’Estro Armonico opus 3), le suivant, La Stravaganza opus 4, fut de nouveau pour Vivaldi un grand succès dans le genre qu’il affectionnait particulièrement, celui du concerto pour violon. Les très bonnes versions de ce recueil ne manquent pas, de Simon Standage à Fabio Biondi en passant récemment par l’excellente Rachel Podger: et pourtant, le peu connu Federico Guglielmo (né en 1968) livre là une belle réalisation qui mérite qu’on la remarque, l’enregistrement ayant eu lieu en juillet 2014. Certaines options sont pourtant maladroites: des fins de mouvements parfois prévisibles et trop appuyées (la fin de l’Allegro du Concerto n° 5 ou la fin du Largo dans le Concerto n° 7), un clavecin parfois un peu intrusif (dans le Concerto n° 1), des traits de temps à autre un brin excessifs (dans le Concerto n° 11)... Mais hormis cela, l’interprétation est enthousiasmante en plus d’une occasion. Guglielmo est un très bon soliste qui se sort des traits techniques vivaldiens avec une vraie facilité, l’orchestre L’Arte dell’Arco accompagnant celui-ci avec tantôt une attention, tantôt une truculence rafraîchissantes. Qu’il s’agisse du premier mouvement du Concerto n° 8, du mouvement conclusif du Concerto n° 6 ou du premier Allegro du Concerto n° 9, l’esprit de Vivaldi est bel et bien présent: et c’est bien là l’essentiel! (album de deux disques Brilliant Classics 95043). SGa
La grande époque de l’English National Opera
 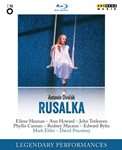
Parmi les nombreux titres réédités par Arthaus dans la série «Legendary Performances» (voir par ailleurs ici et ici), Rusalka (1901) et Gloriana (1953) nous rappellent combien l’English National Opera savait se rendre incontournable face à son concurrent, le Royal Opera House, particulièrement en ce qui concerne l’excellence des chanteurs réunis. On retrouve ici deux productions dirigées par Mark Elder, longtemps directeur musical de l’institution (1979-1993), avec un geste frémissant et dramatique, aussi bien dans Gloriana en 1984 (il n’a alors que 37 ans) que deux ans plus tard pour Rusalka.
Diversement apprécié à sa création, et ce en comparaison du succès de Billy Budd l’année précédente, le huitième opéra de Britten fait toujours partie aujourd’hui des plus mal aimés de son auteur. Le livret maladroit, tout comme une musique souvent trop chargée (sans parler de ses chœurs tonitruants), en font une œuvre inégale, rarement montée. Ici, c’est surtout la mise en scène datée de Colin Graham, l’un des fidèles collaborateurs du maître d’Aldeburgh pendant toute sa carrière, qui déçoit par un traitement littéral fondé sur des costumes d’époque et une scénographie sans surprises. Les interprètes, souvent figés, font ce qu’ils peuvent pour animer une trop rare action. Fort heureusement, les forces vocales réunies, brillamment menées par une vibrante Sarah Walker, se montrent impressionnantes jusque dans le moindre petit rôle (Blu-ray 109 152 ou DVD 109 151).
Même constat d’excellence vocale à la découverte de la production de Rusalka, chantée en anglais à l’instar de toutes celles de l’English National Opera. Merveilleuse actrice, l’Australienne Eilene Hannan transcende ses moyens pour imposer une bouleversante nymphe, tandis que John Treleaven compense son manque de style par son impact physique et son aisance vocale. Là aussi, les rôles secondaires se montrent tous de haut niveau, de la sorcière au simple garçon de cuisine. Mais cette production vaut peut-être plus encore pour son exceptionnelle mise en scène, qui fit beaucoup pour la renommée de David Pountney en Grande-Bretagne et en dehors de son pays. Associé à l’English National Opera de 1982 à 1993, le natif d’Oxford a l’idée de transposer l’action en un manoir anglais qui, avec son atmosphère fantastique, n’est pas sans rappeler celui du Tour d’écrou de Britten. A l’infirmité physique de l’héroïne répond celle de son père, tandis qu’elle évoque aussi son enfermement mental – ou l’incapacité à affronter le monde du dehors. Pountney s’intéresse ainsi au parcours initiatique de l’héroïne, empêtrée dans son refus d’accepter le difficile passage à l’âge adulte avec son corollaire, la sexualité. Cette mise en scène inventive multiplie aussi les traits d’humour à la manière d’un conte pour enfants, tout en restant sans cesse en un esthétisme épuré qui annonce Robert Carsen. Assurément une des grandes réussites de Pountney, dont la captation sonore comme la réalisation n’appellent que des éloges (Blu-ray 109 150 ou DVD 109 149). FC
Piano au féminin et en français: anthologies Engerer et Le Guay
 
 
Les disques de Brigitte Engerer (1952-2012) parus sous étiquette Decca avaient déjà fait l’objet d’une réédition en CD. Cette dernière est désormais mise en boîte dans des pochettes cartonnées afin de permettre, à moindre coût, de retrouver les enregistrements bien connus de Chopin, Tchaïkovski, Schumann, Schubert et Liszt de la regrettée pianiste française (lire ici). Au sommet, on trouve les transcriptions lisztiennes de Lieder de Schubert: une sélection de sept pièces où rayonne la poésie combattante du toucher d’airain de la native de Tunis. Plus émouvants que ses Tchaïkovski, un compositeur pourtant si cher au cœur de celle qui fut l’élève de Stanislas Neuhaus au Conservatoire de Moscou. De Schumann, on retient principalement une éclatante Deuxième Sonate, dont on a déjà eu l’occasion de louer l’athlétisme limpide (lire ici). De Schubert, des Impromptus remplis d’amour et une Mélodie hongroise débordant de tendresse. De Chopin, un esprit simple et chaleureux (coffret de six disques 4810007).
En trois coffrets, Universal rend également un très bel hommage aux enregistrements d’une autre pianiste française. Claire-Marie Le Guay (née en 1974) y démontre l’étendue de ses talents protéiformes, aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans les partitions plus contemporaines. On renverra à nos différentes critiques des disques Haydn, Mozart, Liszt (en solo comme dans les Concertos), Ravel et Stravinski le détail des qualités de cet ensemble discographique déjà conséquent. Réputées, ses Etudes d’exécution transcendante mériteraient d’ailleurs d’être soumises à l’épreuve de l’écoute comparée. Le répertoire du XXe siècle est une aubaine pour ceux qui souhaitent s’aventurer – sans risques – dans les Sonates de Carter ou Dutilleux, les Concertos de Schulhoff ou Goubaïdoulina, les partitions pour piano et orgue de Thierry Escaich, Jean Guillou, Marcel Dupré ou Jean Langlais. Déjà une valeur sûre (Accord deux coffrets de trois disques 4811984 et 4811987 et un coffret de cinq disques 4812009). GdH
Gernsheim dans les pas de Brahms

Après un premier disque consacré à deux des quatre Symphonies de Friedrich Gernsheim (1839-1916) paru voilà deux ans, cpo poursuit l’exploration de l’œuvre méconnu de ce compositeur proche de Brahms, cette fois autour de sa musique de chambre. C’est en ce domaine que le natif de Worms a construit une flatteuse réputation de son vivant, malheureusement rapidement tombée dans l’oubli à sa mort. Les deux Quintettes avec piano ici réunis ont été publiés par Gernsheim à vingt ans d’intervalle, le premier en 1877 et le second à la mort de Brahms en 1897. Ce qui frappe d’emblée, c’est l’harmonieuse clarté qui se dégage de ces deux œuvres constamment séduisantes. Le Premier s’avère plus dramatique, marqué par un Andante d’une belle intériorité, réfléchi et sans extraversion, où des vagues en flux et reflux enveloppent l’auditeur de son flot régulier. Plus dansant, le Vivace fait rapidement place à une fugue admirable en entrée de finale, offrant ensuite davantage de lyrisme. Plus poétique, le Second bénéficie de l’interprétation expressive et généreuse du Quatuor Gémeaux (fondé à Bâle en 2003), autour d’un jeu toujours précis – admirablement accompagné par un délicat Oliver Triendl (né en 1970) dont le piano ne cherche jamais à tirer la couverture à lui. Un beau disque pour découvrir la musique de cet épigone talentueux de Brahms, tandis qu’un nouvel enregistrement chez cpo vient tout juste de sortir en octobre, s’intéressant cette fois à ses deux Concertos pour violon (777 580-2) FC
Les Nibelungen de G. Huppertz: du grand cinéma!

Gottfried Huppertz (1887-1937) est l’auteur de la musique de deux films de Fritz Lang: Die Nibelungen (1924) et Metropolis (1927). Alors que l’on garde en mémoire le bel effort de Bernd Heller pour redonner vie au second, c’est la partition du premier opus qui fait l’objet de cet enregistrement gravé en 2009 et 2010 à Francfort – et digne de tous les éloges. Quatre heures et demie d’une musique puissamment cinématographique, toute entière coulée dans une veine expressionniste – qui donne à voir autant qu’à entendre. Fabuleux voyage symphonique, au caractère certes purement illustratif et aux leitmotivs plutôt répétitifs – mais au style saisissant. L’Orchestre de la Radio de Francfort, dirigé avec passion par Frank Strobel (né en 1966), donne vie aux épisodes de Siegfried comme à ceux de La Vengeance de Kriemhild, dans un geste ample, lent, obsédant, dépressif et angoissé. Celui du monde au bord de l’autodestruction (coffret de quatre disques Pan Classics PC 10345). GdH
Rheinberger, l’autre favori de Louis II

C’est à une superbe anthologie de la musique religieuse de Josef Rheinberger (1839-1901) que nous convie ce coffret de dix disques édités par Carus, tous enregistrés entre 1988 et 2009, hormis un plus ancien (1968) consacré à l’oratorio L’Etoile de Bethléem. On pourra parler de quasi-intégrale tant le corpus assemblé est impressionnant: neuf messes et deux requiem, sans parler des motets, Salve Regina et Stabat Mater gravés ici. On note aussi très peu de doublons recensés (cinq œuvres sur trente-cinq, dont quatre d’une durée inférieure à 5 minutes), et ce alors même que ces disques ont tous été enregistrés séparément, sans volonté de les regrouper un jour. Preuve en est la variété des formations réunies, allemandes pour la plupart, de Stuttgart à Sarrebruck, en passant par Francfort et Munich, avec également deux disques gravés par des ensembles venus de Vancouver. De quoi permettre une connaissance précise du méconnu Rheinberger. Le natif du Liechtenstein a passé toute sa carrière en Bavière, recueillant les plus grands honneurs jusqu’à son accession au poste prestigieux de maître de chapelle de la cour du roi Louis II en 1877. Reconnu en tant que compositeur, il s’illustra également dans l’enseignement, ayant notamment comme élèves Humperdinck, Wolf-Ferrari ou Furtwängler. Du fait de son conservatisme musical, Rheinberger a été rapidement oublié en dehors des pays germaniques, où sa musique religieuse conserve encore une audience. On comprend pourquoi à la découverte de son œuvre qui allie l’éloquente simplicité à la clarté lumineuse, en une lisibilité et un sens mélodique efficaces. Un seul disque fait appel à un orchestre symphonique: le superbe oratorio L’Etoile de Bethléem (1890-1892) bénéficie des forces de la Radio bavaroise et de superlatifs solistes (irradiante Rita Streich, sans parler du phrasé envoûtant de Dietrich Fischer-Dieskau), même si l’on aimerait parfois davantage de surprises dans la battue de Robert Heger. Les autres gravures alternent des œuvres pour chœur a capella, d’autres seulement accompagnées par l’orgue ou le piano, tandis que plusieurs messes excluent les pupitres masculins ou, à l’inverse, les femmes. Les deux disques canadiens font partie des meilleurs de la série, autour d’une prise de son chaleureuse (au contraire des deux disques de Georg Grün, peu prioritaires de ce fait) et de formations d’un bon niveau technique, hormis quelques accrocs à la justesse pour les sopranos dans l’aigu. Le disque Bernius est aussi l’un des plus réussis, surtout au niveau de ses solistes, tout comme les gravures d’Eberhard Metternich et d’Holger Speck (dont on écoutera en premier lieu la splendide Messe en la, opus 126). On pourra faire l’impasse, en revanche, sur le disque de Wolfgang Schäfer, là aussi en raison de quelques difficultés avec la justesse. Une somme néanmoins chaleureusement recommandée, disponible à un prix attractif, qui s’ajoute au coffret déjà sorti en 2011 réunissant l’intégrale de l’œuvre pour piano de Rheinberger (coffret de dix disques Carus 83 336). FC
Symphonies de C. P. E. Bach: en attendant mieux

Les symphonies de Carl Philipp Emanuel Bach n’encombrent pas les rayonnages de disques. La réédition par Brilliant Classics de ces enregistrements réalisés pour Capriccio en 1985 et 1986 par Hartmut Haenchen (né en 1943) s’avère donc des plus opportunes à défaut d’être musicalement pleinement convaincante. S’il est vrai que l’interprétation sur instruments d’époque a connu une véritable révolution depuis plus de trente ans maintenant, force est de constater que certaines caractéristiques sont ici assez rédhibitoires: un clavecin omniprésent, une raideur qui transparaît parfois dans l’exécution (le Presto de la Symphonie H. 657), des instruments qui sont mis trop en avant en raison (du moins peut-on le soupçonner...) de micros mal placés (la flûte dans le Presto de la Symphonie H. 659). Pour autant, on se laisse doucement conduire par cet ensemble de dix symphonies dont le style opte franchement pour le classicisme à la Haydn (c’est patent dans le premier mouvement de la Symphonie H. 661), Haenchen menant avec enthousiasme un très bon Orchestre de chambre «Carl Philipp Emanuel Bach». Ainsi, on se laisse prendre par le célèbre Presto conclusif de la Symphonie H. 665 avant d’apprécier pleinement le Presto conclusif de la Symphonie H. 658 ou le magnifique premier mouvement de la Symphonie H. 661 précitée. En attendant mieux, une interprétation qui ravira les amateurs du genre (album de deux disques Brilliant Classics 94821). SGa
Un premier violon trop étriqué pour les trios de Hänsel

Respecté en son temps, l’Allemand Peter Hänsel (1770-1831) s’est surtout illustré dans le domaine de la musique de chambre, composant notamment pas moins de cinquante-huit Quatuors à cordes. Le présent disque s’intéresse à ses trois derniers trios à cordes (Opus 40), écrits un an avant sa mort pour la formation canonique de ce genre (violon, alto et violoncelle) – les trois premiers l’ayant été pour deux violons et un violoncelle. Elève de Haydn et Pleyel, Hänsel poursuit dans la veine de ses aînés, apportant lisibilité et clarté à ses œuvres, tandis que le violon domine, rappelant combien le natif de la Silésie excellait sur son instrument fétiche. On tient là des œuvres classiques, dans le bon sens du terme, où la maîtrise de la structure tout autant que des enchaînements apporte un confort d’écoute certain, idéal de naturel. Dommage que le violon trop étriqué de Timothy Jones, à la limite de la justesse dans l’aigu, ne gâche un peu le plaisir insufflé par la bonne tenue du Trio Anditi de Cologne. Une parution intéressante, mais pas essentielle non plus (coffret de deux disques RBM 463 066/67). FC
Savoureux comme une madeleine

«L’Oreille de Proust»: ce titre amusant est celui d’un spectacle de fantaisie musicale et théâtrale dont ce disque ravive le souvenir. La musique occupe, en effet, une place importante dans la vie et l’œuvre de Proust, comme le rappelle le texte de présentation, substantiel, fouillé et agrémenté de photographies anciennes de Cabourg.Anne-Lise Gastaldi et David Saudubray interprètent des pièces pour piano à quatre mains, essentiellement des extraits, ce qui est un peu frustrant, l’auditeur étant, de plus, privé de la récitation des textes par la comédienne Farida Rahoudj. Mais ce programme d’un peu moins d’une heure procure du plaisir, surtout que l’interprétation est d’un goût irréprochable, en particulier celle du finale du Divertissement hongrois de Schubert, qui donne envie d’être écouté en boucle, la transcription de Carmen par Rebrovic valant aussi le détour. A des pages de Fauré (Souvenirs de Bayreuth, «Le Jardin de Dolly») et Debussy («Pour que la nuit soit propice» des Epigraphes antiques) viennent s’ajouter l’«Orage» de la «Pastorale» et un extrait du Sacre du printemps – la lecture du texte permet de comprendre ce qui préside à un tel choix. L’instrument utilisé n’est pas précisé: s’agit-il d’un de ces pianos anciens joués dans les salons de l’époque? Il semble que ce ne soit malheureusement pas le cas. Un disque à part mais savoureux comme une madeleine (Arties Records AREC 004). SF
Une Impératrice sans chanteurs

On doit au festival Lehár de Bad Ischl, situé à quelques encablures de Salzbourg, la défense de la musique de Leo Fall (1873-1925). Cadet de trois ans de son célèbre contemporain Franz Lehár, le compositeur s’illustra principalement dans la musique légère, composant pas moins de vingt-trois opérettes au cours de sa brève carrière. D’abord chef d’orchestre, l’Autrichien se consacra en effet à la composition dès 1904, avant son décès prématuré en 1925. Ce compositeur efficace, fort de ces succès précédents (dont Die Dollarprinzessin en 1907), fut l’un des rares à être autorisé à monter ces productions pendant la Première Guerre mondiale, à l’instar de Die Kaiserin (L’Impératrice) en 1916. Leo Fall se montre ici assez traditionnel, alternant les dialogues – près de 50 minutes sur les 142 au total – avec l’élan irrésistible des rythmes de danses admirablement variés. Il faut dire que l’excellente direction de Marius Burkert exalte un orchestre correct, tandis que le plateau vocal conséquent s’avère globalement insuffisant jusque dans ses rôles principaux. Ainsi de l’impératrice de Miriam Portmann, qui se montre incapable d’assurer sa partie dans les passages virtuoses, tandis qu’à la ligne de chant instable s’ajoute un timbre qui manque de substance dans l’aigu. Son comparse Franz n’est guère plus convaincant, avec un chant en force et au timbre peu flatteur. Seules les parties parlées montrent un théâtre du plus bel effet, engagé et tourbillonnant: trop peu, hélas, pour sauver cette production bien décevante (cpo 777 915-2). FC
Trois Fantastiques pas fantastiques

 
Faut-il prendre Berlioz avec des pincettes? C’est ce que semblent considérer trois chefs se confrontant en public à la bouillonnante Symphonie fantastique avec une prudence qui élude une grande partie de l’imaginaire sonore et narratif du compositeur français.
En juin 2010 à Chicago, Riccardo Muti (né en 1941), comme trois ans plus tôt à Salzbourg, impose un Berlioz raffiné, presque chambriste, mais excessivement aseptisé, s’endormant dans la perfection instrumentale de l’Orchestre symphonique de Chicago, dont il s’apprêtait alors à prendre la direction musicale. Déjà précédemment disponible en téléchargement seul, ce double album comprend également la «suite» de la Fantastique, le beaucoup plus rare Lélio ou Le Retour à la vie pour récitant, solistes, chœur et orchestre: malgré le vibrato infernal du ténor Mario Zeffiri, Muti tire le meilleur de cet improbable assemblage de fonds de tiroir liés par un texte dit par un Depardieu halluciné, qui, sans doute grâce au sous-titrage, fait parfois aussi rire les spectateurs (CSO Resound CSOR9011501).
En juin 2013, Douglas Bostock (né en 1955) ne manifeste guère plus d’enthousiasme et les faiblesses du Philharmonique d’Argovie (connu jusqu’en 2013 sous le nom d’Orchestre symphonique argovien), dont il est le Chefdirigent depuis 2001, sont totalement rédhibitoires: bien chétive en cordes, la phalange suisse ne réussit pas mieux dans l’orchestration par Berlioz de L’Invitation à la valse de Weber, qui introduit le disque (SACD hybride Coviello Classics COV 91508).
Trois mois plus tard, non loin de là, Fabio Luisi (né en 1959), principal director du Met depuis 2011 et Generalmusikdirektor à Zurich depuis 2012, est à la tête du Philharmonia de Zurich – depuis 2012 l’un des deux noms (avec La Scintilla, sur instruments anciens) sous lesquels l’Orchestre de l’Opéra sort de la fosse. Inaugurant sa propre maison d’édition avec le présent disque et une anthologie Wagner, la formation suisse, élégante et performante, s’y montre tout à fait à son avantage mais le propos reste désespérément lisse et routinier, dépourvu d’enjeux et d’aspérités (Philharmonia Records PHR 0101). SC
Dvorák puissance huit chez Supraphon

On ne remerciera jamais assez Supraphon de l’excellence du travail réalisé, l’éditeur ayant toujours su s’entourer, au cours des années, des meilleurs interprètes tchèques. Ce coffret s’intéresse à la musique religieuse et aux cantates de Dvorák, en un tour d’horizon très complet, des grands chefs-d’œuvre que sont le Stabat Mater (1877-1880) et le Requiem (1890) jusqu’aux joyaux méconnus tel que La Fiancée du spectre (également connue sous le nom de Les Chemises de noces, 1885). La totalité des œuvres réunies en ces huit disques appartiennent aux années de maturité du compositeur, entre 1877 et 1894, période pendant laquelle les quatre dernières symphonies sont composées. On retrouve des gravures exceptionnelles et bien connues, tel l’enregistrement du Requiem réalisé en 1984 par Wolfgang Sawallisch (1923-2013) à la tête des forces de la Philharmonie tchèque. Cette grande version classique n’a rien perdu aujourd’hui de son éclat et de sa ferveur, habitée par le geste intense et précis du grand chef bavarois. Pour le Stabat Mater, Supraphon a choisi la gravure de 1998 due à Jirí Bělohlávek (à ne pas confondre avec son précédent enregistrement pour Chandos), l’une des plus récentes parmi les nombreuses autres à sa disposition. La direction cursive de Bělohlávek fait merveille, allégeant les textures autour d’un geste souple qui révèle une myriade de couleurs, tout en évacuant l’emphase dramatique et... l’émotion propre à d’autres versions (Kubelík par exemple). Seul bémol, les Chœurs de la Philharmonie tchèque apparaissent un rien moins à l’aise – les sopranos surtout – que vingt ans plus tôt. Ce coffret est aussi l’occasion de retrouver le grand chef Václav Smetácek (1906-1986) autour de deux de ses meilleurs enregistrements, l’oratorio Sainte Ludmila (1886) et le disque consacré au Te Deum (1892), à la Messe en ré majeur (1887, orchestrée en 1892) et à la version orchestrale des Chants bibliques (1894). Moins inspirée au niveau mélodique que le Stabat Mater, Sainte Ludmila lui emprunte ses couleurs sombres et dramatiques, avec une forte présence symphonique. Assurément une œuvre à découvrir dans cette interprétation, où un Smetácek engagé et percutant se régale des contrastes. Moins prioritaire, le Te Deum profite là aussi du geste cinglant du chef tchèque, tandis que la Messe se fait plus modeste, animée par la dévotion sincère de Dvorák. On ne manquera évidemment pas le plaisir de la confrontation des deux versions des Chants bibliques, avec d’un côté le raffinement instrumental de Smetácek, et de l’autre le piano précis et intérieur d’Ivan Moravec (version gravée dans le tout dernier disque du coffret). A chaque fois, les interprètes bouleversent. Seules les versions des pièces pour voix et orgue ou piano (Hymnus ad laudes, Ave Maria Stella et O sanctissima) déçoivent par l’insuffisance des solistes réunis. De bien infimes réserves pour un coffret d’excellence, hautement recommandable. Une seule anomalie: on trouve deux fois le septième disque tandis que le sixième (seconde partie de Sainte Ludmila) est absent, de telle sorte qu’il reste à espérer que ce défaut d’édition n’affecte pas l’ensemble des exemplaires (coffret de huit disques SU 4187-2). FC
La rédaction de ConcertoNet
|