|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de juin
06/15/2013
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Regards en arrière d’A. Tansman Regards en arrière d’A. Tansman
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Brahms et Tchaïkovski par G. Anda Brahms et Tchaïkovski par G. Anda
 «Pelléas et Mélisande» cent ans après «Pelléas et Mélisande» cent ans après
  Oui! Oui!
Hommage à Olivier Greif
Ariane et Barbe-Bleue au Liceu (2011)
Œuvres méconnues de Wagner
Joan Rodgers et Roderick Williams chantent Wolf
Niu Niu interprète Liszt
Le Quatuor de Tokyo dans Beethoven, Bartók et Berg
Le Quatuor Hagen interprète Beethoven
Fanny Clamagirand interprète Saint-Saëns
Récital de Solenne Païdassi et Laurent Wagschal
Neeme Järvi dirige Atterberg
Owen Wingrave de Britten
Le Quatuor Attaca interprète Adams
Musique de chambre pour vents de Caplet
Le Quatuor Keller interprète Ligeti et Barber
David Porcelijn dirige H. Andriessen
Jun Märkl dirige d’Albert
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Arthur Rubinstein à la BBC
Pier Paolo Vincenzi interprète Wagner
Le Quatuor Belcea interprète Beethoven
Le Quatuor Delian et G. Caussé interprètent Beethoven
Le Quatuor de Crémone interprète Beethoven
Aquiles Delle Vigne interprète Liszt
Œuvres pour cordes de Dobrinka Tabakova
Le Trouvère à Parme (2010)
Stiffelio à Parme (2012)
Récital de Laure Favre-Kahn
Le Trio Lenitas interprète Bach/Mozart
Trois œuvres de Benoît Menut
Pas la peine
Dario Bonuccelli interprète Wagner
Michele Campanella interprète Liszt
Emmanuelle Swiercz interprète Liszt et Bonardi
Le Quatuor Miró interprète Beethoven
Le Quatuor Chiaroscuro interprète Beethoven
Jennifer Pike interprète Brahms et Schumann
Colin Davis dirige le Freischütz
«Czardas Fantasy» par Ferenc Vizi et l’Ensemble Cifra
Don Giovanni à Glyndebourne (1977)
Hélas!
Ashley Wass interprète Beethoven/Liszt
L’entretien du mois
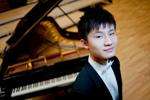
Niu Niu
Le match du mois
  
Trois jeunes violonistes: F. Clamagirand, S. Païdassi et J. Pike
En bref
Les cordes de Dobrinka Tabakova
Deux nouvelles pierres parmesanes à l’édifice «Tutto Verdi» de C Major
Adams en quatuor
Caplet dans le(s) vent(s)
Mozart arrange Bach en trio
Benoît Menut trouve une voie et une voix
Britten le pacifiste
Le Freischütz de Colin Davis rate sa cible
A la source des Rhapsodies hongroises
Les Keller comme un mécanisme de précision
Un Don Giovanni sans éclat
L’invitation à la danse de Laure Favre-Kahn
Atterberg, l’homme qui valait 10000 dollars
A la découverte de Hendrik Andriessen
Eugen d’Albert symphoniste
Les cordes de Dobrinka Tabakova

Il y a une esthétique, une «touche» ECM New Series, jusque dans la prise de son, et la Britannico-Bulgare Dobrinka Tabakova (née en 1980) s’y inscrit de façon on ne peut plus naturelle. Intitulé «String Paths», l’album privilégie une écriture sagement néotonale et, on s’en doute, les cordes. Elles sont simplement enrichies de quelques percussions dans la Suite dans le style ancien (2006) pour alto et orchestre, avec son créateur, l’altiste ukrainien Maxim Rysanov, à la tête de l’Orchestre de chambre de Lituanie: sous-titrée «Amareu [anagramme de Rameau] le bouffon du roi» et incluant une partie de clavecin assez développée, l’œuvre, pittoresque, ironique et bigarrée, rappelle parfois les pastiches ironiques d’un Schnittke. Les grands aplats à la Pärt d’Insight pour trio à cordes et le minimalisme doucement planant de Such different paths (2008) pour septuor à cordes (autour de Janine Jansen et Torleif Thedéen) manquent d’originalité sinon de savoir-faire. Le compositeur montre cependant un talent certain pour les échappées lyriques, notamment celles du deuxième mouvement («Désir») de son Concerto pour violoncelle (2008), avec en soliste sa créatrice, la Lettonne Kristina Blaumane. Dans cet univers, la brève pièce Frozen River Flows (2005), originellement écrite pour hautbois et percussion, apporte une diversité bienvenue avec les sonorités de l’accordéon (Raimondas Sviackevicius), du violon (Roman Mints) et de la contrebasse (Donatas Bagurskas) ses racines populaires (476 4826). SC
Deux nouvelles pierres parmesanes à l’édifice «Tutto Verdi» de C Major
 
C Major complète progressivement sa collection «Tutto Verdi». Capté à Parme en 2010, ce Trouvère ne réunit pas les quatre meilleurs chanteurs du monde, mais la distribution n’en reste pas moins fiable: Marcello Alvarez (seule star du plateau) en Manrico, Claudio Sgura en comte de Luna, Teresa Romano en Leonora et Mzia Nioradza en Azucena, quatre voix puissantes et saines, chantent avec éclat, style et assurance. Yuri Temirkanov dirige plutôt bien un orchestre attentif et uni. Fonctionnelle et conventionnelle comme tant d’autres, la mise en scène et le décor évoquant la surface de la Lune n’appellent guère de commentaires (726408). Bel opéra que Stiffelio: à part une sinfonia quelconque et interminable, les trois actes sur un livret du fidèle Francesco Maria Piave comportent de bien bons moments, certaines pages appartenant au meilleur Verdi. Cette production montée à Parme en 2012, et récemment reprise à Monaco, bénéficie de chanteurs de bon niveau: Stiffelio robuste de Roberto Aronica, Lina irréprochable de Yu Guanqun (adorable avec ses petites lunettes), Stankar épatant de Roberto Frontali et Raffaele sonore et élégant de Gabriele Mangione. Le jeune Andrea Battistoni dirige avec énergie et conviction un orchestre impliqué tandis que Martino Faggiani prouve une fois de plus quel formidable chef de chœur il est. La mise en scène sobre et littérale de Guy Montavon n’innove en rien, de même que le décor austère et terne de Francesco Calcagnini, qui se laisse néanmoins regarder. Pour une chronique en anglais, lire ici (723008). SF
Adams en quatuor

La photo de couverture saisit les deux filles (violons) et les deux garçons (cordes graves) du Quatuor Attaca, constitué voici dix ans à la Juilliard School, sur le quai d’une gare: ce ne sont pourtant pas les Different Trains de Reich qu’ils ont mis au programme de leur premier album, mais l’intégrale de l’œuvre pour quatuor à cordes d’un autre grand du «minimalisme» américain, John Adams. Tenant une bonne place au sein d’un catalogue de musique de chambre assez concis, le corpus consiste en trois partitions, dont une seule revendique le titre de Quatuor (2008): un ambitieux diptyque, dont le premier volet atteint à lui seul près de 20 minutes, soit plus du double du second. Précisément, la maîtrise de la durée pose parfois problème dans ce premier volet, mais on retrouve ensuite tout le dynamisme obsédant dont est capable le compositeur californien. Destiné au Quatuor Kronos, le Livre de danses présumées de John (1994) – «présumées» car les pas en restent à inventer – recourt, pour six de ses dix pièces, dont les interprètes ont la liberté de choisir l’ordre, à une bande où sont enregistrés des sons percussifs de piano préparé. Mais cette musique postmoderne, souvent très rythmée, ludique et détraquée, bien loin d’évoquer Cage, cultive l’esprit déjanté de la Symphonie de chambre, de deux ans antérieure: références tordues, titres intrigants, pastiches décalés («Pavane She’s so fine»), Adams entretient parfois ici des affinités avec son aîné Ligeti ou son cadet Adès. Très affûtés, les musiciens américains concluent sur la première au disque de Compagnon de route (2007), qui donne son titre à leur album («Fellow Traveler»): écrite pour les cinquante ans du metteur en scène Peter Sellars et, de nouveau, créée par le Quatuor Kronos, cette brève page (5 minutes) est du pur Adams, virtuose et survitaminé (Azica Records ACD-71280). SC
Caplet dans le(s) vent(s)

Hormis le Conte fantastique (et encore), la musique de chambre d’André Caplet est laissée en jachère. Ce disque bienvenu réunit des œuvres pour vents conçues pour différentes configurations. Le compositeur recherche des alliages de timbres particuliers comme dans la Légende (1904) qui requiert, outre un quintette à cordes, un hautbois, une clarinette, un basson et un saxophone. Une fort belle page au même titre que la délicieuse Suite persane (1900) pour dixtuor (flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors), pleine de sinuosités orientalisantes. Plus classiquement constitué, le Quintette (1898-1899) pour flûte, hautbois, clarinette, basson et piano accuse quelques longueurs tandis que les brèves Pièces (1897) pour flûte et piano s’avèrent quant à elles plus anecdotiques. De la musique peut-être pas essentielle mais peaufinée, pétulante et d’autant plus attachante que l’interprétation de l’Ensemble Initium, de Laurent Wagschal et du Quatuor Ardeo est au-dessus de tout soupçon (Timpani 1C1202). SF
Mozart arrange Bach en trio

En 1782, Mozart découvre Bach: l’influence en est perceptible dans son écriture et il travaille sur celle de son aîné notamment en réalisant diverses transcriptions. C’est le cas de deux recueils pour trio à cordes (K. 404a) comprenant chacun trois Préludes et Fugues: le premier reprend trois des fugues à trois voix (transposées) du Clavier bien tempéré précédées de Préludes originaux; le troisième diptyque du second recueil est conçu de la même manière, mais avec une fugue pour orgue de Wilhelm Friedemann Bach, tandis que les deux premiers diptyques sont entièrement fondés sur des extraits de deux des Sonates en trio pour orgue. Le Trio Lenitas donne l’intégrale de ces pages peu connues – peut-être parce que leur attribution est parfois mise en doute. Il y ajoute l’arrangement par l’organiste suisse Guy Bovet, sur le même modèle «Prélude et Fugue», de deux mouvements d’une autre des six Sonates en trio. Le jeu n’est pas toujours très séduisant et l’exercice demeure sans surprise, d’autant que la musique de Bach se prête comme nulle autre à toutes les formations instrumentales, mais ceux qui ne veulent rien ignorer de Mozart auront à cœur de le suivre dans son étude des œuvres du Cantor (Gallo CD-1399). SC
Benoît Menut trouve une voie et une voix

Elève de Jacques Castérède et Jacques Charpentier, Benoît Menut (né en 1977) a également été marqué par Olivier Greif, dans les toutes dernières années de sa vie. Cet album monographique intitulé «Monologue(s)» et publié par Sonogramme s’ouvre, précisément, sur le Trio in memoriam Olivier Greif (2008), qu’on peut entendre ici par les mêmes interprètes, les membres du Trio Schubert, que ceux du concert inclus dans l’un des douze DVD récemment publiés en son hommage, mais cette fois-ci en studio, dans de bien meilleures conditions sonores. Avec cette œuvre créée dans le cadre de la résidence d’artistes de La Prée, dont Greif fut l’une des figures les plus marquantes, tout renvoie à l’aîné trop tôt disparu: le titre des quatre mouvements, les citations, le style «coup de poing», mêlant références et paroxysmes. Le disque comprend par ailleurs deux récentes pages vocales, créées au festival «Plage musicale en Bangor», dont le fondateur et directeur musical est Christophe Beau, violoncelliste de l’infatigable ensemble Accroche Note, toujours autour de la soprano Françoise Kubler et du clarinettiste Armand Angster. Le Baiser de marbre noir (2010), sur un texte de Christian Bobin agencé en cinq parties successives, évoque clairement Messiaen (Poèmes pour Mi, Trois petites liturgies de la présence divine) par son traitement de la voix et du texte, par son langage et, sans doute aussi, par sa formation instrumentale, très «pour la fin du temps» (clarinette, violoncelle et piano). Moitié moins développé mais d’un seul tenant et excluant le violoncelle, Le Monologue d’Anna (2011), sur un texte de Dominique Lambert, se détache de ces encombrants modèles: même s’il ne vise pas davantage à révolutionner l’histoire de la musique, ses qualités expressives s’imposent plus nettement. Dans une brève note d’intentions et de remerciements suivant la notice de Mathieu Ferey, le compositeur brestois observe: «plus que la vaine quête d’un idéal, quel qu’il soit, le chemin croyant y conduire que j’aime par-dessus tout». De fait, les trois partitions ainsi réunies et présentées chronologiquement montrent que Benoît Menut a trouvé une voie sur laquelle il sera intéressant de le suivre à l’avenir (SNG-12-EMA-01). SC
Britten le pacifiste

Œuvre à visée idéologique bien de son temps, Owen Wingrave (1971) de Britten souffre d’une conclusion bancale dans laquelle le fantastique s’immisce dans le réel. Ce huis clos familial sur un livret de Myfanwy Piper d’après Henry James (Le Tour d’écrou) passe évidemment bien à la télévision, encore qu’il mériterait d’être monté plus souvent. Conçue pour le petit écran par Margaret Williams, cette production de 2001 recourt à une distribution de premier ordre: les formidables Gerald Finley (Owen Wingrave), Peter Savidge (Spencer Coyle), Josephine Barstow (Miss Wingrave), Charlotte Hellekant (Kate) et Martyn Hill (Sir Philip Wingrave) confèrent à leurs personnages une épaisseur et une véracité impressionnantes. Excellent dans les opéras du XXe siècle, Kent Nagano obtient le meilleur du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Reste une question existentielle: revient-on plus souvent à un disque ou un DVD quand on affectionne une œuvre? La production télévisée dirigée par le compositeur a également été chroniquée sur notre site (Arthaus Musik 100 373). SF
Le Freischütz de Colin Davis rate sa cible

Il aurait été tellement réconfortant de rendre hommage à Colin Davis, disparu le 14 avril dernier, en saluant avec enthousiasme son dernier enregistrement. Hélas, le moins qu’on puisse de cette version de concert (sans dialogues parlés) du Freischütz, réalisée en avril 2012 au Barbican, est qu’elle déçoit. Ce qui est rageant, c’est que ni le chef, ni même le Chœur et l’Orchestre symphonique de Londres, tant s’en faut, ne sont en cause: alors âgé de 84 ans, Sir Colin, qui fut aussi un grand chef d’opéra (Mozart, Britten), paraissait encore bien jeune et sa direction énergique, voire robuste, même si elle n’atteint jamais la référence absolue établie par Carlos Kleiber voici quarante ans, sert avec chaleur et tendresse l’opéra de Weber. Mais la distribution vocale pèche gravement: comment faire un bon Freischütz avec une Agathe catastrophique, une Annette à peine plus satisfaisante, un Max quelconque et des rôles secondaires guère mieux tenus? Il faudra donc, pour conserver un meilleur souvenir du dernier Colin Davis, se replier, chez le même éditeur, sur ses récents albums consacrés à Walton et à Nielsen (LSO Live LSO0726). SC
A la source des Rhapsodies hongroises

Sous le titre «Czardas Fantasy», Ferenc Vizi (né en 1974) revisite cinq des Rhapsodies hongroises de Liszt en compagnie de l’Ensemble Cifra – un violoniste, un altiste (jouant aussi de la vielle à roue) et un contrebassiste autour du cymbalum de József Csurkulya fils (né en 1974), auquel se joint son père, également prénommé József. Tour à tour séparés ou associés, le pianiste et les musiciens alternent pages lisztiennes et folkloriques, jusqu’à tenter, dans la dernière plage de l’album, un collage de la Quatorzième Rhapsodie et de la mélodie La grue vole haut dans le ciel. Enregistré en public au cœur de cette Transylvanie où se mêlent influences magyare et tsigane, ce programme peine cependant à convaincre: sans que la démarche paraisse incongrue ou même simplement commerciale, façon crossover, sans que le jeu de Vizi manque de virtuosité ou de fiugue, l’ensemble ne s’impose pas, sans doute parce que l’ascendance populaire et l’univers musical lisztien, faute de parvenir à fusionner, se juxtaposent simplement dans une confrontation non dépourvue d’intérêt mais inaboutie (Satirino SR131). SC
Les Keller comme un mécanisme de précision

Le Quatuor Keller livre une interprétation aérée et rigoureuse des Quatuors de Ligeti. La prise de son, mate et transparente, met remarquablement en valeur les effets sonores produits par la formation hongroise, dont le souci du détail révèle la richesse et la complexité de ces œuvres essentielles. Intercalé entre les deux, l’Adagio du Premier Quatuor de Barber peut paraître incongru, mais l’écoute du disque en continu rend sa présence pertinente (ECM New Series 481 0026). SF
Un Don Giovanni sans éclat

Après Così et Les Noces, la trilogie da Ponte donnée à Glyndebourne au milieu des années 1970 que réédite Arthaus est au complet avec ce Don Giovanni de 1977: moins à l’aise dans le rôle-titre que quatre ans plus tôt en comte Almaviva, Benjamin Luxon (né en 1937), plus cynique et distant que flamboyant, n’en offre pas moins une composition scéniquement intéressante et vocalement satisfaisante. Plus convaincant à tous égards, le Leporello de Stafford Dean (né en 1937) tend ainsi à imposer le valet face au maître, l’habit et la silhouette suggérant en outre une certaine identité entre les deux personnages, que bon nombre de mises en scène se sont plu, depuis lors, à mettre en relief. Rien d’extravagant, pour autant, dans le travail de Peter Hall (né en 1930) – si ce n’est une légère transposition chronologique, si l’on se fie aux costumes Regency: la direction d’acteurs est même parfois étrangement absente, dans les décors tristes et sans imagination de John Bury. Il est vrai que dans cette représentation qui ne semble pas intégralement captée en public – hormis après le rideau final, les rares applaudissements paraissent avoir été ajoutés après coup –, les protagonistes donnent l’impression de jouer pour les caméras de Dave Heather. Celui-ci s’autorise quelques innovations qui portent aujourd’hui leur âge, comme, dans certains ensembles, l’incrustation des visages des chanteurs, vus de face. Le Philharmonique de Londres n’est pas toujours agréable à entendre. Bernard Haitink, qui en était alors le principal conductor (1967-1979) et n’était pas encore le directeur musical de Glyndebourne (1978-1988), n’en réalise pas moins des merveilles: avec lui, l’orchestre mozartien annonce déjà largement le dernier Haydn et Beethoven, mais il arrive que le sens dramatique, souvent prenant, s’efface au profit d’une excessive placidité. Hormis les deux rôles précédemment évoqués, la distribution se révèle très inégale, principalement en raison des faiblesses de la partie féminine: l’Anna de Horiana Branisteanu (né en 1942), même si elle s’affirme quelque peu au fil de la soirée, vocifère, pâtit d’un timbre aigre, est fâchée avec la justesse et ne brille pas par son jeu théâtral; l’Elvira, en forme déclinante, quant à elle, de Rachel Yakar (née en 1938) tend également à crier et à manquer de précision. L’Ottavio de Leo Goeke (né en 1936) n’est pas sans charme, mais abuse des ports de voix. Si l’on excepte les excellentes mais nécessairement brèves interventions du bien oublié Pierre Thau (1933-2000) en Commandeur, seul le couple des paysans tire donc réellement son épingle du jeu, Elizabeth Gale (née en 1948) n’ayant pas de mal à éclipser ses partenaires et John Rawnsley (né en 1950) se montrant aussi bon acteur que chanteur. Ce témoignage s’impose d’autant moins que le travail éditorial d’Arthaus, une fois n’est pas coutume, déçoit tant dans la notice – mal traduite (le Commandeur y devient le «Commendateur») et prêtant la paternité du livret à Varesco (auteur, en fait, de celui d’Idoménée) – que dans les sous-titres, trop fréquemment décalés par rapport à la musique et agrémentant de très nombreuses fautes et scories une traduction, sans doute ancienne, qui prend par ailleurs d’importantes libertés avec le texte (102 312). SC
L’invitation à la danse de Laure Favre-Kahn

Difficile de concevoir un programme plus banal: Laure Favre-Kahn (née en 1976) interprète une sélection de danses, pour la plupart célèbres. Développant une sonorité plaisante mais sans aura particulière, la pianiste joue dans un style impeccable, toujours en situation («Andaluza» de Granados, Danses hongroises de Brahms), et exprime de nobles sentiments (Valse en la bémol majeur de Scriabine, Mazurka en la mineur opus 17 n° 4 de Chopin). Le jeu ne dépasse pas les lignes mais possède suffisamment d’impulsion et d’invention. Cette sympathique anthologie trouvera son public, notamment parmi les spectateurs qui souhaiteraient revivre ce récital du 18 juillet 2010 aux Flâneries musicales de Reims (Transart TR167). SF
Atterberg, l’homme qui valait 10000 dollars

Avec l’Orchestre symphonique de Göteborg et l’infatigable Neeme Järvi, qui en fut le directeur musical de 1982 à 2004, Chandos débute, si l’on en croit l’indication «Volume 1» apposée sur cet album, une série consacrée à l’œuvre orchestral de Kurt Atterberg (1887-1974), qui a notamment laissé neuf Symphonies. L’histoire de sa Sixième (1928), déjà bien servie au disque et même enregistrée sous la direction de Beecham (Dutton) avant sa création publique, est demeurée célèbre, car elle remporta le concours lancé par Columbia pour marquer le centenaire de la mort de Schubert. La compétition était assortie d’un prix de 10000 dollars, somme considérable pour l’époque, qui valut immédiatement à la partition le surnom de «Dollar Symphony» et permit au vainqueur d’acquérir une Ford. Les concurrents étaient incités à compléter la Symphonie «Inachevée» ou à s’en inspirer, mais le compositeur suédois, pas davantage que Franz Schmidt, auquel échut le deuxième prix pour sa Troisième Symphonie, ne cherche pas à cultiver une atmosphère schubertienne et bien moins encore à se livrer à un pastiche. L’univers est indéniablement nordique, évoquant ici ou là Sibelius et Nielsen (membre du jury), avec un sens de la couleur, un généreux postromantisme et une écriture virtuose et séduisante mis en valeur par une superbe prise de son. Moins inattendue, sinon peut-être dans sa forme très ramassée, la Quatrième «Sinfonia piccola» (1918) n’en est pas moins de belle facture, lumineuse et d’inspiration populaire, à l’image de la Huitième de Dvorák, et animée par un élan puissant, nonobstant son intitulé modeste. Le chef estonien, qui, malgré une très abondante discographie, n’avait pas encore eu l’occasion de consacrer un disque à Atterberg, est tout aussi convaincant dans les deux compléments. La Troisième Suite (1921) pour violon, alto et cordes consiste en une adaptation de trois pièces de la musique de scène écrite trois ans plus tôt pour Sœur Béatrice, miracle en trois actes de Maeterlinck: pleines de douce nostalgie, elles font parfois penser aux pages conçues par Fauré ou Sibelius pour Pelléas et Mélisande. Une rhapsodie de Värmland (1933), du nom d’un comté limitrophe de la Finlande, est dédiée à Selma Lagerlöf pour son soixante-quinzième anniversaire et sous-titrée «...en bordure du long lac Loven...» par référence au premier roman de l’écrivain (prix Nobel en 1909): elle assimile avec une grande subtilité l’élément folklorique, présent au travers de nombreuses citations de mélodies traditionnelles (CHSA 5116). SC
A la découverte de Hendrik Andriessen

Après Badings, Röntgen et van Gilse, David Porcelijn poursuit chez cpo, à la tête de l’Orchestre symphonique des Pays-Bas, l’exploration du répertoire symphonique de son pays, cette fois-ci avec Hendrik Andriessen (1892-1981). Dans cette importante famille de musiciens néerlandais, c’est peut-être l’un de ses fils, Louis (né en 1939), qui jouit aujourd’hui de la plus grande notoriété, mais si le catalogue de celui qui fut directeur des conservatoires d’Utrecht (1937-1949) puis de La Haye (1949-1957) est surtout riche de partitions pour orgue – il fut à partir de 1934 le titulaire de l’instrument la cathédrale d’Utrecht – et pour chœur, son œuvre symphonique mérite sans conteste une meilleure diffusion. Le premier volume de cette série débute assez logiquement par la Première (1930) des quatre Symphonies, créée par van Beinum: une structure originale de moins d’un quart d’heure, fondée sur la variation, dans une clarté néoclassique dépourvue de sécheresse. Les trois parties de la Suite de ballet (1947), d’esprit plus léger, adoptent volontiers un ton ludique, voire ironique, presque mahlérien, tandis que la spéculative Etude symphonique (1952) se révèle tour à tour sombre et véhémente. L’album, un peu trop bref, se conclut sur l’une des pages orchestrales les plus renommées du compositeur, avec le Ricercare, les (cinq) Variations et Fugue sur un thème de Johann Kuhnau (1935): le recours aux seules cordes évoque les pages comparables de Vaughan Williams ou Britten, auxquels Andriessen n’a pas grand-chose à envier tant en ingéniosité qu’en poésie (777721-2). SC
Eugen d’Albert symphoniste

L’histoire de la musique n’a retenu le nom d’Eugen d’Albert (1864-1932) qu’associé à l’un de ses vingt-et-un opéras, Tiefland (1903), au demeurant un peu oublié de nos jours en dehors des pays germaniques: l’album s’ouvre opportunément sur le postromantisme évocateur du «Prologue symphonique» que le compositeur en tira lui-même vingt ans plus tard. Mais l’intérêt principal de cet enregistrement publié par Naxos, qui s’est déjà précédemment intéressé à ses deux Concertos pour piano, réside dans son unique Symphonie (1886), œuvre de jeunesse d’un pianiste doué (bientôt dédicataire du Burlesque de Strauss), élève de Liszt, qui se montra toutefois ensuite suffisamment proche de Brahms pour jouer les deux Concertos de son aîné sous sa direction et pour que sa musique suscite l’approbation de Hanslick. De fait, le style porte clairement la marque de son pays d’adoption: né à Glasgow d’un père allemand (issu d’une famille franco-italienne) et d’une mère anglaise, il germanisa son prénom d’origine (Eugène) et vécut en Allemagne, avant de s’installer en Suisse en 1914. Et les quatre mouvements, de dimension respectable (plus de 50 minutes), se tiennent davantage dans la descendance de la tradition issue de Mendelssohn et Schumann que sous l’influence de la «nouvelle école» inspirée par Wagner et Liszt. Sans grande originalité mais sans véritable chute d’inspiration, ce romantisme confortable, à l’image de celui de Bruch, conserve toujours une parfaite noblesse de ton et ne se refuse pas à la grandeur. La réussite tient aussi à la baguette de Jun Märkl, qu’on n’a pas toujours connu aussi engagé, à la tête de l’Orchestre symphonique de la Radio de l’Allemagne centrale (MDR, Leipzig), dont il a été le Chefdirigent entre 2007 et 2012 (8.572805). SC
La rédaction de ConcertoNet
|