|
Back
05/19/2020
Erik Ryding et Rebecca Pechefsky : Bruno Walter. Un monde ailleurs
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Blandine Longre
Notes de Nuit – 550 pages – 25 euros
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
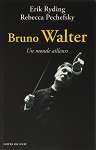
Bruno Walter, ce fut longtemps, pour beaucoup, un profil de patriarche patricien sur les pochettes des disques CBS où il dirigeait l’Orchestre Columbia. Un ensemble discographique où irradiait un lyrisme apollinien, associé parfois à une Gemütlichkeit viennoise – qui rendait ses Mahler inimitables. Mais on possédait aussi des témoignages plus anciens, un premier acte de La Walkyrie légendaire, avec Lotte Lehmann et Lauritz Melchior, un Concerto en ré mineur de Mozart, joué par lui-même, une bouleversante Neuvième Symphonie de Mahler, gravée dans l’angoisse juste avant l’Anschluss et l’exil. Et ce mythique Chant de la terre où le contralto Kathleen Ferrier nous serrait le cœur...
Autant d’étapes essentielles d’une longue carrière que le livre d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky, paru aux Etats-Unis en 2011, suit presque pas à pas, depuis la naissance à Berlin, en 1876, du petit Bruno Schlesinger, jusqu’à la disparition, à Beverley Hills, en 1962, de Bruno Walter. Une carrière qui aurait pu être de pianiste ou de compositeur. A douze ans, l’élève du Conservatoire Stern jouait en public le premier mouvement du Deuxième Concerto de Beethoven. Le compositeur n’attendit pas longtemps : en 1893, il donnait à Berlin son Meeresstille und glückliche Fahrt pour chœur et orchestre. Mais ses œuvres, inscrites dans un postromantisme fin de siècle, n’ont pas passé à la postérité, malgré quelques exhumations discographiques. Sa vocation était de chef qui, très tôt prit la baguette : simple corépétiteur à l’Opéra de Cologne, en 1894, à moins de dix-huit ans, on le chargea d’œuvres légères, notamment L’Armurier de Lortzing. Il n’en fallait pas plus pour le faire remarquer et le faire passer d’une maison à une autre.
Après Hambourg, Breslau (Wroclaw), où le directeur du théâtre lui imposa de changer son nom afin de ne pas le confondre avec tous les Schlesinger de la ville – ou de dissimuler ses origines juives –, Presbourg (Bratislava), Riga et Berlin, il devient l’assistant de Gustav Mahler à Vienne en 1901 : à partir de là, l’histoire est plus connue. Ces années d’apprentissage, justement, sont à découvrir : Walter s’y fait le bras en se frottant au répertoire, quel qu’il soit, de Gounod à Wagner, de Meyerbeer à Verdi, sans parler de compositeurs mineurs. De ce répertoire, le livre nous montre l’étendue, notamment la place qu’y occupait la création, à Vienne, à Munich ou à Berlin. C’est grâce à lui que le public autrichien découvrit Pelléas et Mélisande en 1911, qu’en 1917 Munich eut la primeur du Palestrina de l’ami Pfitzner, qu’il soutiendra jusqu’au bout malgré ses dévoiements idéologiques.
Cette curiosité s’étendait à l’orchestre seul : il ne s’imposait pas moins comme chef symphonique, nommé en 1929 Kapellmeister à Leipzig. Il pouvait diriger Elgar, Prokofiev... ou parfois La Nuit transfigurée de Schoenberg – il n’aurait certes pas conduit ses œuvres sérielles, de même que son Stravinsky était celui du néoclassicisme des années 1920. Le livre rappelle d’ailleurs que sa notoriété s’était répandue à travers l’Europe entière, mais aussi les Etats-Unis, où il ne se montra pas fermé à la musique américaine, Barber notamment, ce qui faciliterait son installation d’exilé victime du nazisme. Cela dit, il n’attendit pas les années 1930 pour devenir une des bêtes noires de l’antisémitisme – comme Mahler avant lui.
On découvrira également, bien que marié à une chanteuse, un séducteur, sa liaison avec la soprano Delia Reinhardt, qu’il retrouvera plus tard aux Etats-Unis et qui l’initiera à l’anthroposophie, pierre angulaire de sa vision du monde à la fin de sa vie. On ignora longtemps, d’autre part, que la fille de Thomas Mann, Erika, de trente ans sa cadette, y fut sa maîtresse. Le livre reconstitue la globalité de l’itinéraire, nous faisant revivre tout un pan de l’histoire de la musique, mais aussi de l’Europe et du monde. Ecrire sur Walter, c’est écrire sur deux guerres et les effondrements qu’elles provoquèrent. Tel est d’ailleurs l’esprit de la collection « La Beauté du geste » à laquelle nous devons déjà de passionnantes monographies sur trois autres baguettes de légende, victimes ou adversaires de l’hitlérisme – Toscanini, Klemperer et Fritz Busch.
Le livre ne permet pas moins de se faire une idée de l’évolution de la direction de Walter, dont certains, au début, fustigeaient les contrastes excessifs alors qu’il devint plus tard un modèle de maîtrise, universellement respecté ou admiré. A l’opposé de lui, notamment sur Mahler, un Bernstein ou un Mitropoulos, à New York, s’inclinaient devant ce magistère, quand leur aîné, conseiller musical de la Philharmonie de New York de 1947 à 1949, y exerçait une autorité qui n’était jamais rigidité. N’avait-il pas toujours été ainsi, à la fois exigeant et humain ? Celui qu’on assimilait, surtout les dernières années, à des Mozart lumineux et souriants, moins enflammés que deux du passé, sans être un dictateur à la Fritz Reiner, ne badinait pas avec ses convictions. Les enregistrements CBS, d’ailleurs, montrent bien que la fermeté se conjuguait à la souplesse.
Il se trouve que cette magnifique somme, fondée sur la recherche et la lecture de milliers d’archives, paraît au même moment qu’une autre : l’intégrale des enregistrements pour la Columbia. Walter aima le disque, très tôt, on lui doit le premier microsillon classique : un Concerto de Mendelssohn avec Nathan Milstein, capté en 1945. Il faut conjuguer l’écoute et la lecture, qui s’éclairent mutuellement, d’autant plus que les deux auteurs, à l’occasion, proposent de pénétrants commentaires de la discographie du chef. Et l’on pourra, grâce à eux, la compléter par l’imagination, en songeant à toutes ces œuvres qu’il aimait, qu’il aurait désiré graver et dont aucun live ne perpétue le souvenir, telles la Passion selon saint Matthieu ou la Troisième Symphonie de Mahler.
Didier van Moere
|