|
Back
04/01/2013
Boris Blacher : Preussisches Märchen, opus 30
Lisa Otto (Vater Fadenkreutz), Ivan Sardi (Mutter Fadenkreutz), Manfred Röhrl (Wilhem Fadenkreutz), Gerti Zeumer (Auguste Fadenkreutz), Donald Grobe (Assessor Birkhahn), Victor von Halem (Bürgermeister), Barbara Scherler (Bürgemeisterin), Carol Malone (Adelaide), Helmut Krebs (Steuerinspektor Zitzewitz), Ernst Krukowski (Der Trödler), Otto Heuer (Der Leutnant von der Feuerwehr), Klaus Lang (Der Versicherungsagent), Franz-Josef Kapellmann (Der Wirt), Leopold Clam (Bürodiener), Maria José Brill, Gitta Mikes, Helga Wisniewska (Wischfrauen), William B. Harpe (Tambourmajor), Monika Radamm, Frank Frey, (danseurs), Ballett der Deutschen Oper Berlin, Schöneberger Sängerknaben, Chor der Deutschen Oper Berlin, Albert Limbach (chef de chœur), Orchester der Deutschen Oper Berlin, Caspar Richter (direction musicale), Winfried Bauernfeind (mise en scène), Ernst Wurzer (décors), Werner Juhrke (costumes), Helmut Baumann (chorégraphie), Joachim Kunzendorf et Winfried Bauernfeind (réalisation)
Enregistré à Berlin (1974) – 102’58
Arthaus 101 658 – Format 4:3/NTSC – PCM mono – Region code: 0 – Sous-titres en anglais, allemand, français, espagnol et italien

Aribert Reimann : Die Gespenstersonate
Hans Günter Nöcker (Der Alte), David Knutson (Der Student Arkenholz), Horst Hiestermann (Der Oberst), Martha Mödl (Die Mumie), Gudrun Sieber (Das Fräulein), Donald Grobe (Johansson), William Dooley (Bengtsson), Hans Knorr (Der tote Konsul), Barbara Scherler (Die dunkle Dame), Kaja Borris (Die Köchin beim Oberst), Andrea Claasen (Das Milchmädchen), Edith Neitzel-Görler (Die Portiersfrau), Dirk Vogeley (Baron Skanskorg), Helen Höbel (Fräulein Holsteinkrona), Agnes Stein von Kamienski, Eva-Maria Jung, Sebastian Cramer, Ingo Jander, Jürgen Schmid (Bettler), Junge Deutsche Philharmonie - Ensemble Modern, Friedemann Layer (direction musicale), Heinz Lukas-Kindermann (mise en scène), Dietrich Schoras (décors, costumes), Klaus Lindemann (réalisation)
Enregistré en public à Berlin (25 septembre 1984) – 88’47
Arthaus 101 657 – Format 4:3/NTSC – PCM stéréo – Region code: 0 – Sous-titres en anglais, allemand, français, espagnol et italien

Wolfgang Rihm : Oedipus
Andreas Schmidt (Oedipus), William Pell (Kreon), William Dooley (Tiresias), Lenus Carson (Bote), William Murray (Hirte), Emily Golden (Jocasta, Frau), Catherine Gayer, Regina Schudel, Barbara Vogel, Daniela Bechly (Die Sphinx), Friedrich Wilhelm Detering (Oedipus als Kind), Peter Gougaloff, David Griffith, Otto Heuer, David Knutson, Bengt-Ola Magnusson, Peter Maus, Karl-Ernst Mercker, Thomas Schulze, Josef Becker, Rolf Kühne, Klaus Lang, Barry McDaniel, Friedrich Molsberger, Tomislav Neralic, Miomir Nicolic, Paul Wolfrum (Die Altesten von Theben), Anna Katharina Detering, Sibylle Gilles, Peter Maus, Peter Matic, Barry McDaniel, Lieselotte Rau, Caroline Ruprecht, Björn Schaller, Andreas Schmidt (Stimmen), Chor der Deutschen Oper Berlin, Georg Metz (chef de chœur), Orchester der Deutschen Oper Berlin, Christof Prick (direction musicale), Götz Friedrich (mise en scène), Andreas Reinhardt (décors, costumes), Brian Large (réalisation)
Enregistré en public à Berlin (4 octobre 1987) – 104’29
Arthaus 101 667 – Format 4:3/NTSC – PCM stéréo – Region code: 0 – Sous-titres en anglais, allemand, français, espagnol et italien
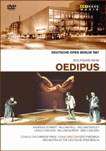
Arthaus poursuit sa série consacrée au Deutsche Oper avec trois nouvelles parutions faisant apparaître ce que le répertoire (allemand) de la seconde moitié du XXe siècle doit à l’institution berlinoise. Malgré de menues scories de sous-titrage, l’éditeur demeure attentif à une présentation soignée, avec des notices de Curt A. Roesler (en anglais, français et allemand), qui a occupé au Deutsche Oper les fonctions de dramaturge (1980-2001) avant d’y devenir le responsable du théâtre musical pour les enfants.
On ne connaît plus guère Boris Blacher (1903-1975) qu’au travers de ses brillantes Variations orchestrales sur un thème de Paganini, mais au sein de son important catalogue, dans lequel aucun genre n’est oublié, on ne compte pas moins de douze ouvrages lyriques. Le sixième, Conte prussien (1949), créé en 1952 au Städtische Oper (ancêtre du Deutsche Oper), est un «opéra-ballet» en cinq actes (qui ne comprend cependant, en son milieu, qu’une brève séquence chorégraphique). Le livret est signé Heinz von Cramer (1924-2009), qui fut l’élève de Blacher, avant de se faire le librettiste de son maître pour La Marée, de collaborer avec lui pour l’adaptation du Procès de Kafka mise en musique par un autre de ses élèves, Gottfried von Einem, et d’écrire Le Roi Cerf pour Hans Werner Henze. L’intrigue revisite habilement l’histoire (vraie) du Capitaine de Köpenick de Zuckmayer, occasion d’une satire fine et légère de la société prussienne au tournant des XIXe et XXe siècles: le quotidien de la bureaucratie est croqué avec humour, le portrait du Kaiser est omniprésent, la révérence à l’autorité, aux décorations et à l’uniforme est celle d’un monde où tout n’est qu’apparence: il suffit que l’employé municipal Wilhelm Fadenkreutz revête un uniforme de capitaine pour que change le regard des autres et son propre regard sur sa modeste personne, ce dont il tire parti pour réquisitionner une escouade et marcher sur la mairie, se vengeant ainsi du maire qui l’a injustement licencié.
Cette production de l’automne 1974, filmée (en play-back) pour la télévision dans les studios du Sender Freies Berlin (SFB), fonctionne parfaitement. Le sens rythmique et mélodique de Blacher, ménageant aussi bien des airs d’un grand lyrisme que des ensembles virtuoses, fait merveille: sous la direction du jeune Caspar Richter (né en 1944), les vingt numéros de la partition, enchaînés sans interruption, révèlent une ironie et un néoclassicisme plus attendris qu’acides, s’amusant de références stylistiques (de la valse à la fugue en passant par la marche et la polka) voire de citations (Czerny) qui s’inscrivent sans peine dans un langage où la tonalité n’est jamais significativement bousculée. Les décors et costumes reconstituent minutieusement l’ère wilhelminienne et la mise en scène de Winfried Bauernfeind (né en 1935), qui coréalise la vidéo et qui fut assistant de Gustav Rudolf Sellner à la Deutsche Oper, met en valeur une belle équipe de chanteurs – pour la plupart fidèles de la maison – qui prennent visiblement plaisir à jouer la comédie. Il suffit par exemple de voir la basse hongroise Ivan Sardi (né en 1930) et la soprano allemande Lisa Otto (née en 1919), désopilants respectivement en mère (sic) et père (sic) soucieux de caser leur fille et négociant férocement la dot avec le promis, le contrôleur Birkenhahn, bien campé par le ténor américain Donald Grobe (1929-1986). Le baryton Manfred Röhrl (né en 1935) investit avec beaucoup de persuasion le personnage principal, mais il faut aussi compter avec une galerie de seconds rôles parfaitement typés et remarquablement chantés, à l’image du ténor Helmut Krebs (1913-2007) en inspecteur des impôts, du baryton Ernst Krukowski (1918-1982) en brocanteur et de la basse Victor von Halem (né en 1940), dont a plaisir à entendre la voix alors intacte, en maire.
La vie et la carrière de Blacher, dont le fils, Kolja (né en 1963), fut un jeune Konzertmeister à la Philharmonie entre 1993 et 1999, sont intimement liées à Berlin: c’est aussi le cas de l’un de ses élèves à la Hochschule für Musik, Aribert Reimann, qui y est né en 1936. Parmi ses huit ouvrages lyriques, dont Arthaus a récemment publié la création du dernier, Médée, il n’est pas certain qu’on puisse considérer que l’un d’entre eux soit véritablement entré au répertoire, mais en tout état de cause, le quatrième, La Sonate des spectres (1983), sous-titré «Un opéra de chambre», n’a pas acquis la même notoriété que Lear, dont le rôle-titre fut créé par Dietrich Fischer-Dieskau, ou Le Château. Huit ans avant cet opéra tiré de Kafka, La Sonate des spectres est le premier des deux ouvrages qu’il a écrits pour le Deutsche Oper où, encore étudiant, il fut répétiteur. Coproduit avec les Berliner Festspiele, il fut créé en septembre 1984 au Théâtre Hebbel et remarquablement filmé à cette occasion par Klaus Lindemann pour le SFB. Ayant déjà puisé vingt ans plus tôt son inspiration chez Strindberg pour son premier opéra (Un jeu de rêves), le compositeur se fonde ici sur la pièce éponyme (1907) de l’écrivain suédois, qu’il a lui-même traduite et adaptée avec Uwe Schendel (1953-1994), à la mémoire duquel il écrira son Concerto pour violon (1996).
Ancrée dans les années 1980, la mise en scène de Heinz Lukas-Kindermann (né en 1939), lui aussi un ancien assistant de Gustav Rudolf Sellner, met bien en valeur l’univers étrange et torturé de Strindberg, le caractère pathétique et absurde des ces existences rongées par le secret, la culpabilité et l’expiation, ces masquent qui tombent, cette confusion entre maîtres et serviteurs, dominants et dominés, vivants et morts, présent et passé. Intelligemment pensée, la scénographie de Dietrich Schoras, qui signe également des costumes mêlant les époques, cultive les teintes sombres: la partie inférieure du plateau, surmontée d’un verre transparent qui constitue le plancher de l’intérieur bourgeois du colonel, ne s’éclaircit, une fois ceinte d’un rideau blanc, que pour la scène finale.
De dimensions relativement modestes (moins d’une heure et demie d’un seul tenant), l’opéra comprend trois scènes séparées par deux brefs interludes et fait appel à neuf chanteurs, à neuf acteurs ou figurants et à un ensemble instrumental de douze musiciens – quatre bois (flûtes, hautbois/cor anglais, cor de basset/clarinette basse, basson/contrebasson), deux cuivres (cor, trompette), harpe, piano/harmonium, et quatre cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) – dont ressortent souvent des soli de caractère expressif. Friedemann Layer (né en 1941) dirige ici l’Ensemble Modern, constitué seulement quatre ans plus tôt au sein de la Jeune philharmonie allemande: un an avant son installation à Francfort, la formation est déjà porteuse de beaucoup des promesses qu’elle confirmera durant les années suivantes.
Dramatiquement bien conçue, avec en son centre la terrifiante scène du «souper des spectres», la partition sait alterner phases paroxystiques et échappées poétiques. Très raffinée, d’un intense expressionnisme, l’écriture vocale sollicite les registres à leurs extrêmes et montre une prédilection pour les grands intervalles aussi bien que pour le Sprechgesang. Elle est clairement destinée à certains des artistes de la première, que Reimann connaissait bien, à commencer par Martha Mödl (1912-2001), qui avait participé en 1971 à la création de son deuxième opéra, Mélusine: elle est non seulement inattendue, dans un rôle essentiellement parlé de momie enfermée dans un placard et se prenant pour un perroquet, mais aussi poignante dans l’air accompagné de la seule contrebasse dans l’aigu qui lui est dévolu au début de la deuxième scène. Il en va de même du baryton Hans Günter Nöcker (né en 1927) et du ténor américain David Knutson (né en 1946), escaladant sans peine les notes jusqu’au contre-mi bémol, qui avaient incarné respectivement Gloucester et Edgar six ans plus tôt dans Lear. Il y avait en ces temps-là beaucoup de (belles) voix américaines au Deutsche Oper, puisqu’outre Donald Grobe en Johansson, l’autre domestique, Bengtsson, est joué par William Dooley (né en 1932). Bien entendu, les Allemands entretiennent eux aussi cet esprit de troupe, avec la soprano Gudrun Sieber (née en 1953), nullement décontenancée par la tessiture très tendue du rôle de la jeune fille, ou le ténor Horst Hiestermann (né en 1934), un colonel glapissant qui descend en droite ligne du capitaine de Wozzeck.
C’est aussi la captation d’une création, par l’incontournable Brian Large, qu’Arthaus donne à voir avec Œdipe de Wolfgang Rihm (né en 1952), Musiktheater en deux parties dont il a lui-même écrit le livret d’après Sophocle (dans sa traduction par Hölderlin), Nietzsche (pour les monologues du héros) et Heiner Müller (pour le commentaire de l’action). Cette parution nous plonge dans l’ambiance du soir de la première retransmise à la télévision – c’était l’époque, pas si lointaine, où TF1, avant le «mieux-disant culturel», diffusait en direct la création de Saint François d’Assise de Messiaen: depuis les coulisses, juste avant le lever de rideau, le téléspectateur était invité à entendre une présentation du quatrième des huit ouvrages lyriques du prolifique compositeur allemand par le metteur en scène et réalisateur Georg Quander (né en 1950): alors journaliste au SFB (1979-1987), il devait ensuite exercer des fonctions à la RIAS (1988-1991) et devenir intendant du Staatsoper (Unter den Linden), aux côtés de Daniel Barenboim (1991-2002), puis responsable des affaires culturelles à Cologne (2005-2013).
Intendant général du Deutsche Oper de 1981 à sa mort, Götz Friedrich (1930-2000) commanda à Rihm le «poème dansé» Tutuguri avant de reprendre son opéra de chambre Jakob Lenz puis de le nommer «conseiller pour la musique contemporaine» (1984-1990). Œdipe est également le fruit d’une collaboration entre les deux hommes: le metteur en scène produit, avec Andreas Reinhardt aux décors et costumes, un spectacle coup de poing bien dans l’air du temps. Revers de la médaille: les ingrédients ont déjà été vus et revus – tribunes, néons, formes géométriques, nervis terrifiants, hommes en feutres mous et longs manteaux ou costumes noirs, grand brassage chronologique de l’Antiquité à un futur postnucléaire, maquillages livides et masques inquiétants.
Sous la baguette de Christof Prick, également connu sous le nom de Perick (né en 1946), la musique de Rihm est à l’avenant. Fort de treize bois, douze cuivres, six percussionnistes, d’un piano et de deux harpes, mais avec des cordes réduites à deux violons, l’orchestre est en éruption quasi permanente durant ces trois tableaux qui font alterner six scènes, cinq «commentaires» et quatre «monologues»: du bruit et de la fureur jusqu’à la saturation, entre éclats, silences, cris et déplorations. Jeune mais doté d’une voix et d’une personnalité déjà très affirmées, le baryton Andreas Schmidt (né en 1960), présent sur scène durant plus d’une heure et demie, triomphe dans ce rôle-titre physiquement et émotionnellement éprouvant, parvenant même à faire valoir autant que possible un chant chaleureux et lyrique. Encore une fois, la présence américaine est remarquablement forte sur le plateau, que ce soient les invités – Emily Golden (née en 1953), qui créa en 1998 à Bastille le rôle-titre de Salammbô de Fénelon, en Jocaste et le ténor Lenus Carlson (né en 1945) en messager – ou les membres de la troupe – le ténor William Pell (1947-2003) en Créon et le baryton William Murray (né en 1935) en berger. Au moment des rappels, l’accueil est globalement positif, voire enthousiaste, mais les protestations et sifflets redoublent à l’apparition du compositeur.
Simon Corley
|