|
Back
01/23/2011
Johannes Brahms : Concerto pour piano et orchestre n° 2, opus 83 – Variations sur un thème de Paganini (Second cahier), opus 35b – Danses hongroises n° 1, n° 2 et n° 4
Boris Berezovsky (piano), Orchestre philharmonique de l’Oural, Dmitri Liss (direction)
Enregistré en studio (Variations) et en concert à la Philharmonie d’Ekaterinburg (novembre 2010) – 61’03
Mirare MIR 132 (distribué par Harmonia mundi) – Notice de présentation en français, anglais et allemand

Johannes Brahms : Fantasien, opus 116 – Intermezzi, opus 117 – Klavierstücke, opus 118 et opus 119
Philippe Cassard (piano)
Enregistré au Curtis Auditorium de la School of Music de Cork (juillet 2009) – 79’02
Accord 480 3412 (distribué par Universal) – Notice de présentation en français et anglais
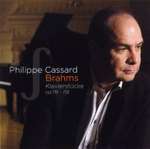
Tout Brahms est dans ces deux disques, documentant des phases bien contrastées du style pianistique du compositeur allemand (1833-1897). Le premier permet ainsi à Boris Berezovsky (né en 1969) de rendre compte tout à la fois du rythme musclé de la seconde partie des Variations sur un thème de Paganini (1863), de la vie et du punch de quelques Danses hongroises et, surtout, de ce qui est peut-être «le jalon dissimulé entre le Requiem allemand de 1868 et les Quatre chants sérieux de l’année de [la] mort» de Brahms (Rodolphe Bruneau-Boulmier, dans la notice). Avec le Second concerto pour piano (1881), le pianiste russe aborde, en effet, les derniers feux du romantisme en même temps que leur nouvelle jeunesse. Accompagné par Dmitri Liss et le Philharmonique de l’Oural – pour qui Berezovsky est un soliste fidèle au concert comme au disque (lire ici et ici) –, il part à la conquête de l’Allegro non troppo, impressionnant par sa concentration (il s’agit d’un enregistrement en direct) et le souffle de son articulation, parvenant à intensifier le jeu même au milieu des phases les plus techniquement redoutables.
Pourtant, l’emballement tourne court assez rapidement, dès un Allegro appassionato qui déconcerte par des choix de tempos plus instables, peu académiques et pas toujours convaincants et surtout par un frappe moins rigoureuse. Outre un violoncelle bien ordinaire de ton et à la justesse approximative, l’Andante déçoit par un excès d’empressement et un orchestre au son assez ordinaire (mais à la cohésion indéniable), alors que l’alerte Allegretto grazioso se fait presque badin voire burlesque. En définitive, ce Brahms tonique et léger, incroyablement véloce – plus rapide de six minutes que Richter/Leinsdorf, de huit minutes que le récent Freire/Chailly... et même de dix minutes qu’Arrau/Giulini, Zimerman/Bernstein ou Gilels/Jochum! – aurait pu être l’occasion d’un passionnant dégraissage du Concerto en si bémol majeur... ce qu’une prise de son trop lointaine (live from Ekaterinburg) et une impression générale de survol expéditif n’ont – hélas – pas permis.
Le plaisir est, en revanche, total avec les pièces tardives jouées par Philippe Cassard, un artiste aux multiples talents, qui signe notamment le très beau texte de la notice et nous convie à un «vertigineux voyage qui vire parfois à l’épopée (…) à travers les paysages rassemblés d’une vie et d’une âme imprégnées de Weltschmerz – ce poids de la douleur du monde porté par les artistes romantiques allemands» alors que «Brahms referme ici le grand livre de la Sehnsucht – mélancolie, aspiration vers un ailleurs incessible – ouvert par Schubert soixante-dix ans auparavant». A coup sûr, il faut avoir vécu pour interpréter cette musique crépusculaire, qu’on écoute volontiers le soir – pour entretenir une déprime ou attiser une nostalgie –, aussi justement (l’Opus 118 notamment): il faut avoir vécu comme pianiste, et aussi comme homme.
Né en 1962, Philippe Cassard est un pianiste réfléchi, mi-poète (Opus 119), mi-sculpteur (Opus 117), qui dessine ces Pièces pour piano (1892/1893) dans le marbre du grave de son Steinway plutôt que dans l’évanescence d’un aigu plaintif et mélancolique, offrant un Brahms noir qui prend place aux côtés des versions indispensables de ces partitions (à commencer par Kempff pour l’ensemble des vingt morceaux, Gilels, Nat ou Lupu pour certains opus). Comme en concert (lire ici), le pianiste français parvient ainsi à «s’engager plus avant, avec le seul piano pour confident, sur ces sentiers qui mènent à la résurgence du souvenir, à l’évocation de l’enfance, à un état de rêve éveillé propice au défilé fantomatique de motifs, de tournures, d’éléments rythmiques sortis durant quarante ans d’une imagination jamais tarie». Envoûtant.
Le site de Philippe Cassard
Gilles d’Heyres
|